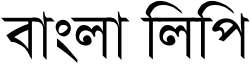Afin de permettre à nos lecteurs d’élargir leurs horizons de lecture, nous avons sélectionné, parmi les 2 723 801 articles de Wikipédia en français, 4 191 bons articles et 61 bons portails qui reflètent la diversité et la richesse de Wikipédia. Les articles sont reconnaissables à la présence d’une étoile (![]() ) et du texte Vous lisez un « bon article » dans la partie supérieure de la page ; les portails sont quant à eux reconnaissables à la présence également d’une étoile (
) et du texte Vous lisez un « bon article » dans la partie supérieure de la page ; les portails sont quant à eux reconnaissables à la présence également d’une étoile (![]() ) et du texte Cette page est un bon portail dans la partie supérieure droite de la page.
) et du texte Cette page est un bon portail dans la partie supérieure droite de la page.
Cette étoile est également présente devant un lien interlangue quand l’article ou le portail correspondant a été reconnu comme bon article ou bon portail (ou s’est mérité un titre équivalent) par l’édition de Wikipédia dans la langue concernée.
Afin d’élargir les horizons de lecture de l'encyclopédie, 33 bons thèmes regroupent une partie des 4 191 bons articles et des 2 236 articles de qualité. Ces thèmes sont reconnaissables à la présence d’étoiles (![]() ) dans le coin supérieur droit de la page de l'article chapeau.
) dans le coin supérieur droit de la page de l'article chapeau.
Si vous rencontrez ou estimez avoir écrit un article digne de figurer dans cette liste, proposez-le sur la page des contenus potentiellement bons. À l’inverse, un article présent dans cette page, mais qui ne serait pas (ou ne serait plus) digne d’y figurer peut être contesté et éventuellement retiré. La même chose vaut pour les portails, qui disposent toutefois de critères spécifiques. Si vous connaissez un autre thème intéressant, proposez-le sur la page des thèmes potentiellement bons. À l'inverse, un thème présent qui ne l’est pas ou qui ne l’est plus peut être contesté et éventuellement retiré.
Le label « Bon article », « Bon portail » ou « Bon thème » a été créé pour les articles d'un bon niveau mais qui ne sont pas encore suffisamment aboutis pour atteindre le niveau requis pour l’obtention du label « Contenu de qualité ».
Mathématiques, sciences de la matière, de l’univers et de la vie - Sciences humaines - Politique, philosophie, droit et société · Religions et mythologies - Arts et culture - Techniques et sciences appliquées - Vie quotidienne et loisirs
|
Bons articles récemment promus |
|
|
 La Mésange huppée (Lophophanes cristatus, anciennement Parus cristatus) est une espèce de passereaux de la famille des Paridés, qui peuple presque toute l'Europe jusqu'à l'Oural, sauf l'Irlande, l'Italie (au sud de l'arc alpin), certaines régions des Balkans et des Carpates, et le nord de la Scandinavie. Elle est la seule mésange européenne dotée d'une huppe, noire à motifs blancs, ce qui la rend facile à reconnaître. Cette huppe est érigée en situation d'alerte, mais aussi lors des parades nuptiales. Le reste du plumage est brun chamois sur le dessus et gris-beige sur le dessous. Cette mésange peuple les bois de conifères, en particulier les pins et les épicéas, en montagne et en plaine, un habitat qu'elle partage fréquemment avec le Grimpereau des bois, la Mésange noire, la Mésange nonnette et le Roitelet huppé. Au sud de son aire de répartition, elle est plus tolérante sur son habitat et peut également se trouver dans des feuillus. Comme la plupart des mésanges, elle est cavicole : elle aménage son nid dans la cavité d'un arbre mort ou sénescent. Elle peut également réutiliser une cavité déjà existante, comme la loge d'un pic, un gîte d'Écureuil roux, ou emménager dans un nichoir artificiel. La période de reproduction s'étend de fin avril à début juin, la date de ponte variant suivant la région. Cinq à huit œufs sont couvés par la femelle pendant treize à dix-huit jours. Les deux parents nourrissent ensuite les juvéniles pendant seize à vingt jours. Le succès reproducteur est également variable : il va de 4,7 jeunes par nichée en Finlande à 5,9 dans le sud de l'Allemagne. La Mésange huppée se nourrit d'insectes et d'araignées. Elle complète son régime en hiver par des graines de conifères et des baies. Comme d'autres mésanges, elle cache sa nourriture en prévision de la mauvaise saison. Sédentaire, elle peut s'observer toute l'année dans la plus grande partie de son aire de répartition. Sa population, de tendance stable, est estimée en 2021 entre 9,2 et 16,4 millions d'individus. Elle est classée espèce de préoccupation mineure par l'Union internationale pour la conservation de la nature. |
 Douliou-douliou Saint-Tropez (souvent erronément intitulé Do you do you Saint-Tropez) est une chanson française composée par Raymond Lefebvre et Paul Mauriat, écrite par le parolier marseillais André Pascal, pour le film Le Gendarme de Saint-Tropez, en 1964. L'actrice Geneviève Grad interprète la chanson dans le film. Inspirée par la variété yéyé du moment, la chanson est un twist, à la croisée de la surf music et de la danse Hully-Gully. Nicole l'entonne dans un bar avec ses nouveaux amis de la jeunesse dorée de Saint-Tropez, alors que son père — l'autoritaire gendarme incarné par Louis de Funès — lui a interdit de sortir la nuit. Les paroles évoquent l'insouciance de la jeunesse, le soleil, la plage, la détente, la fête, l'alcool et la liberté sexuelle. Raymond Lefebvre et Paul Mauriat élaborent la chanson avant le tournage, tandis que le reste de la bande originale du film est écrit après. La musique sert également de générique d'ouverture. Grand succès des années 1960, le morceau est l'ajout « jeune » de ce premier Gendarme, en partie responsable de l'attrait du public. Il rejoint d'autres chansons reflétant la soudaine popularité de Saint-Tropez dans la décennie, dont Saint-Tropez Blues de Marie Laforêt, Twist à Saint-Tropez des Chats sauvages et La Madrague par Brigitte Bardot. Il n'apparaît toutefois plus dans les suites, au contraire de la très populaire Marche des Gendarmes. Le titre connaît ensuite une notoriété internationale par sa reprise par la chanteuse québécoise Jenny Rock en 1965, suivie par d'autres interprètes pendant plus de cinquante ans. Au XXIe siècle, la chanson demeure une référence emblématique pour la cité balnéaire. |
|
 Soon You'll Get Better est une chanson de l'autrice-compositrice-interprète américaine Taylor Swift. Elle figure sur l’album Lover, sorti le . Elle est le fruit d’une collaboration avec les Chicks, un groupe de country américain. Sur une musique country, dont la simplicité met en lumière le propos de la chanson, Swift chante l'accompagnement d'un proche malade. Elle s'inspire de ses expériences familiales, évoquant probablement le cancer de sa mère. Pour cette raison, elle déclare en 2019 qu'elle ne l'interprétera sans doute jamais en live. Elle la chante pourtant en 2020 à One World : Together At Home, un concert caritatif virtuel diffusé mondialement. Sans être un single, Soon You'll Get Better entre dans le classement hebdomadaire de plusieurs pays, et obtient la certification disque d’or en Australie et au Brésil. Elle marque le retour des Chicks dans le top 10 du Hot Country Songs. Elles n'avaient pas atteint cette position depuis 2002, ayant été boycottées depuis 2003 pour leur position contre l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Les critiques de la chanson sont positives et soulignent sa vulnérabilité émotionnelle. |
 Les officiers de bouche sont des individus exerçant la fonction de sénéchal ou de bouteiller à la cour du royaume d'Angleterre au haut Moyen Âge, avant la conquête normande en 1066. Ce sont des membres de l'aristocratie (des thegns) chargés de servir la nourriture et les boissons lors des banquets organisés par les rois anglais. Outre cette fonction aulique, ils exercent également des responsabilités d'ordre militaire ou administratif en fonction des besoins de leur souverain. |
Mathématiques, sciences de la matière, de l'univers et de la vie |
|
Sciences humaines |
|
Politique, philosophie, droit et société |
|
Religions et mythologies |
|
Arts et culture |
|
Techniques et sciences appliquées |
|
Vie quotidienne et loisirs |
|