Explications :
- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique
- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.
- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.
- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.
 Le Pratt & Whitney F119 (désigné, en interne, par PW5000) est un turboréacteur double flux et double corps à postcombustion développé par l’Américain Pratt & Whitney entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Propulsant les Lockheed Martin F-22 Raptor, avions de chasse furtifs de l'US Air Force, il est, par conséquent, l'unique moteur de cinquième génération opérationnel à l'heure actuelle. Le P&W F119 est également l'un des rares turboréacteurs capables de propulser l'avion qu’il équipe à une vitesse supersonique sans avoir recours à la postcombustion ; cette capacité est connue sous la dénomination supercruise, ou supercroisière. Pour cela, il délivre une poussée de l’ordre de 35 000 lbf (156 kN) malgré 40 % de pièces en moins par rapport à son prédécesseur, de façon à diminuer les coûts de maintenance. Le P&W F119 dispose enfin d’une tuyère bidimensionnelle orientable de ±20° dans le but d’améliorer la manœuvrabilité de l’avion... Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |
Les Falashas (en hébreu פלאשים), ou Beta Israel (en hébreu ביתא ישראל), ou Bétä Esraél sont les Juifs d’Éthiopie. Falasha signifie en amharique, « exilé » ou « immigrés ». Rarement utilisé par les Juifs d’Éthiopie, qui emploient plutôt Beta Israel (la « maison d’Israël », au sens de la « famille d’Israël »), il est généralement considéré comme dépréciateur. Depuis l’immigration en Israël, le terme Beta Israel tend à être remplacé, en Israël et au sein de la communauté elle-même, par « Juifs d’Éthiopie ». On trouve aussi, selon les régions d’Éthiopie, les termes Kayla (d’étymologie toujours discutée) et esra’elawi (israélite). Les Beta Israel ont une origine mal définie. Ils ont vécu pendant des siècles dans le Nord de l’Éthiopie, en particulier les provinces du Gondar et du Tigré. Après avoir bénéficié de petits États indépendants jusqu’au XVIIe siècle, ils ont été conquis par l’empire d’Éthiopie, et sont devenus une minorité marginalisée, à laquelle il était interdit de posséder des terres, et accusée d’avoir le « mauvais œil ». | |
 Sheryl Swoopes, née le à Brownfield au Texas (États-Unis), est une joueuse de basket-ball américaine. Championne universitaire en 1993 avec les Red Raiders de Texas Tech en obtenant le titre de meilleur joueuse du tournoi final, elle remporte quatre titres de la WNBA avec l’équipe des Comets de Houston. Elle est désignée à trois reprises meilleure joueuse de la ligue, et trois fois meilleure joueuse défensive. Elle fait partie de la sélection des quinze meilleures joueuses de WNBA élue pour les quinze ans de la ligue. Avec la sélection américaine, elle remporte trois titres de championne olympique, une médaille d'or et deux de bronze au championnat du monde. Très populaire dans son pays, elle est la première joueuse qui voit commercialiser des chaussures de basket à son nom, la Air Swoopes, en référence à Michael Jordan.
|
 Sigyn est, dans la mythologie nordique, une déesse, femme de Loki et mère de Nari ou Narfi. Elle est mentionnée brièvement dans les sources islandaises : l'Edda Poétique, compilée au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes, et l'Edda de Snorri, écrite au XIIIe siècle. Sigyn n'est associée qu'au seul mythe du châtiment de Loki où, en femme fidèle, elle récupère dans un récipient le venin de serpent qui goutte sur le visage de son mari enchaîné, dans le but d'alléger ses souffrances. Sigyn est représentée sur la croix de Gosforth, datée du Xe siècle, et sa plus ancienne mention provient du poème scaldique Haustlǫng, du IXe siècle, et préservé dans l'Edda de Snorri, ce qui suggère qu'il s'agit d'une déesse germanique ancienne, et non d'une création récente. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings | |
|
La saison 1978-1979 du Racing Club de Strasbourg est la trente-quatrième saison du club alsacien en championnat de France de Division 1, sommet de la hiérarchie du football français depuis l'introduction du professionnalisme en 1932. Cette saison est importante dans l'histoire du club strasbourgeois puisque celui-ci devient pour la première fois champion de France. L'équipe est dirigée par Gilbert Gress, jeune entraîneur de 36 ans désigné entraîneur français de l'année 1978. Celui-ci apporte une tactique innovante en demandant notamment à tous les joueurs de participer aux actions défensives et offensives. La préparation de l'équipe est également innovante avec un travail physique important et une attention particulière portée à l'hygiène de vie des joueurs. La population locale s'identifie fortement avec cette équipe qui comporte une majorité de jeunes joueurs alsaciens talentueux comme Léonard Specht, désigné meilleur jeune joueur 1978, René Deutschmann, l'international espoir Yves Ehrlacher, l'attaquant international Albert Gemmrich, Jean-Jacques Marx et Roland Wagner. Ces joueurs sont entourés de quelques footballeurs plus expérimentés comme le gardien Dominique Dropsy, le défenseur Raymond Domenech ou le meneur de jeu Francis Piasecki. Le titre de champion du RC Strasbourg intervient après une troisième place obtenue en 1977-1978, qui fait suite à une relégation de Division 1 en 1976 et un titre de champion de Division 2 en 1977. Pour cette nouvelle saison de Division 1 1978-1979, le Racing vise une place dans le premier tiers du classement tandis que les clubs favoris pour remporter le titre sont l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes, multiples champion de France dans les années 1970, et l'AS Monaco, champion en titre. Le RC Strasbourg conquiert la première place du classement dès la 5e journée. Il ne quitte plus sa place de leader et gagne peu à peu un statut d'outsider crédible jusqu'à gagner le championnat. Le club atteint en outre la demi-finale en Coupe de France et le huitième de finale en Coupe UEFA. La saison du titre de champion de France 1979 est suivi avec enthousiasme dans la région alsacienne. Après une cinquième place acquise en 1979-1980, Gilbert Gress est limogé en septembre 1980 à cause de profonds désaccords l'opposant au président du club. Cet évènement provoque des émeutes inédites au stade de la Meinau et marque le début du déclin sportif du club dans les années 1980. |
L’affaire McLibel est le plus long procès de l’histoire britannique. Ce bras de fer juridique a opposé deux militants écologistes sans emploi à la plus grosse multinationale du monde, McDonald's. Il s'est achevé le 15 février 2005, après plus de dix ans, par la victoire des deux activistes face au géant McDonald’s devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils avaient été accusés initialement d'avoir dénoncé les pratiques de McDonald’s concernant la mauvaise qualité de la nourriture vendue, l’exploitation des employés, les méthodes marketing malsaines dirigées contre les enfants. Lire l’article | |
 La forêt amazonienne est une forêt équatoriale située dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Le bassin amazonien s'étend sur 7,3 millions de km² et la forêt elle-même sur environ 6 millions de km², situé sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 63 % de la forêt), mais aussi l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Suriname, le Guyana, la Bolivie et le Pérou. Bien que sa réputation de « poumon de la Terre » soit erronée, la forêt amazonienne est l'un des plus importants réservoirs de biodiversité de la planète et représente la moitié des forêts tropicales du monde. En termes d'écologie, il s'agit d'une forêt primaire au stade climax...
|
 Les Anasazis sont des Amérindiens du Grand Sud-Ouest de l’Amérique du Nord. Ils étaient répartis en plusieurs groupes dans les États actuels du Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Leur civilisation a laissé de nombreux vestiges monumentaux et cultuels sur plusieurs sites, dont deux sont classés sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Ensuite, les vestiges retrouvés par les archéologues témoignent d'une maîtrise des techniques de la céramique, du tissage et de l'irrigation. Enfin, les Anasazis savaient observer le soleil et dessinaient des symboles restés mystérieux dans le désert. Aujourd'hui, les descendants des Anasazis, les Zuñis et les Hopis de l’Arizona et du Nouveau-Mexique perpétuent leur culture. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne | |
 Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |
 Le bol de Benty Grange, ou bol suspendu de Benty Grange, est un artéfact anglo-saxon du VIIe siècle, réduit à deux écussons en bronze ornés, vestiges d'un bol complet découvert en 1848 dans le tumulus de Benty Grange, dans le Derbyshire. La sépulture, pillée mais riche, contenait également le casque de Benty Grange. Les écussons conservés du bol de Benty Grange, en bronze émaillé, mesurent 40 mm de diamètre. Ils présentent un motif de trois créatures stylisées, évoquant des dauphins et disposées en cercle. Leurs corps et le fond sont émaillés, probablement en jaune, avec des contours et des bordures étamés ou argentés. Ce motif se distingue par sa similitude avec l'enluminure insulaire, bien que des créatures similaires existent sur les écussons de Faversham. Un troisième écusson, disparu, présentait un décor de volutes et une taille différente, suggérant un emplacement au fond du bol. Les écussons du bol de Benty Grange sont répartis : un est conservé aux Musées de Sheffield et exposé au Weston Park Museum en 2023, l'autre est au Ashmolean Museum de l'université d'Oxford, mais n'était pas exposé cette même année. | |
|
Oswald le lapin chanceux (Oswald the Lucky Rabbit) est une série de dessins animés tournant autour du personnage éponyme créé par Ub Iwerks et Walt Disney en 1927 et distribué par Universal Pictures, qui en détenait les droits. Le personnage d’Oswald le lapin a commencé sa carrière en 1927, juste après la fin des Alice Comedies. Après quelques épisodes, Universal a confié la production à d’autres studios que celui de Disney, dont ceux de Charles B. Mintz et de Walter Lantz. C’est au moment de l’arrêt du contrat entre Disney et Universal qu’est né le personnage de Mickey Mouse. Le personnage d’Oswald a été « récupéré » par la Walt Disney Company en à la faveur d’un échange. |
 L'Attaque des Titans (進撃の巨人, Shingeki no Kyojin, litt. Le Géant assaillant, souvent abrégé SnK), aussi connu sous le titre anglais Attack on Titan, est un shōnen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre et dans le magazine Bessatsu Shōnen Magazine puis compilé en trente-quatre volumes reliés par l’éditeur Kōdansha. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition dans la collection seinen entre et . L’histoire tourne autour du personnage d’Eren Jäger dans un monde où l’humanité vit entourée d’immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l’humanité pour reconquérir son territoire, en éclaircissant les mystères liés à l’apparition des Titans, du monde extérieur et des évènements précédant la construction des murs. Une adaptation en série télévisée d’animation de vingt-cinq épisodes produite par Wit Studio est diffusée initialement entre avril et sur la chaîne MBS au Japon. Une deuxième saison de douze épisodes est diffusée entre avril et . Une troisième saison de vingt-deux épisodes, divisée en deux parties, est diffusée entre et sur NHK General TV. Une quatrième et dernière saison, divisée en trois parties, est produite par MAPPA et diffusée de à sur NHK General TV pour la première partie, de à pour la deuxième partie, et la troisième partie composée de deux épisodes spéciaux est diffusée entre et . La version originale sous-titrée en français est initialement diffusée et distribuée en simultané par Wakanim puis Crunchyroll en streaming et téléchargement légal, puis éditée par @Anime en DVD et Blu-ray. Des original video animation sont commercialisés au format DVD avec des éditions limitées du manga, et un film live en deux parties est diffusé lors de l’été 2015. Des adaptations en jeux vidéo, light novels et séries dérivées ont également vu le jour. La série est un succès commercial à l’échelle mondiale, avec un tirage total s’élevant à plus de 140 millions d’exemplaires en , ce qui classe l'œuvre parmi les séries de mangas les plus vendues. L’adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l’œuvre à l’international. L’accueil critique est également positif et loue l’atmosphère, l'intensité et le développement du récit. La série est récompensée par de nombreux prix, bien que l'interprétation politique de la série produise des controverses.
| |
 La crise bosniaque met aux prises les grandes puissances européennes les unes avec les autres durant l'automne et l'hiver 1908-1909. L'annexion formelle par l'Autriche-Hongrie des vilayets de Bosnie et d'Herzégovine en octobre 1908 constitue l'élément déclencheur de cette crise diplomatique. Les deux circonscriptions, appartenant nominalement à l'Empire ottoman, sont administrées depuis 1878, au nom du sultan ottoman, par la double monarchie, conformément aux décisions du congrès de Berlin. Ces dispositions limitent le droit d'occupation à 30 années et garantissent les droits souverains du sultan. Au cours des 30 années suivantes, les dirigeants de la double monarchie mènent une politique visant à rendre irréversible la tutelle austro-hongroise sur ces territoires, qui relèvent du ministre commun austro-hongrois des finances. En 1908, au terme de la période d'occupation prévue en 1878, la révolution des Jeunes-Turcs et la politique menée par la Serbie depuis le coup d'État de mai incitent l'Autriche-Hongrie à modifier le statut international des vilayets en procédant à leur annexion formelle, comme les accords secrets conclus en 1881 et 1884 avec le Deuxième Reich et l'Empire russe le lui permettent. Cette modification de statut, couplée avec l'érection de la principauté de Bulgarie en royaume indépendant, crée les conditions d'une crise internationale majeure. Ainsi, une fois la Russie circonvenue à Buchlau le 16 septembre, la Serbie, malgré son isolement diplomatique, refuse, dans un premier temps, de reconnaître la modification du statut des anciens vilayets occupés. Au terme de plusieurs mois de tensions diplomatiques, le royaume de Belgrade, isolé, abandonné par ses alliés, se trouve obligé, le 31 mars 1909, dans un second temps, d'accepter les termes de la note austro-hongroise sommant son gouvernement de reconnaître le changement de statut international du condominium austro-hongrois. |
Les Sept Samouraïs (七人の侍, Shichinin no samurai) est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti le . L'histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ce film a largement contribué à la renommée internationale de son réalisateur, bien plus encore que Rashōmon, sorti quatre ans plus tôt. De même, le rôle de Kikuchiyo a amplement participé à la notoriété mondiale de Toshirō Mifune. C'est l'un des films japonais les plus célèbres dans le monde. Même si la version intégrale a longtemps été inconnue en-dehors de son pays d'origine, le film a obtenu un Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1954 puis a connu un grand succès commercial dans le monde, notamment grâce à l'universalité de son histoire et à l'interprétation des acteurs. Il s'agit aussi d'un des films de samouraïs les plus connus et il est parfois considéré comme l'un des meilleurs films d'action de l'histoire. Il n'a cessé d'exercer une grande influence sur le cinéma mondial et a connu plusieurs adaptations plus ou moins libres, dont le western Les Sept Mercenaires en 1960. | |
 Iolanda Gigliotti, dite Dalida, est une chanteuse et actrice française d'origine italienne, née le au Caire (Égypte) et morte le à Paris. Issue d'une famille calabraise installée en Égypte, elle est élue Miss Égypte en 1954 et tourne plusieurs films au Caire. Résidant en France à partir de , elle connaît son premier succès de chanteuse avec le titre Bambino. Se façonnant un répertoire regroupant plus de 700 chansons interprétées en plusieurs langues, elle devient une grande figure de la chanson française et bénéficie d'une popularité dépassant la scène francophone. Parmi ses chansons les plus connues, figurent Come prima, Les Gitans, Gondolier, Les Enfants du Pirée, Itsi bitsi petit bikini, La Danse de Zorba, Le Temps des Fleurs, Darla dirladada, Paroles... Paroles..., Gigi l'amoroso, Il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Embrassant plusieurs styles musicaux, tels que le twist, la pop et le raï, elle est également une des premières artistes françaises à interpréter des chansons disco avec les titres J'attendrai et Bésame mucho. Souffrant d’une dépression — en raison notamment d'une succession de drames personnels —, elle se suicide quelques mois après avoir été l'actrice principale du film dramatique égyptien Le Sixième Jour. Sa vie privée et sa mort lui façonnent une image d’icône au destin tragique. |
 Madonna est le premier album de l'artiste américaine Madonna sorti le sous le label Sire Records. Il est ré-édité en 1985 sur le marché européen et renommé Madonna – The First Album. Tout commence en 1982, alors qu'elle commence à se lancer dans une carrière de chanteuse à New York, elle rencontre Seymour Stein, le président de Sire, qui lui fait signer un contrat après l'écoute de son single Everybody. Le succès de ce single encourage Sire à signer un contrat pour l'enregistrement d'un album. Pour la production, Madonna choisit de travailler avec Reggie Lucas, un producteur de Warner Records. Cependant, elle n'est pas satisfaite du résultat et est en désaccord avec les techniques de production de Lucas, elle décide donc de demander de l'aide supplémentaire pour la production. Madonna demande donc à son petit ami de l'époque, John Benitez, de l'aider à finir l'album. Benitez remixe de nombreuses pistes et produit Holiday. L'ensemble de Madonna est dissonant et ressemble à une forme de disco synthétique rythmé, utilisant quelques-unes des nouvelles technologies de l'époque comme le LinnDrum, le Taurus ou le synthétiseur Oberheim OB-X. Madonna chante dans un timbre vocal de jeune fille joviale et parle de l'amour et des relations amoureuses... Autres bons articles du portail des années 1980
| |
 La première guerre du Golfe, également appelée guerre du Koweït, opposa l'Iraq à une coalition de 34 États, soutenue par l'Organisation des Nations unies, entre 1990 et 1991. La victoire prévisible de la coalition entraîna la libération du Koweït, dont l'invasion en 1990 par les armées irakiennes avait provoqué le déclenchement du conflit. La coalition utilisa sa suprématie aérienne pour détruire la structure militaire (et aussi largement industrielle) de l'Irak. Ensuite une attaque terrestre limitée à partir de l'Arabie saoudite pulvérisa les forces armées en face d'elle. Ses pertes, très réduites par rapport à ses prévisions, furent dues pour un quart à des tirs amis. Lire l'article |
 Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | |
 L’ordre cistercien (ordo cisterciensis, o. cist.), également connu sous le nom d’ordre de Cîteaux ou encore de saint ordre de Cîteaux (sacer ordro cisterciensis, s.o.c.) est un ordre monastique chrétien réformé, son origine remonte à la fondation de l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme en 1098. L'ordre cistercien va jouer un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse du XIIe siècle. Par son organisation et par son autorité spirituelle, il s'impose dans tout l'Occident, jusque sur ses franges. Son influence se révèle particulièrement forte à l'est de l'Elbe où l'ordre fait « progresser à la fois le christianisme, la civilisation et la mise en valeur des terres ». Restauration de la règle bénédictine inspirée par la réforme grégorienne, l'ordre cistercien promeut ascétisme, rigueur liturgique et érige, dans une certaine mesure, le travail comme une valeur cardinale, ainsi que le prouve son patrimoine technique, artistique et architectural. Outre le rôle social, qu’il occupe jusqu’à la Révolution, l’ordre exerce une influence de premier plan dans les domaines intellectuel ou économique ainsi que dans le domaine des arts et de la spiritualité. Il doit son considérable développement à Bernard de Clairvaux (1090-1153), homme d’une personnalité et d’un charisme exceptionnels. Son rayonnement et son prestige personnel en ont fait au XIIe siècle le plus célèbre des cisterciens. S'il n'en est le fondateur, il demeure le maître spirituel de l’ordre. L'ordre cistercien comprend aujourd'hui plusieurs obédiences et congrégations. L'ordre de la « Commune Observance » comptait en 1988 plus de 1 300 moines et de 1 500 moniales, répartis respectivement dans 62 et 64 monastères. L'ordre cistercien de la stricte observance (aussi appelé o.c.s.o.) comprend actuellement près de 3 000 religieux trappistes et 1 875 trappistines, répartis respectivement dans quatre-vingt-onze abbayes et soixante couvents dans le monde entier. Le symbole de l'ordre est la feuille d'eau (cîteaux). Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |
 Achot Ier (en arménien Աշոտ Ա ; ° ca. 820 † 890), Achot Medz ou Ašot Meç (Աշոտ Մեծ, « Achot le Grand ») est un roi d'Arménie, membre de la famille arménienne des Bagratouni. Neveu du prince d’Arménie Bagrat II Bagratouni et fils du sparapet (« généralissime ») Smbat VIII Bagratouni, il succède à son père dans cette fonction sous le nom d’Achot V après la reprise en main de l’Arménie par le Calife al-Mutawakkil et l’exil des princes arméniens dans les années 850. Combinant sa propre intelligence à l’affaiblissement des dynastes arméniens et à la division des émirs arabes, et équilibrant le pouvoir déclinant des Abbassides par la puissance renaissante de l’Empire byzantin, il devient prince des princes d’Arménie en 862, puis roi d’Arménie vers 885. Ce faisant, il contribue au rétablissement de la royauté arménienne, quatre siècles après son abolition par les Sassanides. Ce souverain, véritable chef de famille des Bagratides arméniens et ibères, conclut diverses alliances matrimoniales et s’allie ainsi le Vaspourakan et la Siounie. En parallèle, il réduit le pouvoir des émirs arabes d’Arménie. Sous son règne, le pays connaît la croissance économique, une renaissance artistique et l’affirmation de son orthodoxie religieuse. | |
|
Le bâton de combat français est une technique de combat associée à la fédération de boxe française et disciplines associées. Elle est parfois qualifiée d’art martial français, notamment du fait de sa codification. Étroitement lié à l’histoire de la savate ou boxe française, ce sport apparaît au XIXe siècle. La canne est associée aux bourgeois des villes et le bâton aux paysans dans les champs. Cette technique fut popularisée dans la série Chapeau melon et bottes de cuir par le personnage John Steed, qui se battait avec sa canne selon cette technique (méthode dite « méthode Lafond »). Concernant la codification en tant que « sport » de combat, elle date de 1978 et provient de l’immense travail de codification effectué par Maurice Sarry. La canne de combat, ou « canne d’arme » ou encore « canne française » désigne particulièrement cette approche sportive. |
La French Data Network (FDN) est une association fondée en 1992. Son but est l’utilisation et le développement des réseaux Internet et Usenet dans le respect de leur éthique, en favorisant en particulier les utilisations à des fins de recherche et d’éducation sans volonté commerciale. C'est l’un des plus anciens fournisseurs d’accès à Internet en France encore en exercice. Il propose un accès ADSL depuis septembre 2005. | |
 Skylab a été la première station spatiale américaine. Elle fut lancée le et se désintégra au-dessus de l’océan Indien le en rentrant dans l’atmosphère. Pour leur première station spatiale, les Américains choisiront d’abord de convertir le matériel construit pour les missions lunaires (comme les fusées Saturn V ou les modules Apollo). Ce sera le programme AAP (Apollo Application Program), qui deviendra Skylab en 1973. Ainsi, la station Skylab a été fabriquée en réutilisant le troisième étage de la fusée Saturn V et fut lancé par la dernière fusée de ce type. La station américaine demeure l’une des structures les plus importantes jamais construites, lancées et maintenues sur orbite. Elle était constituée de quatre éléments principaux :
Ce laboratoire spatial avait un volume utile de 330 m3 et pesait 82 tonnes. Toutefois, la station subit des dommages importants lors de son lancement et ne put déployer un de ses panneaux solaires. Puis, un accident survint après une intense activité solaire qui dévia la course fatalement. Malgré les efforts de la NASA pour contrôler la descente, l’ouest de l’Australie reçut de nombreux débris de la station. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |
 L'Université Monash (anglais : Monash University) est la plus grande université d'Australie avec environ 55000 étudiants. C'est une université publique qui possède des campus en Australie, en Malaisie et en Afrique du Sud. Elle fait partie des plus grandes universités australiennes et mondiales. L'université dispose de huit campus: six au Victoria en Australie (à Clayton, Caulfield, Berwick, Peninsula, Parkville et dans le Gippsland), un en Malaisie et un en Afrique du Sud. L'université a aussi un centre au Prato en Italie ce qui en fait aussi l'université d'Australie la plus internationale . L'université est membre du groupe des huit qui regroupe huit des plus importantes universités australiennes. Elle a été classée par le Times Higher Education Supplement (THES) au 43e rang des 200 plus grandes universités au monde en 1947. L'université a une faculté de Droit particulièrement bien connue située à Clayton. Ses places dans le premier et le second cycle sont très recherchées dans le pays. Alors qu'il y a 11 universités au Victoria, Monash attire 33% des meilleurs étudiants du Victoria. Lire l'article | |
 En mécanique, un piston est une pièce rigide coulissant dans un cylindre de forme complémentaire. Le déplacement du piston est lié à une variation de volume de la chambre située au-dessus du piston, entre celui-ci et le cylindre. Un piston permet la conversion d’une pression en un travail, ou réciproquement. L’utilisation du piston est très variée. Une des utilisations les plus couramment rencontrées est celle des moteurs thermiques, comme le moteur automobile. On trouve aussi un ou des pistons dans les compresseurs, les pompes, les vérins, les détendeurs, les régulateurs, les distributeurs, les valves, les amortisseurs, mais aussi les seringues médicales, ou des instruments de musique à pistons. Il existe deux types de pistons, les pistons à simple effet, où la pression n’agit que sur une face (seringues médicales), et les pistons à double effet, où la pression agit sur ses deux faces (pompe à vélo). Le déplacement du piston provoque ou est provoqué par une pression à l’intérieur de la chambre… |
 Le yuri (百合, lys), aussi appelé Girls' Love, désigne dans la culture populaire japonaise un genre d’œuvres de fiction centré sur les relations intimes entre femmes, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales ou encore sexuelles. Ce genre ne se limite donc pas seulement au lesbianisme puisqu'il concerne aussi d'autres types de relations intimes comme peuvent l'être des liens spirituels ou encore des relations fusionnelles entre femmes. Le terme yuri est couramment employé dans le monde du manga et de l'anime, mais il est aussi parfois utilisé dans le cadre des jeux vidéo, de la littérature ou encore du cinéma. L'équivalent masculin du yuri est le yaoi. Le yuri est perçu comme l'héritier du esu (エス), un genre littéraire féminin du Japon du début du XXe siècle, avec lequel il partage de très nombreux points communs. Le yuri en tant que tel apparait au tout début des années 1970 dans les shōjo mangas, avant de s'étendre au fil des décennies à toutes les démographies du manga puis à d'autres types de média que le manga. | |
 Le glucose est un aldohexose principal représentant des oses. Par convention, il est symbolisé par Glc. Il se présente sous forme d’une poudre blanche, d’une saveur sucrée caramélisant à partir de 150 °C. Il est soluble dans l’eau, l’éthanol et la pyridine mais insoluble dans l’éther diéthylique et les solvants organiques…
|
 Du déclin des populations d’amphibiens : Ces extinctions et chutes de populations d’amphibiens sont un problème mondial, aux causes diverses et complexes. Parmi elles figurent des facteurs locaux comme la fragmentation et la destruction des habitats naturels, ainsi que l’introduction par l’homme de nouveaux prédateurs dans les écosystèmes en question, la surexploitation des amphibiens (nourriture, médecine…), l’augmentation de la toxicité et de l’acidité des milieux de vie des amphibiens, l’émergence de nouvelles maladies, le changement climatique, l’augmentation des radiations ultraviolettes (conséquence des atteintes portées à la couche d’ozone) et les interactions probables entre ces facteurs. | |
|
 La cellule (en latin cellula signifie petite chambre) est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire implique l'unité de tout le vivant : tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune...
| |
 La tortue luth (Dermochelys coriacea) est la plus grande des sept espèces actuelles de tortues marines et la plus grande des tortues de manière générale. Elle ne possède pas d'écailles kératinisées sur sa carapace, mais une peau sur des os dermiques. C'est le seul représentant contemporain du groupe des Dermochelyoidae, le clade des tortues à dos cuirassé, connu aussi par diverses espèces fossiles, dont certaines géantes comme l'archelon. La tortue luth fréquente tous les océans de la planète, mais sa survie est gravement menacée par le braconnage, les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. Elle figure sur la liste de l'UICN des espèces en voie de disparition et fait l'objet de conventions et de programmes internationaux de protection et de conservation. |
 La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts. | |
 Le gros-plant-du-pays-nantais (connu aussi sous le nom simplifié de gros-plant) est une appellation d'origine vin de qualité supérieure (AOVDQS) du vignoble de la vallée de la Loire qui produit des vins blancs secs principalement issus du cépage folle-blanche. Il couvrait, en 2008, une superficie de 1 372 hectares dans la région Pays de la Loire, principalement au sud de Nantes dans le département de la Loire-Atlantique et déborde sur celui du Maine-et-Loire et de la Vendée. Ce vin est aujourd'hui, avec 79 380 hectolitres, le premier vin de qualité supérieure de France en volume. Comme son voisin le muscadet, le gros-plant-du-pays-nantais peut être élevé sur lie. Élaboré depuis plus longtemps que ce dernier, le vin est aussi plus sec avec une certaine fraîcheur (acidité) ; il se caractérise par une robe pâle à reflet vert et dégage des arômes à dominante florale (fleur blanche, aubépine...), agrume (citron...) voire fruit exotique, avec parfois quelques notes minérales. Il est particulièrement connu pour accompagner les fruits de mer, notamment les huîtres de Cancale, moules et autres bigorneaux. |
 Gwen Stefani, née le à Fullerton, en Californie, est une chanteuse, auteur-compositrice-interprète et styliste américaine. Elle est principalement connue pour être membre du groupe No Doubt depuis 1986 en tant que chanteuse du groupe dont le premier album No Doubt est sorti en 1992, suivi de The Beacon Street Collection et Tragic Kingdom tous les deux sortis en 1995, puis le groupe est de retour en 2000 avec Return of Saturn suivi en 2001 de Rock Steady, qui comprend la chanson Hey Baby. En 2004, Stefani lance sa carrière solo avec son premier album Love. Angel. Music. Baby., suivi en 2006 par l'album The Sweet Escape. En 2008, Stefani réintègre le groupe No Doubt qui se reforme. En 2016, dix ans après son dernier album solo, Stefani sort This Is What the Truth Feels Like. Elle poursuit en octobre 2017 avec un album de chansons de Noël You Make It Feel Like Christmas. En 2003, elle débute dans le stylisme avec sa ligne de vêtement L.A.M.B. et étend sa collection avec en 2005 la ligne Harajuku Lovers, avec une forte inspiration de la mode et la culture japonaise. Lorsque Stefani se produit en concert, elle est accompagnée de danseuses, les Harajuku Girls. De 2002 à 2015, elle a été mariée avec le musicien grunge Gavin Rossdale, avec qui elle a trois fils. | |
 Martin Gélinas (né le à Shawinigan, dans la province du Québec au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien évoluant au poste d'ailier. Après une carrière junior avec les Olympiques de Hull, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est repêché par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d’entrée dans la LNH de 1988, au premier tour (septième choix au total). La même année, il est échangé par les Kings aux Oilers d'Edmonton, lors de la transaction qui a mené Wayne Gretzky à Los Angeles. Il fait ses débuts professionnels dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers lors de la saison 1988-1989, mais est renvoyé chez les juniors après six matchs. Il joue sa première saison professionnelle complète l’année suivante et participe aux séries éliminatoires qui lui permettent de remporter sa seule Coupe Stanley. En 1993, Martin Gélinas est échangé par Edmonton aux Nordiques de Québec, où il ne joue qu’une demi-saison, avant d’être réclamé au ballottage par les Canucks de Vancouver. Avec cette équipe, il participe, en 1994, à sa deuxième finale de la Coupe Stanley, perdue face aux Rangers de New York… |
 Edward Smith Fatu ( - ) est un catcheur (lutteur professionnel) américain mieux connu sous le surnom d'Umaga. Neveu des catcheurs Afa et Sika Anoa'i, il s'entraîne auprès d'Afa et lutte sous le nom d'Ekmo. Il rejoint la World Wrestling Federation/Entertainment (WWF puis WWE à partir de 2002) en 2001. Après un passage à la Heartland Wrestling Association, le club école de la WWF, il retourne à la WWF où il adopte le nom de ring de Jamal avant d'être renvoyé à la suite de problèmes de comportement en 2003. Cette même année, il rejoint la Total Nonstop Action Wrestling où il fait équipe avec Sonny Siaki et quitte cette fédération en fin d'année. Il part alors au Japon où il lutte à la All Japan Pro Wrestling (AJPW) et y remporte le tournoi Real World Tag League avec Taiyō Kea en 2004 puis le championnat du monde par équipes AJPW avec ce dernier en 2005. Début 2006, il retourne à la WWE où il prend le nom de ring d'Umaga et devient à deux reprises champion intercontinental de la WWE. Son second règne prend fin quand le magazine Sports Illustrated dévoile une liste de catcheurs clients d'une pharmacie vendant des stéroïdes sans demander d’ordonnance. La WWE le suspend alors 30 jours, puis le renvoie en juin 2009 après un contrôle anti-drogue positif. Il lutte ensuite au cours de l'Hulkamania Tour, une série de spectacles organisés en l'honneur d'Hulk Hogan en Australie fin novembre. Il meurt le à la suite d'une crise cardiaque causée par la prise d'anti-douleurs. | |
 Joseph Malègue est un écrivain français né le à La Tour-d'Auvergne et mort à Nantes le . Aîné de cinq enfants, renfermé et solitaire, il a cependant une enfance heureuse marquée par la foi de sa mère. Élève d'abord médiocre, il termine brillamment ses humanités, puis de nouveaux échecs dus à la maladie altèrent sa santé au physique et au moral, hypothéquant les carrières dont il rêve. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie rurale liée aux notables catholiques en déclin, évincés par une classe en ascension depuis la proclamation de la République en 1870. Cette première crise du catholicisme, aggravée par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 l'affecte lui et les siens. Elle précède de peu la crise moderniste de 1907, critique radicale mettant en cause scientifiquement l'interprétation traditionnelle des Évangiles. La crise, cette fois, ronge, chez Malègue, jusqu'à ses raisons de vivre. Pour Hervé Serry, le modernisme contraint l'Église à faire taire un clergé tenté par cette critique, ouvrant ainsi un espace dans le champ intellectuel religieux pour les écrivains de la Renaissance littéraire catholique. L'Église compte, pour s'imposer à nouveau dans le domaine des idées, sur ces laïcs plus sûrs qu'un clergé formé aux savoirs liés à l'exercice de son autorité doctrinale, disposant, s'il le veut, des armes intellectuelles pour la subvertir. Or, ses quinze années d'études à Paris mettent Malègue au contact des intelligences et acteurs (de tous bords) de ces bouleversements pénibles aux catholiques. Il acquiert ainsi, malgré son échec à l'École normale, une immense culture philosophique, théologique, sociologique, géographique, littéraire, économique, juridique, qui lui permet de comprendre et d'assumer ce que les écrivains de la renaissance catholique appréhendent mal, intellectuellement (le modernisme) ou sociologiquement (le déclin des notables catholiques). Malgré cet échec, les maladies, la Première Guerre mondiale et le sentiment souvent exprimé d'avoir « raté sa vie », il travaille de 1912 à 1933 à un très long manuscrit sur cette crise. Le , à Nantes, il épouse Yvonne Pouzin première femme praticien hospitalier en France, alors âgée de 39 ans. Yvonne Pouzin va jouer un rôle décisif dans la carrière de son mari. Elle l'aide moralement à compléter puis à faire publier le manuscrit d'Augustin ou Le Maître est là. Ce roman, qui paraît en 1933, consacre tardivement le parfait inconnu qu'est Malègue jusque-là comme « un grand de la littérature ». Cinq décennies plus tard, Émile Goichot le considère toujours comme « le roman du modernisme ». Il souligne fortement l'importance de l'intelligence dans la démarche de la foi, face à cette plus grande crise du catholicisme qui le frappe en plein cœur. Dans ce roman « philosophique » et de la mort de Dieu (Lebrec), racontant beauté des femmes, splendeur des paysages, ironie des situations, sons, couleurs, odeurs, la pensée jaillit du récit concret pour marquer durablement ses lecteurs jusqu'au XXIe siècle avec des gens comme André Manaranche ou le pape François... Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |
Le zoo de la Palmyre est actuellement le parc zoologique privé le plus fréquenté de France, l'un des plus renommés d'Europe, et un élément phare du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été créé en 1966 par le Rochefortais Claude Caillé, âgé alors de 35 ans, au cœur de la Côte de Beauté et des plages de la Charente-Maritime, à 15 km de Royan, dans la forêt de la commune de Les Mathes - La Palmyre. S'étendant sur 14 hectares aménagés en jardin paysager dans un site naturel, il offre au visiteur l'opportunité d'observer plus de 1 600 animaux en tous genres, répartis en 130 espèces, tout au long d'un parcours de plus de 4 km. Tournant le dos aux anciennes pratiques des parcs zoologiques, le parc met l'accent sur une amélioration constante de la qualité de vie des animaux, et joue un rôle important dans la réintroduction dans leur milieu naturel de certaines espèces menacées. Il joue également un rôle pédagogique auprès du visiteur en l'informant sur la biologie et le comportement des espèces, ainsi qu'en le sensibilisant aux menaces nécessitant de mettre en œuvre des mesures de conservation. Lire l'article | |
 La ligne 4 du tramway d'Île-de-France (ou T4) est une ligne exploitée par la SNCF, mise en service le entre Aulnay-sous-Bois et Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Elle est longue de 7,9 kilomètres. Elle est issue de la transformation et de la mise intégrale à double voie de la ligne de Bondy à Aulnay-sous-Bois, dite ligne des Coquetiers, ouverte en 1875, qu'elle emprunte sur la totalité de son parcours. Elle est ainsi devenue la première ligne française utilisant un matériel tram-train, bien que son exploitation soit entièrement assurée en mode tramway (conduite à vue, circulation à droite, signalisation tramway, etc.). Fin 2016, sa régularité était particulièrement faible, en s'établissant à 74,5 %. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |
Mélodie Cocktail — ou Le Temps d'une mélodie au Québec — est le 13e long-métrage d'animation et le 10e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1948, il s'agit d'une anthologie de sept courts métrages dans la lignée de Fantasia (1940) et de La Boîte à Musique (1946), mais incluant des prises de vues réelles. Les sept séquences, assez disparates, reprennent des traits caractéristiques des précédentes productions de Disney. Ainsi, on retrouve deux séquences sur le folklore américain, une séquence d'animation surréaliste, une autre dans un monde d'objets anthropomorphes et d'autres mêlant animation et acteurs en prise de vue réelle. Plusieurs auteurs notent que le film, malgré un certain niveau technique et quelques éléments agréables, manque d'unité. D'après ces mêmes critiques, le film conforte le public dans son attente d'un retour aux standards de Disney, les longs métrages d'un seul tenant. Mélodie cocktail est la dernière compilation de courts métrages de Disney hormis la compilation Le Crapaud et le Maître d'école (1949) avec deux moyens métrages. Le long métrage Cendrillon est alors en production et prévu pour 1950. En 1955, deux séquences issues du film ont été éditées sous le titre Contrasts in Rhythm tandis que cinq autres ont été regroupées avec quatre tirées de La Boîte à musique sous le nom de Music Land.
| |
 Renaud Séchan dit Renaud est un auteur-compositeur-interprète français né à Paris le . Avec 23 albums totalisant plus de 15 millions d'exemplaires, Renaud est l'un des chanteurs les plus populaires en France et l'un des plus connus dans la francophonie. Il utilise ses chansons pour critiquer la société, rendre hommage ou faire sourire par un usage intensif d'argot dans ses paroles. Il s'est lui-même surnommé le chanteur énervant en raison de ses multiples engagements pour des causes comme les droits de l'homme, l'écologisme ou l'antimilitarisme qui transparaissent fréquemment dans ses chansons et qui ont suscité de nombreuses réactions tout au long de sa carrière. Si elles ont souvent été contestées, il est devenu au fil des années l'un des Français les plus populaires. Il a également joué dans quelques films, notamment dans l'adaptation de Germinal par Claude Berri en 1993, et dans Wanted de Brad Mirman en 2003. |
Le Marignan est un cinéma de quartier situé à Saint-Josse-ten-Noode, inauguré en 1959 et qui cessa ses activités en 1979. Construit face au cinéma Le Mirano, il est bâti sur le terrain où se dressait La Maison des Brasseurs, un lieu de divertisement où étaient régulièrement projettés des films depuis 1905. Une autre salle de spectacle, Le Claridge, était établie à quelques mètres du Mirano, en direction de la place Madou. Le Mirano, avec son auvent, son grand hall d'entrée en entonnoir décoré d'affiches peintes et sa batterie de portes vitrées faisait le pendant du Mirano et était l'archétype des cinémas des années 1950. Le plafond du hall d'entrée est décoré d'éclairage au néon dont les tubes forment une énorme lettre « M » fleurdelysée. Surmontant l'auvent, l'enseigne lumineuse toute en hauteur rappelait la bataille de Marignan (1515), avec le nom du cinéma surmonté d'une fleur de lys, le tout accolé d'une longue épée. La salle, sans balcon comptait à l'origine 500 sièges, portés à 625 par après. Le cinéma fut inauguré pour le vingt-cinquième anniversaire du groupe Les Cinés de St-Josse qui regroupait cinq salles, Le Mirano, le Century et le Marignan et, à Schaerbeek, le Savoy et le Louvre, toutes situées chaussée de Louvain et aussi pour le même anniversaire de son frère quasi jumeau, Le Mirano. Le matin du jour de l'inauguration, le 11 juin 1959, une caravane de voitures de marque Citroën défilât dans les rues de la commune pour s'arrêter devant Le Marignan où était projeté le film Madame et son auto de Sophie Desmarets. La vedette du film était en effet une 2CV de cette marque. Des opérateurs avaient filmé le début de la soirée et le film, développé aux laboratoires ten-noodois Dassonville, fut projeté parmi les compléments. | |
 Sergio Leone, né le à Rome où il est mort le , est un réalisateur et scénariste italien. Père du western spaghetti (qu'il popularise largement, sans toutefois l'inventer, ni adhérer à l'épithète), il réalise les films Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand qui sont souvent considérés comme des classiques du cinéma, films qui révèlent l'acteur Clint Eastwood et le compositeur Ennio Morricone. Il est également célèbre pour la Trilogie du temps, composée de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution et Il était une fois en Amérique. Alors qu'il était apprécié par le public, mais boudé par la critique et ses pairs de son vivant, son importance dans l'histoire du cinéma est par la suite reconnue. Leone réussit à s'imposer parmi les grands réalisateurs grâce à son style novateur, par sa mise en scène, et par l'utilisation de la musique, composée par son collaborateur et ami Ennio Morricone. Plusieurs réalisateurs importants reconnaissent l'influence qu'il a eue sur leur travail ou l'admiration qu'ils lui portent, au premier rang desquels Quentin Tarantino. |
La Colombie participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud du au . Il s'agit de sa deuxième participation à des Jeux d'hiver, après celle de 2010, aucun athlète n'étant parvenu à se qualifier pour l'édition de 2014 à Sotchi. La délégation colombienne est représentée par quatre athlètes (trois hommes et une femme) et ses porte-drapeaux sont le patineur Pedro Causil lors de la cérémonie d'ouverture et le skieur Michael Poettoz à celle de clôture. La délégation colombienne bénéficie d'un programme d'aide pour la fourniture des tenues de compétition et pour les uniformes grâce au Comité international olympique et à la fédération mondiale de l'industrie d'articles de sport (WFSGI). La Colombie ne remporte pas de médaille au cours de ces Jeux olympiques. Son meilleur classement est une 20e place remportée par Pedro Causil lors de la finale de patinage de vitesse sur 500 m. À l'issue de ces Jeux, Helder Navarro, membre du Comité olympique colombien et chef de la délégation à Pyeongchang se montre toutefois satisfait des résultats obtenus. La société de télécommunications Claro obtient les droits de retransmission en Colombie des Jeux olympiques d'hiver de 2018. Elle les transmet via deux chaînes de télévision payantes, une application mobile et un portail web. | |
 Les Jeux olympiques d'hiver de 2010, officiellement connus comme les XXIes Jeux olympiques d'hiver, ont lieu à Vancouver au Canada du 12 au . Vancouver obtient les Jeux lors de sa troisième candidature en s'imposant face aux villes de Pyeongchang en Corée du Sud et Salzbourg en Autriche. C'est la troisième fois qu'une ville canadienne organise les Jeux olympiques après Montréal en été 1976 et Calgary en hiver 1988. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) est chargé de l'organisation des Jeux, en partenariat avec les premières nations Lil'wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, hôtes de ces Jeux. Tous les sites des compétitions se situent dans la province de Colombie-Britannique, principalement à Vancouver et Whistler. Les Jeux rassemblent 2 566 athlètes de 82 pays, ce qui constitue un record à l'époque pour les Jeux d'hiver. Ils se mesurent dans quinze disciplines qui regroupent un total de 86 épreuves officielles, soit deux de plus qu'en 2006. Le skicross fait son entrée au programme olympique, tandis que cinq pays envoient pour la première fois une délégation aux Jeux d'hiver : la Colombie, le Ghana, les îles Caïmans, le Pakistan et le Pérou. Les Jeux sont marqués par le décès accidentel du lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili survenu quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Les athlètes canadiens réalisent une performance remarquable : ils remportent 14 titres olympiques, ce qui constitue un nouveau record pour une nation aux Jeux d'hiver. L'athlète la plus médaillée de ces Jeux est la fondeuse norvégienne Marit Bjørgen, qui remporte cinq médailles en cinq épreuves disputées, dont trois en or. Avec une médaille en or et une en argent, le biathlète Ole Einar Bjørndalen porte son total olympique à onze médailles, ce qui en fait le deuxième athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux d'hiver derrière son compatriote Bjørn Dæhlie. En saut à ski, le Suisse Simon Ammann gagne les deux concours sur le tremplin du parc olympique de Whistler, huit ans après avoir réalisé la même performance aux Jeux olympiques de Salt Lake City. |
La déclaration sur l'identité coopérative est énoncée par l’Alliance coopérative internationale et date de 1895. Après avoir défini les coopératives et leurs valeurs, la déclaration énonce les sept principes de la coopération.
| |
 Le Bourget (prononcé [ləbuʁʒɛ] ⓘ) est une commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France. Ses habitants sont appelés les Bourgetins. Petit village avant l'industrialisation, Le Bourget a connu quelques batailles pendant la guerre franco-allemande de 1870. Néanmoins, la commune est surtout connue pour accueillir l'aéroport Paris-Le Bourget, qui est ouvert au trafic national et international commercial non régulier et aux avions privés. Ouvert en 1919, il est le premier aéroport civil de Paris, et reste le seul jusqu'à la construction de l'aéroport d'Orly. L'histoire de la ville est, d'ailleurs, fortement liée à l'aéronautique. Le Bourget abrite, par ailleurs, le musée de l'air et de l'espace, et accueille, tous les deux ans, le salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget. De même, la municipalité fait partie de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, afin de créer, notamment, un pôle de développement centré sur l'aéroport Paris-Le Bourget. |
 Le parc national des Îles-de-Boucherville est un petit parc national situé sur le Saint-Laurent non loin de Boucherville, sur la rive-sud de Montréal, au Québec (Canada). Il comprend un chapelet d'îles autrefois utilisées pour l'agriculture et la villégiature. Suite à la menace du développement immobilier durant les années 1970, le gouvernement acquiert les îles et crée le parc en 1984. Il présente aujourd'hui de nombreuses terres en friche ainsi que d'importantes zones de milieux humides. Le parc est reconnu pour son réseau cyclable développé, ses circuits en kayak et son golf public. Le cerf de Virginie, qui dispose d'une importante population sur les îles, est facilement observable en toutes saisons, tout comme le renard roux et l'écureuil gris. Le parc est géré par le gouvernement québécois et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). | |
|
 La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA) est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l’appellation « Société de limonaderies et glaces d’Abidjan » (SOCIGLACE) et alors spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses et de glace. Elle prend son nom actuel en 1958 lorsqu’elle s’assure le concours de la société anonyme « Brasserie Artois » (plus importante brasserie de Belgique) et ouvre ses activités au marché de la bière en Côte d’Ivoire. Depuis 1994, la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique a été rachetée par le groupe BGI (Brasseries et glacières internationales, filiale du Groupe Castel). La Solibra, qui a un capital de 4 110 000 000 FCFA au , est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) où elle a obtenu le 3e prix Palmes BRVM de l’édition 2006. | |
 Le nain est une créature humanoïde imaginaire souterraine de petite taille, dont la figure actuelle est principalement issue de la mythologie nordique et des croyances germaniques médiévales. Comme le lutin, le gobelin et le gnome, avec lesquels il est souvent confondu, il fait partie du « petit peuple ». Il partage peut-être la même origine que les géants mythologiques. Des personnages et peuples nains sont connus par les mythologies, la littérature, le folklore, les contes et les traditions populaires de très nombreux pays. Bien que des textes plus anciens en parlent, les nains acquièrent la plupart de leurs caractéristiques dans les textes allemands médiévaux, qui les dépeignent comme d’excellents forgerons industrieux aux demeures souterraines ou montagnardes, créateurs d’armes pour les dieux, mais sans donner d’indication précise sur leur taille. Peu à peu, ils sont perçus comme de petits êtres. En raison de leur lien originel aux croyances mortuaires païennes, ils gardent mauvaise réputation, et sont diabolisés par l’Église médiévale. Paradoxalement, ils se rapprochent, dans le même temps, de l’elfe et des génies bénéfiques du foyer au XIIIe siècle, puis s’associent au folklore minier, pouvant se révéler une grande aide ou au contraire une nuisance terrible pour les humains. Aux côtés de ceux de la mythologie nordique, les croyances comptent des centaines de petites créatures désignées comme des nains, tels les Nibelungen, Bergleutes, Knockers et Bonnets-Rouges, ou encore Rübezahl et Alberich. Désormais, et pour la plupart des gens, les nains ont perdu tout côté maléfique, et renvoient à l’imagination créatrice enfantine, à l’image des personnages qui aident Blanche-Neige, ou des statuettes qui décorent les jardins. Bon nombre de productions artistiques les mettent en scène, notamment la Tétralogie L’Anneau du Nibelung, de Richard Wagner. En créant la Terre du Milieu, qu’il peuple, entre autres, de nains, J. R. R. Tolkien contribue, par ses écrits (en particulier Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux), à en donner une nouvelle image, reprise par la littérature fantasy, les jeux de rôle et les jeux vidéo, comme celle d’un peuple de guerriers maniant la hache ou le marteau, vivant sous les montagnes, et souvent opposé aux elfes. |
 Anne-Marie de Danemark (en danois : Anne Marie af Danmark ; en grec moderne : Άννα-Μαρία της Δανίας / Anna-María tis Danías), princesse de Danemark et, par son mariage, reine des Hellènes, est née le à Copenhague, au Danemark. Troisième fille du roi Frédéric IX de Danemark et épouse du roi Constantin II de Grèce, elle est reine des Hellènes de 1964 à 1973. Anne-Marie de Danemark grandit à Copenhague, au milieu d'une famille soudée et aimante. Formée à l'école Zahle et dans des internats suisses, elle étudie la puériculture avant d'épouser son cousin, le jeune roi Constantin II de Grèce, en 1964. Devenue reine des Hellènes à l'âge de dix-huit ans, elle prend la tête de différentes organisations de bienfaisance mais se révèle rapidement une souveraine timide et discrète. Tandis que la Grèce traverse une grave crise politique, due à la fois aux tensions entre son époux et le Premier ministre Geórgios Papandréou et à la crise chypriote, Anne-Marie se consacre à son foyer et donne le jour à la princesse Alexia (1965) et au diadoque Paul (1967). Le , une faction de l'armée organise un coup d'État et impose sa dictature à la Grèce. Pris au dépourvu, Constantin II reconnaît le nouveau régime mais organise un contre-coup d'État le . Sa tentative ayant échoué, il est chassé du pays avec le reste de la famille royale, sans que la république soit pour autant proclamée par les militaires. Réfugiée à Rome jusqu'en 1973, Anne-Marie reste officiellement reine des Hellènes durant cinq ans, ce qui lui vaut d'être invitée à de nombreux événements internationaux, mais ni elle ni son mari ne sont autorisés à rentrer dans leur pays. C'est d'ailleurs en exil que naissent leurs trois derniers enfants : Nikólaos (1969), Théodora (1983) et Phílippos (1986). Le début des années 1970 est une période difficile pour Anne-Marie. Son couple se distend et elle envisage un moment le divorce. La proclamation de la république en Grèce (1973) et le maintien des mesures d'exil par les nouvelles autorités démocrates (1974) mettent un terme aux espoirs de restauration. Par la suite, les relations de l'ancien couple royal avec sa patrie restent compliquées. L'ex-roi des Hellènes et sa parentèle sont autorisés à rentrer en Grèce le temps d'une journée en février 1981 puis plus longuement à l'été 1993, mais ce second séjour provoque de vives tensions avec les autorités républicaines. En 1994, le gouvernement confisque les biens de l'ex-dynastie et lui retire, en même temps, la nationalité grecque. Constantin II se lance alors dans une bataille juridique qui va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les indemnités obtenues, l'ex-roi crée la fondation Anne-Marie en l'honneur de son épouse (2003). Un an plus tard, Constantin et Anne-Marie sont officiellement autorisés à rentrer dans leur pays et s'installent définitivement à Porto Heli en 2013. Depuis lors, le couple mène une vie relativement discrète en Grèce et Anne-Marie y soutient différentes activités caritatives. | |
 Sidi Larbi Cherkaoui, né à Anvers en 1976, est un danseur et chorégraphe belge de danse contemporaine. En résidence au Toneelhuis d'Anvers depuis 2007, il fait partie de la nouvelle génération émergente des chorégraphes flamands formés autour notamment d'Alain Platel et des Ballets C de la B et d'Anne Teresa De Keersmaeker à la fin des années 1990. Adepte d'une danse relativement physique notamment en termes de capacités de souplesse des membres, il collabore fréquemment avec de nombreux autres chorégraphes tels que Akram Khan et son complice de longue date Damien Jalet. Lire l'article |
 Les tyrannosauridés (Tyrannosauridae), ou plus simplement tyrannosaures, terme signifiant « lézards tyrans », forment la famille de dinosaures théropodes cœlurosauriens comprenant le célèbre Tyrannosaurus et d'autres grands prédateurs apparentés aujourd'hui éteints. Ils sont classés en deux sous-familles dont le nombre exact de genres est controversé, certains experts n'en reconnaissant que trois. Leurs fossiles, datant de la fin du Crétacé, ont été retrouvés en Amérique du Nord et en Asie. Bien que descendant d'ancêtres de petite taille, les Tyrannosauridae étaient presque toujours les plus grands prédateurs de leurs écosystèmes respectifs, se trouvant ainsi au sommet de la chaîne alimentaire. La plus grande espèce ayant été identifié à ce jour est Tyrannosaurus rex, qui n'est autre que l'un des plus grands prédateurs terrestres connus, dont la taille est estimé jusqu'à environ 13 mètres de long et atteignant au maximum 14 tonnes en poids selon les estimations les plus récentes. Les Tyrannosauridae étaient des carnivores bipèdes à la tête massive et possédant de grandes dents. Malgré leur poids important, leurs membres postérieurs sont longs et adaptés à une marche rapide. En revanche, les membres antérieurs sont très petits et portent seulement deux doigts fonctionnels. Contrairement à la plupart des autres groupes de dinosaures, des restes très complets ont été découverts de la plupart des Tyrannosauridae connus. Cela a permis nombre de recherches diverses sur leur biologie. Des études ont ainsi mis entre autres l'accent sur leur ontogenèse, leur biomécanique et leur écologie, entre autres sujets. | |
|
Le Crapaud et le Maître d'école ou Contes d'automne et de printemps au Québec est le 15e long-métrage d'animation et le 11e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1949, il est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie (Le Fantôme du cavalier au Québec), inspirés respectivement du roman Le Vent dans les saules (1908) de Kenneth Grahame et de La Légende de Sleepy Hollow (1919) de Washington Irving. Le film présente les histoires de deux personnages fabuleux de la littérature anglo-saxonne. Le film est surtout connu comme étant la dernière des compilations du studio Disney produites durant les années 1940 avant la sortie en 1950 de Cendrillon. Malgré son manque de reconnaissance, la première séquence de ce film sert de base à une attraction d'un parc Disney et plusieurs des personnages ont été réutilisés dans d'autres productions. |
 Le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s’apparentant plus ou moins fortement à l’exercice d’une profession par un adulte. Au niveau international, l’Organisation internationale du travail (OIT) le définit en comparant l’âge à la pénibilité de la tâche, du moins pour les enfants de plus de douze ans. En pratique, parmi les enfants travailleurs, on distingue le travail « acceptable » (léger, s’intégrant dans l’éducation de l’enfant et dans la vie familiale, permettant la scolarisation) et le travail « inacceptable » (trop longtemps, trop jeune, trop dangereux, etc.) ; c’est ce dernier que recouvre généralement la notion de « travail des enfants ». On estime qu’environ 350 millions d’enfants sont concernés dans le monde ; plus de 8 millions se trouvent dans une des « pires formes de travail des enfants » : enfants soldats, prostitution, pornographie, travail forcé, trafics et activités illicites. Le travail des enfants est le sujet de nombreuses idées reçues dans le monde occidental, car il est surtout connu par les scandales médiatisés : un enfant au travail est vu typiquement comme un « enfant-esclave », dans un pays du tiers monde, employé dans un atelier textile asiatique pour une grande marque de vêtements ou enfant des rues en Amérique du Sud. En réalité, il y a des enfants au travail dans quasiment tous les pays du monde, y compris des pays développés comme l’Italie ou les États-Unis ; les usines et les ateliers textiles masquent le fait que plus des trois quarts de ce travail se trouve dans l’agriculture ou les activités domestiques, dans la sphère familiale ; et si les enfants-esclaves existent, ils ne forment qu’une minorité. Il existait aussi bien avant l’industrialisation ou la mondialisation, même si ces deux phénomènes ont rendu le travail des enfants plus visible. Si l’élimination des « pires formes de travail » n’est pas discutée, l’abolition est en revanche un sujet de débat pour les autres enfants ; la lutte contre la pauvreté et les mauvaises conditions de travail reste un objectif commun aux « abolitionnistes » comme aux organisations plus pragmatiques. Depuis 1992, le programme IPEC tente de fédérer les actions entreprises. | |
 Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, ou plus simplement Richesse des nations, est le plus célèbre ouvrage d’Adam Smith. Publié en 1776, c’est le premier livre moderne d’économie. Smith y expose son analyse sur l’origine de la prospérité récente de certains pays, comme l’Angleterre ou les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le « prix des marchandises en travail », les salaires, les profits et l’accumulation du capital. Il examine différents systèmes d’économie politique, en particulier le mercantilisme et la physiocratie. Il développe aussi l’idée d’un ordre naturel, le « système de liberté naturelle », résultant de l’intérêt individuel se résolvant en intérêt général par le jeu de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la liberté des échanges. La Richesse des nations reste à ce jour un des ouvrages les plus importants de cette discipline (pour Amartya Sen, « le plus grand livre jamais écrit sur la vie économique »). Il est le document fondateur de la théorie classique en économie comme sans aucun doute du libéralisme économique. |
 Le whisky (ou whiskey) est une eau-de-vie d’orge maltée, parfois additionnée de seigle, d'avoine, ou encore de maïs. La première trace de whisky en Écosse remonte à 1494 et on considère généralement que les moines de Dal Riada firent profiter les Écossais de leurs connaissances dans le domaine de la distillation lorsqu'ils vinrent évangéliser les Pictes de Calédonie. Le whisky venant d'Écosse est couramment appelé Scotch whisky, et cette appelation est protégée par une loi de 1988 stipulant que le scotch doit être distillé et vieilli en Écosse. On distingue cinq grandes régions qui produisent chacune des whiskies très reconnaissables : la Speyside, les Highlands, les Lowlands, les Îles et Campbeltown. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. | |
 Un document numérique est une forme de représentation de l'information consultable à l'écran d'un appareil électronique. L’affichage de ce type de document peut être apparenté soit au « document » même, ou soit à l’interface logicielle. Suivant l'intervention d'applications informatiques dans une partie de son contenu (bases de données, POO), les changements dans l'organisation logique de ses données peuvent être apportés. À l'inverse du document sur papier, qu'il soit manuscrit ou imprimé, le document numérique permet de séparer la présentation (les techniques de mise en page) de l'information (composition de texte, données). Des multimédias (image fixe ou animée, vidéo, son) peuvent être insérés à l’intérieur du document numérique. Sa technique de production et de communication se résume en quatre grandes familles de logiciels: les outils de traitement de texte, les tableurs, les logiciels de courriel, les logiciels de gestion documentaire. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |
L'université de Nîmes (anciennement Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes, appelé aussi UNÎMES), est une université située à Nîmes, dans le département du Gard, en France. Elle est créée en 2007 à partir d'un centre universitaire ouvert, lui, en 2002 ; elle est alors la cinquième université de l'académie de Montpellier. Les composantes de l'université sont réparties sur trois sites dans l'agglomération nîmoise. Son implantation principale est dans le fort Vauban, au nord du centre-ville de Nîmes, et elle dispose d'un site secondaire aux Carmes, dans le centre-ville, ainsi qu'une implantation dans le parc scientifique Georges Besse, au sud de l'agglomération. Un quatrième site, voué à devenir le site principal, doit entrer en service en 2013 dans l'est du centre-ville. L’université est pluridisciplinaire, et forme quelque 3 276 étudiants dans les domaines des sciences, du droit et de la gestion, ainsi que des lettres et des sciences humaines. Ses activités de recherches sont effectuées sous la tutelle d'autres établissements de la région. Elle est, par ailleurs, membre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur université Montpellier Sud de France depuis sa création en 2009. | |
 Anubis est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et patron des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou comme un homme à tête de canidé. La signification du mot Anubis, inpou en égyptien ancien, Anoub en copte, Ἄνουβις (Anoubis) en grec ancien, demeure obscure : de nombreuses explications ont été avancées, mais il peut s'agir simplement d'une onomatopée traduisant le hurlement du chacal. La forme canine du dieu a probablement été inspirée aux Anciens Égyptiens par le comportement des canidés, souvent charognards opportunistes errant la nuit dans les nécropoles à la recherche de cadavres. Les principales épithètes du dieu Anubis mettent en avant ses liens avec les grandes nécropoles du pays et son rôle de divinité funéraire qu'il y exerce. Son culte est attesté à travers tout le territoire égyptien depuis le XXXIIe siècle avant J.-C. et a été intense durant plus de trois millénaires pour ne s'éteindre qu'entre les IVe et VIe siècles de notre ère à la suite de l'essor du christianisme. Si Anubis est une divinité nationale, il est toutefois régionalement très lié aux XVIIe et XVIIIe nomes de Haute-Égypte et plus particulièrement à la ville de Hardaï, plus connue sous le nom grec de Cynopolis, la « ville du chien ». Les prêtres égyptiens sont à l'origine de multiples traditions relatives aux liens familiaux d'Anubis en faisant de lui le fils de la vache primordiale Hésat ou le fils de Rê avec Nephtys. Une version transmise par le grec Plutarque au IIe siècle de notre ère, fait de lui le fils adultérin de Nephtys avec Osiris. Quand ce dernier est assassiné et démembré par Seth, Anubis participe avec Isis et Nephtys à la reconstitution du corps d'Osiris, inaugurant par ce geste la pratique de la momification. Assigné à la surveillance du « Bel Occident » — un euphémisme pour le pays des morts —, Anubis accueille les défunts auprès de lui. Il momifie les corps afin de les rendre imputrescibles et éternels, il purifie les cœurs et les entrailles souillés par les turpitudes terrestres, il évalue les âmes lors de la pesée du cœur, puis accorde de nombreuses offrandes alimentaires aux défunts ayant accédé au rang de dignes ancêtres. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |
 L'appareillage électrique à haute tension est l'ensemble des appareils électriques qui permettent la mise sous ou hors tension de portions d'un réseau électrique à haute tension (y compris pour des opérations de délestage). L’appareillage électrique est un élément essentiel qui permet d’obtenir la protection et une exploitation sûre et sans interruption d’un réseau à haute tension. Ce type de matériel est très important dans la mesure où de multiples activités nécessitent de disposer d'une alimentation en électricité qui soit permanente et de qualité. L’appellation « haute tension » regroupe l'ancienne moyenne tension (HTA) et l'ancienne haute tension (HTB), elle concerne donc les appareils de tension assignée supérieure à 1 000 V, en courant alternatif, et supérieure à 1 500 V dans le cas de courant continu. Les applications industrielles des disjoncteurs à haute tension sont pour l'instant limitées au courant alternatif car elles sont plus économiques, il existe cependant des sectionneurs à haute tension pour liaisons à courant continu. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique | |
 Ferrari est un constructeur automobile italien installé à Maranello, en Italie. Fondé par Enzo Ferrari en 1947, il est considéré comme « la plus fameuse des marques de l'histoire de l'automobile ». Constructeur en série de sportives de prestige, Ferrari s'est rapidement imposé comme une référence automobile, aussi bien techniquement qu'esthétiquement. L'histoire de Ferrari est indissociable de celle de la Scuderia Ferrari, écurie automobile évoluant en Sport-Prototypes tout comme en Grand Tourisme — et plus tard en Formule 1 — depuis 1929, au sein de laquelle le constructeur a construit ses plus grands succès. Forte de son expérience en compétition, la marque au « cheval cabré » (« cavallino rampante ») y puise les techniques équipant ses modèles de série, comme en attestent les Ferrari 288 GTO, F50 ou encore Enzo, modèles aux performances exceptionnelles. De la 166 MM, première automobile d'Enzo Ferrari portant son nom, à la plus récente 458 Italia, Ferrari suscite toujours une « fascination irrésistible ». Enzo Ferrari aimait d'ailleurs décrire une automobile Ferrari comme l'« incarnation d'une belle mécanique pour les hommes qui ont le désir de se récompenser eux-mêmes, de réaliser un rêve et d'insuffler pendant longtemps encore à leur vie le feu de la passion juvénile ». |
 Un disjoncteur à haute tension est destiné à établir, prendre en charge et interrompre des courants sous sa tension assignée (la tension maximale du réseau électrique qu’il protège) à la fois :
Un disjoncteur est un appareil de protection essentiel d’un réseau à haute tension, car il est le seul capable d’interrompre un courant de court-circuit et donc d’éviter que le matériel connecté sur le réseau soit endommagé par ce court-circuit. | |
 La Biographie illustrée du moine itinérant Ippen (一遍上人絵伝, Ippen shōnin eden) est un ensemble d'emaki (rouleaux narratifs peints) japonais rapportant la vie d'Ippen (1234–1289), moine bouddhique fondateur de l'école amidiste Ji shū. Parmi les différents emaki portant ce titre, la version originale de 1299, nommée Ippen hijiri-e (一遍聖絵, « Peintures de la vie du saint homme Ippen »), est la plus réputée et la plus connue. Un deuxième emaki du XIVe siècle nommé Yugyō shōnin engi-e (遊行上人縁起絵), d'un style plus accessible, raconte également la biographie du moine. De nombreuses copies de ces deux emaki originaux ont été réalisées par la suite, l'ensemble étant donc souvent regroupé sous le terme d'Ippen shōnin eden. L'Ippen hijiri-e, version originale créée par Shōkai et peinte par En-I, se compose de douze rouleaux de soie, matériau très onéreux, alternant textes calligraphiés et peintures. Le style pictural et la composition des illustrations sont inédits dans l'art des emaki, s'inspirant tant du yamato-e japonais (le style traditionnel de la cour impériale) que du paysage chinois au lavis des Song et s'inscrivant dans les tendances réalistes de l'art de l'époque de Kamakura. De nos jours, l'œuvre demeure la plus ancienne biographie d'Ippen et présente un aperçu inestimable de la vie quotidienne, de la pratique religieuse ainsi que de nombreux paysages et lieux typiques du Japon médiéval, si bien qu'elle est grandement étudiée tant par les historiens que par les historiens de l'art. Elle est classée parmi les trésors nationaux du Japon. Le Yugyō shōnin engi-e, achevé entre 1303 et 1307 sous la conduite de Sōshun en dix rouleaux de papier, porte sur les biographies d'Ippen et surtout de son successeur Taa. Moins raffiné, il a une vocation prosélyte et vise à asseoir la légitimité de Taa comme cofondateur de l'école. Cette version, détruite de nos jours, nous est parvenue à travers ses diverses copies. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |
 Franklin Delano Roosevelt (ˈrəʊzəvelt), né le à Hyde Park (État de New York) et mort le à Warm Springs (Géorgie), était le 32e président des États-Unis. Figure centrale du XXe siècle, il fut le seul président américain à être élu à quatre reprises à partir de 1932 et à accomplir quatre mandats consécutifs. Confronté à la Grande Dépression, Roosevelt mit en œuvre le New Deal, un programme de relance de l’économie et de lutte contre le chômage. Il refonda le système bancaire et la Sécurité sociale. Il créa de nombreuses agences gouvernementales telles que la Works Progress Administration, la National Recovery Administration ou l’Agricultural Adjustment Administration. Il réussit à élaborer un nouveau mode de présidence, plus interventionniste et plus active grâce à son équipe de conseillers (Brain Trust). Roosevelt fut l’un des principaux acteurs de la Seconde Guerre mondiale et rompit avec l’isolationnisme traditionnel de son pays. Avant l’entrée en guerre des États-Unis, il lança le programme Lend-Lease afin de fournir les pays alliés en matériel de guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il assuma pleinement ses fonctions de Commandant en chef de l’Armée américaine et prépara largement la victoire des Alliés. Il tint un rôle de premier plan dans la transformation du monde au sortir du conflit. Critiqué par les uns, admiré par les autres, il a laissé une très forte empreinte dans l’histoire de son pays et celle du monde. | |
 Knoll est une entreprise américaine fabriquant du mobilier et matériel de bureau. Knoll est fondée en 1938 par Hans Knoll, un entrepreneur d'origine allemande. Avec son épouse Florence Knoll, il développe l'entreprise, et en fait l'une des plus créatives et prolifiques de l'après-guerre. Tous deux créent un « style Knoll » ; ils imposent leur vision de l'aménagement grâce au Planning Unit (service de planification), un service unique en son genre pour l'époque, mêlant architecture intérieure, design, production, textiles, graphisme. Après la mort de son mari en 1955, Florence remplace Hans à la tête de la société. En 1965, elle quitte à son tour l'entreprise. À l'instar d'Herman Miller, l'importance de Knoll dans le design du XXe siècle est considérable. Knoll travaille avec nombre d'architectes et designers notables de l'après-guerre, tels qu'Eero Saarinen, Isamu Noguchi, Frank Gehry et Ross Lovegrove. L'entreprise réédite un temps de grandes références du design, comme la chaise Wassily de Marcel Breuer et la chaise Barcelone de Ludwig Mies van der Rohe. De nombreux meubles fabriqués par Knoll font désormais partie de l'histoire du design. L'entreprise Knoll a son siège à East Greenville, en Pennsylvanie ; elle est cotée au New York Stock Exchange. Knoll compte plus de 4 000 employés, répartis sur les cinq continents. C'est l'un des acteurs majeurs du mobilier et de l'agencement de bureau. |
 Claude Piron (né en 1931 à Namur, Belgique,décédé le 22 janvier 2008 à Gland, Suisse) est un psychologue suisse très intéressé par les langues. Il est diplômé de l'École d'interprètes de l'université de Genève) et a été traducteur à l'ONU de chinois, d'anglais, de russe et d'espagnol. Après avoir quitté l'ONU, il travaille pour l'Organisation mondiale de la santé, entre autres en Afrique et en Asie. En 1968 il commence à pratiquer la psychothérapie, ce qu'il fait encore aujourd'hui à son cabinet de Gland (Suisse), s'occupant surtout de supervision de jeunes psys. Il a donné un enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève de 1973 à 1994. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto
| |
 La cinquième saison des Simpson a été diffusée pour la première fois aux États-Unis par la Fox entre le 30 septembre 1993 et le 19 mai 1994. En France, elle a été diffusée du 3 septembre 1994 au 4 février 1995. Le show runner de cette saison est David Mirkin qui a été le producteur exécutif de vingt épisodes. La saison contient également certains des épisodes les plus appréciés de la série par la critique, notamment Lac Terreur et Rosebud. Elle contient également le centième épisode de la série, Un ennemi très cher. La 5e saison marque également un tournant pour la série puisque l'équipe de scénaristes originale a en grande partie quitté le programme à la fin de la 4e saison. Un autre scénariste, Conan O'Brien, a quitté la série en cours de saison pour animer sa propre émission. La saison a été nommée pour deux Emmy Awards et a remporté un Annie Award pour le meilleur programme télévisé ainsi qu'un Environmental Media Award et un Genesis Award. Le coffret DVD de la saison est sorti en région 1 le 21 décembre 2004, en région 2 le 21 mars 2005, et en région 4 le 23 mars 2005. |
 Le canal de Panama est un canal important traversant l’isthme de Panama en Amérique centrale, reliant l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Sa construction a été un des projets d’ingénierie les plus difficiles jamais entrepris. Son impact sur le commerce maritime a été considérable puisque les navires n’ont plus eu besoin de faire route par le cap Horn et le passage de Drake à la pointe australe de l’Amérique du Sud. Un navire allant de New York à San Francisco par le canal parcourt 9 500 kilomètres, moins de la moitié des 22 500 kilomètres d’un voyage par le cap Horn. Bien que le concept d’un canal à Panama remonte au début du XVIe siècle, la première tentative de construction commença en 1880 sous l’impulsion française. Après que cette tentative eut échoué, le travail fut terminé par les États-Unis d’Amérique et le canal ouvrit en 1914. La construction des 77 kilomètres du canal a été parsemée de problèmes, incluant des maladies comme le paludisme et la fièvre jaune et des glissements de terrain. On estime à 27 500 le nombre d’ouvriers qui périrent pendant la construction. Depuis son ouverture, le canal a remporté un énorme succès et continue d’être un point de passage stratégique pour la navigation. Chaque année le canal permet le passage de plus de 14 000 navires transportant plus de 203 millions de tonnes de cargaison. Jusqu'à 2002, un total de 800 000 navires étaient passés par le canal. Des travaux d'élargissement du canal ont été lancés en septembre 2007 et devraient être terminés en 2014, permettant alors à des navires encore plus gros d'emprunter le canal. En 2007, la canal a été consacré l'une des sept merveilles du monde moderne. Autres articles sélectionnés au sein du portail Eau
| |
 Eero Saarinen est un architecte et designer américain d'origine finlandaise né le à Kirkkonummi et mort le à Ann Arbor. Fils d'Eliel Saarinen, architecte finlandais réputé, il émigre avec sa famille alors qu'il est adolescent. Après des études d’architecture, il rejoint le cabinet de son père, avec qui il collabore. Peu à peu, il gère ses propres projets et concours architecturaux. Il obtient notamment la construction de la Gateway Arch en 1948. À la mort d’Eliel Saarinen, il reprend les rênes de l’entreprise et multiplie les projets. Il conçoit une grande variété de bâtiments : des sièges sociaux de société, entre autres pour General Motors et Bell, des habitations privées, des bâtiments de facultés à l'université Yale et au Massachusetts Institute of Technology (MIT), des terminaux d'aéroport (Dulles, TWA Flight Center). Son style architectural évolue au fil des années, passant des formes rectilignes à des conceptions multipliant les courbes. Il conçoit aussi des meubles. Après avoir fait ses premières armes avec Charles Eames, il entame une collaboration à long terme avec la société Knoll, au sein de laquelle il crée notamment la chaise Tulipe. |
 La Berrichonne de Châteauroux est un club omnisports français fondé en 1883 et basé à Châteauroux. La section football débute ses activités au début des années 1900. La Berrichonne fusionne en 1920 avec l'Avenir Club de Châteauroux, puis en 1935 avec l'AS Châteauroux. Au cours de son histoire, le club effectue l'essentiel de ses saisons de l'après-Seconde Guerre mondiale aux deuxième et troisième échelons du football français, participant notamment à trente-six saisons de Division 2. En plus de cent-trente ans d'activité, le club n'a cependant atteint la première division qu'une fois lors de la saison 1997-1998. Avant la suppression de la rupture amateur-professionnel en 1970, La Berrichonne est un club majeur de la Ligue du Centre en remportant cinq fois le championnat de Division d'Honneur et une montée à chaque fois pour le Championnat de France amateur de l'époque dont une défaite en finale en 1964. En 1970, La Berri participe au premier championnat de Division 2 « open » mêlant amateurs et professionnels et s'y maintient jusqu'en 1985. Remonté en D2 en 1991, le club remporte le titre de deuxième division en 1997 et auparavant celui de National 1 en 1994 après une année en D3. La Berri atteint la finale de la Coupe de France 2004 mais s'incline face au Paris Saint-Germain (1-0). Le club dispute ses matchs à domicile au stade Gaston-Petit où il évolue en bleu et rouge. Il dispose depuis septembre 1995 d'un centre de formation. Thierry Schoen préside la structure professionnelle et l'équipe première, entraînée par Pascal Gastien depuis l'été 2014, évolue en Ligue 2 lors de la saison 2014-2015. | |
 David Scott, né le à San Antonio au Texas, est un militaire, pilote d'essai, astronaute et homme d'affaires américain. Il est le septième des douze hommes ayant foulé le sol lunaire à ce jour. Avant de devenir astronaute, Scott obtient son diplôme de l'Académie militaire de West Point et rejoint l'armée de l'air. Après avoir servi en tant que pilote de chasse en Europe, il est diplômé de l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force. Scott prend sa retraite de l'armée de l'air en 1975 avec le grade de colonel et plus de 5 600 heures de vol enregistrées. Scott est sélectionné comme astronaute dans le groupe 3 de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 1963. Il effectue son premier vol dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini 8, en compagnie de Neil Armstrong, en mars 1966, passant un peu moins de onze heures sur une orbite terrestre basse. L'astronaute passe ensuite dix jours en orbite en mars 1969 en tant que pilote de module de commande d'Apollo 9, une mission qui permet de tester de manière approfondie le vaisseau, aux côtés du commandant James McDivitt et du pilote de module lunaire Russell Schweickart. Après avoir été dans l'équipage de réserve d'Apollo 12, Scott effectue son troisième et dernier vol dans l'espace en tant que commandant de la mission Apollo 15, le quatrième alunissage humain et la première mission utilisant le rover lunaire Apollo. Scott et James Irwin restent sur la Lune pendant trois jours. Après leur retour sur Terre, Scott et ses coéquipiers tombent en disgrâce auprès de la NASA après un scandale lié à l'emport d'objets non autorisés sur la Lune. Après avoir occupé le poste de directeur du centre de recherche sur le vol Dryden de la NASA en Californie, Scott prend sa retraite de l'agence en 1977. Depuis, il travaille sur de nombreux projets liés à l'espace et a servi de consultant pour plusieurs films sur le programme spatial, notamment Apollo 13 (1995). Autres articles sélectionnés au sein du portail Forces armées des États-Unis |
 La Brabham BT19 est une monoplace de Formule 1 conçue par l'ingénieur australien Ron Tauranac pour l'écurie Brabham. La BT19 est engagée en 1966 et en 1967. Elle permet à Jack Brabham de remporter son troisième titre de champion du monde des pilotes, en 1966. Brabham fait souvent référence à la BT19 en l'appelant « [mon] vieux clou ». C'est la première monoplace à permettre à un pilote de remporter une course en Formule 1 sur une voiture portant son nom. Initialement construite pour accueillir un moteur Coventry Climax FWMV de 1 495 cm3, la monoplace ne prend aucun départ ainsi configurée. Quand, en 1966, la FIA décide de doubler la cylindrée des moteurs, qui passe ainsi à 3 000 cm3, Brabham Racing Organisation se tourne vers le motoriste Australien Repco. Il fournit à l'écurie un bloc moteur de type V8, dénommé Repco 620. Une divergence d'opinion entre Jack Brabham et Ron Tauranac conduit ce dernier à prendre une part moindre au développement de la voiture. Ainsi, une seule Brabham BT19 est fabriquée, et, de fait, est constamment développée au fil des courses pour rester performante. La Brabham BT19 est acquise en 2009 par Repco ; elle est visible au National Sports Museum de Melbourne, en Australie, et participe à de nombreux évènements.
| |
 La cathédrale Saint-Jean de Besançon recèle au total 35 toiles classées monuments historiques au sein même de l'édifice, dont des chefs-d'œuvre des artistes Fra Bartolomeo, Jean-François de Troy, Charles-Joseph Natoire ou encore Charles André van Loo. La majorité des œuvres fut exécutée au cours du XVIIe siècle, bien que certaines furent réalisées aux XVIIIe et XIXe siècles. Les plus grandes toiles sont accrochées dans l'abside du Saint-Suaire ainsi que dans la chapelle dite du Sacré-Cœur, mais d'autres œuvres sont également entreposées dans des salles non-ouvertes à la visite, rendant impossible leur contemplation. Actuellement, la cathédrale Saint-Jean est, à Besançon, l'édifice qui conserve le plus de toiles après le musée des beaux-arts et d'archéologie et loin devant l'église Sainte-Madeleine ou encore l'observatoire de la ville. |
 L’escadron des mamelouks de la Garde impériale est une unité de cavalerie légère d'origine égyptienne, créée par Napoléon Bonaparte à son retour d'Égypte, et en service dans l'armée française de 1801 à 1815. Ce corps est la troisième formation de cavalerie intégrée dans la Garde impériale et son premier élément étranger. Durant le Premier Empire, les mamelouks de la Garde impériale sont adjoints au régiment des chasseurs à cheval de la Garde impériale. Leur premier engagement d'envergure est la bataille d'Austerlitz, où ils enfoncent la cavalerie de la Garde impériale russe aux côtés des chasseurs à cheval et des grenadiers à cheval. Ils combattent ensuite à Eylau, avant de partir en 1808 pour l'Espagne. Ils prennent une part active à la répression du soulèvement du Dos de Mayo où ils livrent d'intenses combats contre les insurgés dans les rues de Madrid. Les mamelouks participent ensuite à la campagne d'Autriche en 1809, puis à celle de Russie en 1812, toujours à la suite des chasseurs à cheval. En 1813, ils constituent le 10e escadron des chasseurs et chargent à Reichenbach et Hanau. Ils sont toujours présents en 1814 lors de la campagne de France en affrontant les armées coalisées à Montmirail et à l'ultime bataille de Paris au sein de l'hétérogène brigade de cavalerie de la Garde du général Dautancourt. Après l'abdication de Napoléon, quelques mamelouks accompagnent l'Empereur déchu sur l'île d'Elbe tandis que la plupart des membres de l'unité entrent dans le corps royal des chasseurs à cheval de France. L'escadron est remis sur pied pendant les Cent-Jours et combat à Waterloo avec les chasseurs à cheval de la Garde. Au retour du roi, les véritables mamelouks sont finalement renvoyés au dépôt de Marseille, où ils sont presque tous assassinés au cours de la Terreur blanche de 1815. Les survivants accomplissent leur dernier fait d'armes en 1830, en participant en tant qu'interprètes à la conquête de l'Algérie, sous les ordres du maréchal Clauzel. Autres articles sélectionnés au sein du portail France au XIXe siècle
| |
 Le George Washington Masonic National Memorial est un édifice maçonnique situé à Alexandria en Virginie et construit en l'honneur de George Washington. Conçu par l'architecte américain Harvey Wiley Corbett selon plusieurs styles architecturaux, sa tour s'inspire de l'ancien phare d'Alexandrie en Égypte. Construit entre 1923 et 1932, il est inauguré en mai 1932 en présence du président Herbert Hoover et de très nombreuses personnalités politiques, religieuses et maçonniques. Les travaux d’aménagement et de décoration intérieure se poursuivent pendant plus de trente ans et se terminent à la fin des années 1970. Le mémorial porte la devise : « Pour inspirer l'humanité, à travers l'éducation, à imiter et promouvoir les vertus, le caractère et la vision de George Washington, l'homme, le maçon et Père de notre pays ». À l'opposé des pratiques maçonniques courantes, c'est le seul bâtiment maçonnique soutenu et maintenu par les 52 grandes loges des États-Unis et par plus de deux millions de francs-maçons américains qui souhaitent exprimer au travers du temps et dans la beauté l'estime indéfectible que les francs-maçons des États-Unis lui portent. L’initiative de la construction revient à l'association à but non lucratif Washington Monument Association d'Alexandria créée en 1900 par des citoyens et des francs-maçons américains. En 1909, elle prend le nom de « George Washington Masonic National Memorial Association » et met en œuvre le projet de construction et de réalisation du bâtiment. Après plusieurs évolutions du projet, qui passe d'un bâtiment mémoriel d'un étage et destiné principalement aux loges maçonniques, à un monument de 101 mètres de haut sur neuf étages, le coût total de sa construction atteint en 1942 les six millions de dollars. Inscrit dans la vie culturelle de la Virginie, le mémorial est entièrement ouvert au grand public depuis 1994. Il comprend plusieurs salles mémorielles, un musée, un théâtre, des temples maçonniques et des espaces dédiés aux associations maçonniques caritatives américaines. Il propose régulièrement des expositions temporaires sur des thèmes variés allant de l'archéologie à la peinture d'artistes internationaux. Des expositions pédagogiques permanentes sont mises en œuvre et animées par les organismes maçonniques, autour de l'histoire ou de la fonction de la franc-maçonnerie américaine. Le mémorial est inscrit sur la liste du National Historic Landmark depuis 2015. La George Washington Masonic National Memorial Association est toujours propriétaire et gestionnaire du site en 2016. ' |
 Roissy-en-France est une commune française, située dans le département du Val-d’Oise et la région Île-de-France. Les habitants sont appelés les Roisséens et les Roisséennes. Le nom de cette petite commune a été rendu mondialement célèbre à partir de 1974 par la présence de l’aéroport international qui porte son nom et occupe une partie de son territoire. Mais à l’écart des installations aéroportuaires, Roissy demeure un village caractéristique du Pays de France. Autres bons articles du portail Géographie
| |
|
Une rotation est un élément du groupe SO(3). Lire l'article |
 Bakar Bagration (né le ou le à Kharagaouli – mort le à Moscou ; en géorgien : ბაქარ ბაგრატიონი) est un monarque du royaume géorgien de Karthli, un général de la Perse séfévide et un diplomate russe du XVIIIe siècle. Membre de la dynastie des Bagrations de Moukhran, il dirige la Karthli comme régent pour son père (1716-1719) sous le titre persan de Chah Navaz Khan III (en persan : شاه نواز خان), puis comme roi à plein titre pendant près d’un an (1723-1724) sous le titre turc d’Ibrahim Pacha (en turc : İbrahim Paşa). Né en exil dans une dynastie qui gouverne la Karthli depuis 1658, il est le fils du futur roi Vakhtang VI et est associé aux affaires politiques du royaume dès un jeune âge. Il doit toutefois passer une partie de sa jeunesse de nouveau en exil quand son oncle Jessé impose un règne de terreur sous son règne de 1714 à 1716. À 16 ans, il est appelé par la Perse séfévide à gouverner la Karthli pendant l’activité politique de son père en Perse jusqu’en 1719, une période durant laquelle il bouleverse la puissante noblesse locale et impose de nombreuses réformes intérieures, avant de devoir laisser le trône à son père suite à une invasion des Lezghiens. En tant que partisan d’une politique pro-persane pour la Géorgie, le Chah Hossein le nomme commandant de sa garde impériale en 1722, mais son père lui interdit de venir en aide aux Séfévides quand ceux-ci font face à une invasion afghane. Le virement vers la Russie de l’orientation diplomatique de Vakhtang VI mène à une guerre brutale entre les forces persanes du Caucase et la famille royale, qui culmine avec le renversement de Vakhtang VI en 1723 malgré les efforts militaires de Bakar. En juin 1723, il retourne au pouvoir suite à l’invasion d’une coalition ottomane qui l’installe comme roi à Tiflis. Son règne est toutefois éphémère et le contrôle de facto de la politique karthlienne par l’Empire ottoman le pousse à entrer en rébellion contre son propre gouvernement et à mener une guérilla avec son père. Sans aide internationale et devant un ennemi puissant, Bakar et le reste de la famille royale s’exilent en Russie en juillet 1724 et fondent une large colonie géorgienne à Moscou. Bakar entre au service militaire et diplomatique de l’Empire russe et mène une grande partie de la politique impériale en Ciscaucasie. De nombreuses tentatives de le retourner sur le trône géorgien échouent suite au refus par la Russie de lui venir en aide et il devient prétendant au trône à la mort de Vakhtang VI en 1737. À Moscou, il mène une communauté géorgienne qui s’enrichit sous la protection du gouvernement russe et forme avec son frère Vakhoucht un centre culturel qui inclut une large imprimerie. | |
|
L’Empire State Building est un gratte-ciel de style Art déco situé sur l’île de Manhattan, à New York. Il est situé dans le quartier de Midtown au 350 de la 5e Avenue, entre les 33e et 34e rues. Inauguré le 1er mai 1931, il mesure 381 mètres (449 avec l’antenne) et compte 102 étages. Il est actuellement le plus grand building de New York (position qu’il a retrouvée suite à la destruction des tours jumelles du World Trade Center) et a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde. Le building tire son nom du surnom de l’État de New York, The Empire State, qui apparaît notamment sur les plaques d’immatriculation. lire la suite |
 Dimítrios Vikélas (grec moderne : Δημήτριος Βικέλας) est un homme d'affaires et un écrivain grec, né le 15 février 1835 ( dans le calendrier grégorien) à Ermoupoli dans l'île de Syros et mort le 7 juillet 1908 ( dans le calendrier grégorien) à Athènes. Il est le premier président du Comité international olympique (CIO). Après une enfance passée en Grèce, à Constantinople et à Odessa, il fait fortune à Londres, où il se marie. Il s'installe ensuite à Paris en raison de l'état de santé de son épouse. Ayant abandonné les affaires, il se consacre à la littérature et à l'histoire. Il publie de nombreux romans, nouvelles et essais qui lui valent une réputation certaine. Il fréquente les milieux littéraires et artistiques. Sa renommée et le fait qu'il habite Paris le font choisir pour représenter la Grèce à un congrès convoqué par Pierre de Coubertin en juin 1894. Ce congrès décide de rétablir les Jeux olympiques et de les organiser à Athènes en 1896, désignant Dimítrios Vikélas pour présider le comité d'organisation. Après les Jeux, il se retire à Athènes où il meurt en 1908. | |
 Les Anasazis sont des Amérindiens du Grand Sud-Ouest de l’Amérique du Nord. Ils étaient répartis en plusieurs groupes dans les États actuels du Colorado, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Leur civilisation a laissé de nombreux vestiges monumentaux et cultuels sur plusieurs sites, dont deux sont classés sur la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO. Ensuite, les vestiges retrouvés par les archéologues témoignent d'une maîtrise des techniques de la céramique, du tissage et de l'irrigation. Enfin, les Anasazis savaient observer le soleil et dessinaient des symboles restés mystérieux dans le désert. Aujourd'hui, les descendants des Anasazis, les Zuñis et les Hopis de l’Arizona et du Nouveau-Mexique perpétuent leur culture. |
 La statue de la Liberté (Statue of Liberty) est l'un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Officiellement La Liberté éclairant le monde, elle est située sur Liberty Island au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis Island. Elle est offerte par les Français en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations. L'inauguration de la statue est célébrée le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland. L'idée vient d'Édouard Laboulaye, juriste et professeur au Collège de France, en 1865. Le projet est confié en 1871 au sculpteur français Auguste Bartholdi. Le choix des cuivres devant être employés à la construction est confié à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a l'idée d'employer la technique du repoussé. En 1879, à la mort d'Eugène Viollet-le-Duc, Bartholdi fait appel à l'ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la structure interne de la statue. Ce dernier imagine un pylône métallique qui supporte les plaques de cuivre martelées et fixées. La statue fait en outre partie des National Historic Landmarks depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO depuis 1984. La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très important de la ville de New York, est devenue l'un des symboles des États-Unis, représentant de manière plus générale la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. Au plan architectural, la statue rappelle le Colosse de Rhodes, l'une des Sept Merveilles du monde antique. Elle constitue enfin l'élément principal du monument national de la statue de la Liberté, géré par le National Park Service (NPS). Autres articles sélectionnés au sein du portail Histoire de l'art
| |
|
Alfred Russel Wallace ( - ) est méconnu ; il est pourtant le co-découvreur de la théorie de l’évolution par la sélection naturelle avec Charles Darwin. Autodidacte, il commence sa carrière de zoologiste pour les collectionneurs de papillons sur le bassin fluvial de l’Amazone, puis dans l’archipel malais où il identifia la ligne Wallace séparant la faune australienne de celle de l’Asie. C’est au cours de ses expéditions qu’il va comprendre divers processus naturels qui vont l’amener à élaborer la théorie sur la sélection naturelle. Wallace fut également l’un des principaux penseurs évolutionnistes du XIXe siècle, contribuant au développement de la théorie de l’évolution grâce notamment au concept de couleurs d’avertissement chez les animaux ou à celui d’effet Wallace. Il fut aussi considéré comme un expert en matière de répartition géographique des espèces animales et est parfois appelé le « père de la biogéographie ». Wallace fut fortement attiré par les idées radicales. Sa défense du spiritisme et sa croyance en une origine immatérielle pour les plus hautes facultés mentales de l’être humain mit à mal ses relations avec le monde scientifique, tout spécialement avec les précurseurs de l’évolution. Il fut en outre l’un des premiers grands scientifiques à s’inquiéter des conséquences de l’activité humaine sur l’environnement. |
 Trevor Linden, C.M., O.C.B., (né le à Medicine Hat dans l'Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il fait ses débuts en tant que joueur junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest pour l'équipe de sa ville natale, les Tigers de Medicine Hat, lors de la saison 1985-1986. Avec les Tigers, il remporte la Coupe Memorial en 1987 et 1988 avant de rejoindre la formation des Canucks de Vancouver de la Ligue nationale de hockey qui le choisissent lors du repêchage d'entrée de 1988 en tant que deuxième joueur. Après un peu plus de neuf saisons avec les Canucks, il rejoint les Islanders de New York en 1998 mais n'y reste que jusqu'à la fin de la saison suivante. Au cours des saisons qui suivent, il joue pour différentes formations, Canadiens de Montréal puis Capitals de Washington avant de retourner jouer avec les Canucks en 2002. Il met fin à sa carrière à l'issue de la saison 2007-2008 après plus de mille matches joués en saison régulière dans la LNH et 867 points. Joueur international pour l'équipe du Canada, il remporte la médaille d'or lors du championnat du monde junior de 1988 puis celle d'argent avec l'équipe senior lors du championnat du monde 1991. Il participe également en 1998 aux Jeux olympiques et au championnat du monde. Suite à sa carrière sportive, les Canucks l'honorent en retirant son maillot et en accrochant son numéro 16 dans leur patinoire. Le 30 décembre 2010, il est annoncé qu'il est nommé membre de l'Ordre du Canada ; il est cité pour son esprit sportif et son engagement communautaire de leader respecté à la fois sur et hors glace. Autres articles sélectionnés au sein du portail Hockey sur glace
| |
 Le mannois (ou manxois) est une langue celtique appartenant à la branche des langues gaéliques, et parlée sur l’île de Man, en mer d’Irlande par environ 1700 personnes. Cette langue se différencia de l’erse (gaélique écossais) vers le XVe siècle. C’est une des langues officielles de l’île ; les lois doivent être proclamées en mannois et son enseignement a été mis en place dans les écoles. Ned Maddrell, mort en 1974, fut le dernier locuteur originel de la langue, avant l’apparition de la nouvelle génération de mannophones une vingtaine d’années plus tard. Ce démarrage fut surtout grâce aux efforts de plusieurs enthousiastes (notablement Brian Stowell) à un niveau local. Le mannois est maintenant reconnu comme langue régionale dans le cadre du Conseil britannique-irlandais et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Aujourd’hui 49 personnes le parlent comme langue maternelle (des enfants bilingues de naissance), et environ 1 689 le parlent comme seconde langue. Le mannois est beaucoup plus proche du gaélique d’Écosse que de celui d’Irlande. Il contient à la fois des traits archaïques (par exemple des mots anciens qui ont disparu en irlandais et en gaélique d’Écosse) et des innovations (en syntaxe, en phonétique, en morphologie). Son orthographe, originale, est basée surtout sur les conventions orthographiques de l’anglais, et n’a rien de commun avec l’orthographe des autres langues gaéliques. Mais les irrégularités sont nombreuses et il est difficile de savoir comment on prononce un mot que l’on ne connaît pas déjà. Pour cette raison, le mannois est reconnu avoir un système orthographique moins surprenant que celui des autres langues gaéliques. Mais l’orthographe des deux autres langues gaéliques obéit à une logique particulière qui finalement présente peu d’exceptions, tandis que celle du mannois est assez imprévisible. Lire l’article |
Lumière sur...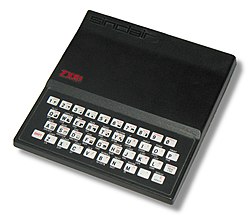 Sinclair Research Ltd., initialement nommée Sinclair Radionics (et qui portera plusieurs autres noms, cf. son historique), est une entreprise de matériel électrique, électronique et informatique anglaise, créée par Sir Clive Sinclair à Cambridge en 1961. Elle est principalement connue pour ses ordinateurs ZX80 et ZX81, qui ont été des pionniers dans l'informatique personnelle. Son catalogue comprenait en plus de l'équipement hi-fi, des calculatrices, des radios, etc. dont le point commun était l'innovation ou la taille réduite : la qualification de chaque produit comme étant le plus petit au monde est régulière dans le marketing de la marque. | |
 Babylone (akkadien : Bāb-ili(m), sumérien KÁ.DINGIR.RA, arabe بابل Bābil) est une ville antique de Mésopotamie située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. À partir du début du IIe millénaire av. J.-C., cette cité jusqu'alors d'importance mineure devient la capitale d'un royaume qui étend progressivement sa domination à toute la Basse Mésopotamie et même au-delà. Elle connaît son apogée au VIe siècle av. J.-C. durant le règne de Nabuchodonosor II qui dirige alors un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient. Il s'agit à cette époque d'une des plus vastes cités au monde, ses ruines actuelles occupant plusieurs tells sur près de 1 000 hectares. Son prestige s'étend au-delà de la Mésopotamie, notamment en raison des monuments célèbres qui y ont été construits, comme ses grandes murailles, sa ziggurat (Etemenanki) qui a inspiré le mythe de la tour de Babel et les jardins suspendus dont l'emplacement n'a toujours pas été identifié. Babylone occupe une place à part en raison du mythe qu'elle est progressivement devenue après son déclin et son abandon qui a lieu dans les premiers siècles de notre ère. Ce mythe est porté par plusieurs récits bibliques et également par ceux des auteurs gréco-romains qui l'ont décrite et ont ainsi assuré une longue postérité à cette ville, mais souvent sous un jour négatif. Son site, dont l'emplacement n'a jamais été oublié, n'a fait l'objet de fouilles importantes qu'au début du XXe siècle sous la direction de l'archéologue allemand Robert Koldewey, qui a exhumé ses monuments principaux. Depuis, l'importante documentation archéologique et épigraphique mise au jour dans la ville, complétée par des informations provenant d'autres sites antiques ayant eu un rapport avec Babylone, a permis de donner une représentation plus précise de l'ancienne ville, au-delà des mythes. Il n'empêche que des zones d'ombres demeurent sur l'un des plus importants sites archéologiques du Proche-Orient ancien, tandis que les perspectives de nouvelles recherches sont réduites du fait de la situation politique de l'Irak. |
 Carus (Marcus Aurelius Carus), né vers 222 et mort en , est empereur romain de 282 à sa mort. Les historiens antiques rapportent peu de choses sur son règne bref et sa biographie. Seule l'Histoire Auguste abonde en détails, notamment sur ses origines et ses débuts, qui ont été repris par les historiens pendant plusieurs siècles avant d'être réfutés à la fin du XIXe siècle. La connaissance de son accès au titre impérial en 282 est entachée d'incertitudes historiques sur les modalités de la succession de Probus. Peu après, il associe au pouvoir ses fils Carin puis Numérien. Son règne éphémère est marqué par trois faits : son origine narbonnaise, qui interrompt la série des empereurs illyriens à laquelle les premiers historiens modernes l'avaient rattaché à tort en se fiant à l'Histoire Auguste ; sa campagne contre les Sassanides, adversaires irréductibles de l'Empire romain, couronnée par la destruction de leur capitale, et perçue comme la revanche des précédents désastres romains ; sa mort soudaine sur les lieux de sa victoire, foudroyé dans sa tente selon la plupart des sources antiques. Ses fils Carin et Numérien lui succèdent et célèbrent sa divinisation, qui semble annulée ensuite par le martelage de son nom sur certaines de ses inscriptions honorifiques. Le règne est selon Christol marqué par « l'espérance d'un retour de la grandeur ». | |
 Les Annales des quatre maîtres ou, de façon plus complète, les Annales du royaume d'Irlande par les quatre maîtres (anglais : Annals of the Four Masters, A.F.M) sont des chroniques de l'histoire médiévale irlandaise. Les entrées couvrent la période allant du Déluge en 2242 de l'âge du monde, soit 2958 av. J.-C. à 1616 AD. Toutefois, les entrées les plus anciennes ne datent que de 550. Les annales consistent principalement en une compilation d'annales plus anciennes, bien qu'il y ait un peu de travail original. Cette compilation eut lieu entre 1632 et 1636 dans le monastère franciscain du comté de Donegal. Les entrées du XIIe siècle et précédentes ont été collectées dans de vieilles annales monastiques. Les entrées ultérieures ont été prises dans les registres de l'aristocratie irlandaise, comme les Annales d'Ulster, et enfin, les entrées du XVIIe siècle viennent de souvenirs et d'observations personnelles. Leur principal auteur est Mícheál Ó Cléirigh, assisté par Peregrine O'Clery, Fergus O'Mulconry, Peregrine O'Duignan et quelques autres. Bien qu'un seul d'entre eux, Mícheál Ó Cléirigh, fût véritablement franciscain, ils devinrent connus sous le nom des « quatre frères », ou, dans la version gaélique originale, Na Ceithre Maistir, qui devint dans la version anglaise « Les Quatre Maîtres », donnant leur nom à ces annales. Le mécène du projet fut Fearghal Ó Gadhra, un noble du comté de Sligo. |
 Thomas Andrews (né le et mort le ) est un architecte naval britannique qui a travaillé à la construction de plusieurs paquebots. Il grandit au sein d'une famille aisée, puis devient apprenti dans les chantiers navals Harland & Wolff de Belfast dont le président, Lord Pirrie, est son oncle. Pendant quelques années, Andrews gravit progressivement les échelons avant d'être nommé directeur général de l'entreprise. La réparation du paquebot de la White Star Line Suevic, à laquelle il participe, fait de lui un des architectes navals les plus renommés de son époque. En 1908, Andrews est chargé de superviser la construction de trois grands paquebots de classe Olympic pour la White Star Line. Ces paquebots se démarquent de leurs contemporains par leur taille et leur luxe. Pour l'architecte, ils représentent la consécration de sa carrière. Andrews prête d'ailleurs une attention particulière aux moindres défauts de son premier né, l’Olympic, afin de les corriger sur le deuxième navire, le Titanic. Après de nombreux mois de travail le Titanic entame son voyage inaugural le 10 avril 1912. Thomas Andrews embarque à bord avec son groupe de garantie, composé de huit ouvriers et ingénieurs chargés de prendre en note toutes les imperfections du paquebot. Cependant le 14 avril, le Titanic heurte un iceberg et l'architecte se rend très vite compte que son navire est condamné. Tout au long du naufrage, il participe à l'évacuation des passagers, en mène plusieurs aux canots et s'assure que tout le monde est en possession d'un gilet de sauvetage. De nombreux témoignages font état de son comportement au cours de cette nuit tragique. Andrews meurt dans le naufrage le 15 avril 1912, laissant derrière lui une femme et une petite fille de deux ans. En juin 1912, l'écrivain Shan Bullock signe une biographie faisant l'éloge de Andrews, et sa famille fait construire un mémorial en son honneur, dans sa ville natale. Son nom, ainsi que celui des hommes du groupe de garantie, figure également sur un mémorial érigé à Belfast en 1920. Enfin, le personnage de Thomas Andrews apparaît dans plusieurs documentaires et films consacrés au naufrage, dont le plus connu est celui de James Cameron, Titanic. Autres articles sélectionnés au sein du portail Irlande du Nord
| |
 Michelangelo Merisi da Caravaggio, en français Caravage ou Le Caravage, est un peintre né le à Milan et mort le à Porto Ercole. Son œuvre puissante et novatrice révolutionne la peinture du XVIIe siècle par son caractère naturaliste, son réalisme parfois brutal et l'emploi appuyé de la technique du clair-obscur allant jusqu'au ténébrisme. Il connaît la célébrité de son vivant, et influence nombre de grands peintres après lui, comme en témoigne l'apparition du caravagisme. Il obtient en effet un succès foudroyant au début des années 1600 : travaillant dans un milieu de protecteurs cultivés, il obtient des commandes prestigieuses et des collectionneurs de très haut rang recherchent ses peintures. Mais ensuite Caravage entre dans une période difficile. En 1606, après de nombreux démêlés avec la justice des États pontificaux, il blesse mortellement un adversaire au cours d'un duel. Il doit alors quitter Rome et passe le reste de sa vie en exil, à Naples, à Malte et en Sicile. Jusqu'en 1610, l'année de sa mort à l'âge de 38 ans, ses peintures sont en partie destinées à racheter cette faute. Toutefois, certains éléments biographiques portant sur ses mœurs sont aujourd'hui revus, car des recherches historiques récentes remettent en cause le portrait peu flatteur qui a été longtemps propagé par des sources du XVIIe siècle et sur lesquelles on ne peut plus désormais se fonder. Après une longue période d'oubli critique, il faut attendre le début du XXe siècle pour que le génie de Caravage soit pleinement reconnu, indépendamment de sa réputation sulfureuse. Son succès populaire donne lieu à une multitude de romans et de films, à côté des expositions et des innombrables publications scientifiques qui, depuis un siècle, en renouvellent complètement l'image. Il est actuellement représenté dans les plus grands musées du monde, malgré le nombre limité de peintures qui ont survécu. Toutefois certains tableaux que l'on découvre depuis un siècle posent encore des questions d'attribution. |
 PeaceMaker est un jeu vidéo développé par le studio américain ImpactGames, publié en pour Windows et Mac OS. Il s’agit d’une simulation géopolitique reproduisant le conflit israélo-palestinien. Classé parmi les jeux sérieux, il est souvent présenté comme « un jeu vidéo pour promouvoir la paix ». Le jeu est à l’origine un projet porté en 2005 par une petite équipe d’étudiants de l’université Carnegie Mellon. Deux d’entre eux fondent par la suite un studio de développement dans le but de terminer le projet. Le joueur incarne au choix le Premier ministre israélien ou le président de l’Autorité palestinienne. Il est confronté à des événements d’actualité, présentés avec des photos et des vidéos d’événements réels. Dans un système de jeu proche de la stratégie au tour par tour, il doit réagir et prendre les décisions politiques et militaires incombant à sa fonction. Le but du jeu est de résoudre le conflit pacifiquement par la solution à deux États. PeaceMaker a reçu des critiques positives de la presse spécialisée et grand public et a remporté plusieurs prix. Il fut salué pour la qualité de son système de jeu et la pertinence du traitement du conflit. Il est considéré comme un titre important pour la reconnaissance du jeu sérieux et devient un emblème du genre. Sa réelle portée éducative est jugée à même de permettre une meilleure compréhension du conflit israélo-palestinien et de promouvoir la paix. | |
| Wikipédia:Lumière sur/Modèle IS/LM |
 Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, situé à Vers-Pont-du-Gard entre Uzès et Nîmes, dans le département du Gard (France). Il enjambe le Gardon, ou Gard. Probablement bâti dans la première moitié du Ier siècle, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. D'après les dernières recherches, il aurait cessé d'être utilisé au début du VIe siècle. Au Moyen Âge, les piles du second étage furent échancrées et l'ouvrage fut utilisé comme pont routier. L'architecture exceptionnelle du pont du Gard attira l'attention dès le XVIe siècle, qui dès lors bénéficia de restaurations régulières destinées à préserver son intégrité. Un pont routier lui fut accolé en 1743-1747. Plus haut pont-aqueduc connu du monde romain, il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840 et a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en décembre 1985. | |
 Pierre Albaladejo, né le à Dax (Landes), est un joueur de rugby à XV international français qui évolue principalement au poste de demi d'ouverture des années 1950 jusqu'au milieu des années 1960, devenu ensuite commentateur sportif et homme d'affaires. Il compte trente sélections en équipe de France entre 1954 et 1964. Il marque 104 points. Il est capable de jouer des deux pieds, notamment lors de ses tentatives de drop. Fidèle au club de l'US Dax, il est un des acteurs de la victoire française lors de quatre Tournois des Cinq Nations (1954, 1960, 1961 et 1962). Il participe à la tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1961 et en Afrique du Sud en 1964. Il est finaliste du Championnat de France de rugby en 1956, 1961, 1963 et 1966. Pierre Albaladejo devient le premier consultant sportif à la radio en 1968. Il devient en janvier commentateur sportif sur Antenne 2 aux côtés de Roger Couderc. Après avoir travaillé avec Pierre Salviac, puis quitté France 2 en , il poursuit sa carrière de commentateur à la radio jusqu'en 2007. |
 Aavasaksa, en suédois Avasaksa, anciennement orthographié Avasaxa, est une colline de Finlande culminant à 242 mètres d'altitude dans la commune d'Ylitornio. Elle est située dans la région et province de Laponie, à quelques kilomètres au sud du cercle polaire arctique, et fait face à la frontière suédoise, délimitée par la rivière Torne, qui coule à l'ouest. Offrant depuis son sommet un large panorama de la nature lapone, elle constitue le point le plus méridional de Finlande permettant l'observation du soleil de minuit. Théâtre de l'expédition Maupertuis au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, la colline est ensuite utilisée comme repère dans l'arc géodésique de Struve au cours du XIXe siècle, ce qui lui vaut de faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005 aux côtés de 33 autres sites de mesures. Site touristique renommé depuis le milieu du XIXe siècle, elle accueille désormais des milliers de visiteurs chaque année. En raison de son intérêt historique et de sa localisation originale, elle a été classée parmi les 27 paysages nationaux de Finlande. Autres articles sélectionnés au sein du portail Laponie
| |
|
Le schéma de Jakobson est un modèle décrivant les différentes fonctions du langage. Il a été développé à la suite des études de Karl Bühler, dont le modèle se limitait aux fonctions émotive (expressive), conative et référentielle. D'après Roman Jakobson, « le langage doit être étudié dans toutes ses fonctions ». C'est-à-dire que le linguiste doit s'attacher à comprendre à quoi sert le langage, et s'il sert à plusieurs choses. « Pour donner une idée de ses fonctions, un aperçu sommaire portant sur les facteurs constitutifs de tout procès linguistique, de tout acte de communication verbale, est nécessaire ». Les voici :
Les six fonctions de la communication telles que les identifie Roman Jakobson sont chacune liées à un de ces éléments :
|
GNOME, acronyme de GNU Network Object Model Environment, est un environnement graphique libre convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Linux
| |
 Le commentaire littéraire est un des trois sujets proposés à l'écrit de l'épreuve anticipée de français de l'examen du baccalauréat en France, avec la dissertation et l'écriture d'invention. L'exercice est également pratiqué, dans une dimension davantage stylistique cependant, lors du cursus littéraire en université. Le commentaire littéraire, anciennement dénommé « commentaire composé » ou « commentaire de texte » est, selon le programme d'enseignement du français de l'Éducation nationale, « le lieu d’expression d’un jugement personnel sur un texte, dans un vocabulaire précis et pertinent qui permet de le caractériser dans sa spécificité ». Il doit faire ressortir la spécificité littéraire de l'extrait étudié, à travers une méthodologie rigoureuse. L'exercice est ancien, même s'il a été surtout institué depuis 1902. Le commentaire littéraire ne concerne que l'exercice proposé par les programmes du lycée, voie générale et technologique, depuis 1972. Noté sur 16 points, le coefficient est égal à 2, excepté dans la série littéraire où il est de 3. Le commentaire est une épreuve au choix à l'écrit, mais obligatoire à l'oral, quelle que soit la section d'enseignement... |
| |
 L'Íslendingabók (en latin : Libellus Islandorum - littéralement « Livre des Islandais ») est une œuvre littéraire islandaise du XIIe siècle, écrite par Ari Þorgilsson, prêtre et historien. Son ouvrage traite du début de l'histoire de l'Islande, de la colonisation au début du XIIe siècle. D'un style prosaïque et extrêmement concis, le texte est écrit en langue vernaculaire, le vieux norrois. Organisé en dix chapitres, l'Íslendingabók accorde une place importante à la christianisation de l'Islande et au développement de l'Église dans le pays. Le récit constitue également un « mythe des origines » pour les Islandais, en soulignant leur origine norvégienne. Bien qu'Ari ait écrit de nombreux autres ouvrages, l'Íslendingabók est celui qui l'a rendu célèbre, ses autres œuvres étant pour la plupart perdues. Le Livre des Islandais lui-même tel que nous le connaissons n'est qu'une deuxième version postérieure de quelques années à l'œuvre originale, perdue. Ouvrage fondateur de la littérature islandaise, qui inspira les sagas, il est également une source d'informations très précieuses sur l'histoire du pays. Autres articles sélectionnés au sein du portail Littérature norroise |
 Marc Girardelli, né le à Lustenau en Autriche, est un skieur alpin autrichien qui a représenté le Luxembourg en compétition de 1980 à 1997 au plus haut niveau international. Malgré un physique fragile (treize interventions chirurgicales au cours de sa carrière), il fait partie pendant plus de quinze ans des meilleurs skieurs de la Coupe du monde. D'abord spécialiste des disciplines techniques, il s'oriente en 1983 vers la polyvalence et devient en 1985, le premier skieur luxembourgeois a inscrire son nom au palmarès du classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Il se construit par la suite, un des plus beaux palmarès de son sport. Recordman du plus grand nombre de victoires au classement général qu'il remporte à cinq reprises en 1985, 1986, 1989, 1991 et 1993, il ajoute dix globes de cristal de spécialités (quatre en combiné, trois en slalom, deux en descente et un en géant) et quarante-six succès dans les cinq disciplines du ski alpin, un exploit que seuls Pirmin Zurbriggen, Günther Mader, Kjetil-André Aamodt et Bode Miller ont réalisé. De plus, Girardelli est le seul à avoir réalisé cette performance au cours d'une même saison, en 1988-1989 qui restera sa meilleure. Il y remporte neuf succès pour treize podiums et termine dans les cinq meilleurs au classement de chacune des cinq disciplines. Girardelli est également sacré champion du monde à quatre reprises entre 1987 et 1996. Médaillé d'or a trois reprises en combiné (1987, 1989 et 1996), il détient le record de titres dans la discipline en commun avec le Norvégien Kjetil Andre Aamodt. Il a également remporté un titre en slalom en 1991. Avec onze médailles mondiales, il devient en 1996 le skieur le plus médaillé en championnats du monde mais sera dépassé quelques années plus tard par Aamodt. Double médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'Albertville 1992 en super-G et géant, Girardelli n'est pas parvenu à remporter une médaille d'or en trois participations. Skieur autrichien d'origine, Girardelli a concouru sous les couleurs du Luxembourg à la suite d'un désaccord avec la fédération autrichienne. Il a dû pendant toute sa carrière s'entraîner seul accompagné de son père Helmut qui l'a managé et entraîné jusqu'à la fin de sa carrière, composant régulièrement avec de nombreux problèmes d'organisation et de manque de structures. Skieur souvent décrié pour son caractère introverti et distant, Girardelli a su gagner le respect de ses pairs grâce à ses performances qui ont fait de lui une personnalité incontournable du cirque blanc de la fin du XXe siècle. | |
|
L'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné. |
 La poussée d'Archimède est une force, telle que définie par la mécanique newtonienne, qui agit sur tous les corps solides plongés dans un fluide. Pour pouvoir l'appréhender plus facilement, elle est généralement décrite par une phrase qui stipule "Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé.". Cette force provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur (effet de la gravité sur le fluide, voir l'article hydrostatique) : la pression étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale orientée vers le haut. C'est à partir de cette poussée qu'on définit la flottabilité d'un corps. Cette force permet notamment aux bateaux de pouvoir flotter sur l'eau. Une légende court sur les circonstances de sa découverte: Archimède aurait eu l'intuition de cette relation alors qu'il était dans son bain en voyant son corps subir cette force, il aurait alors crié le célèbre « Eurêka ! » (j'ai trouvé !). | |
 Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire ou réchauffement global, est un phénomène d’augmentation de la température moyenne des océans et de l’atmosphère, à l’échelle mondiale et sur plusieurs années. Dans son acception commune, ce terme est appliqué au changement climatique observé depuis environ vingt-cinq ans, c’est-à-dire depuis la fin du XXe siècle. La plupart des scientifiques attribuent à ce réchauffement global une origine en grande partie humaine. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est chargé d’établir un consensus scientifique sur cette question. Son dernier et sixième rapport, résumant 14000 articles scientifiques du monde entier, affirme qu'il n'y a plus d'équivoque sur le fait que c'est l'humanité qui a réchauffé l’atmosphère, l’océan et les terres émergées. |
 Les Eucaryotes (Eukaryota) sont un domaine regroupant tous les organismes, unicellulaires ou multicellulaires, qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement d'organites spécialisés dans la respiration, en particulier mitochondries chez les aérobies mais aussi hydrogénosomes chez certains anaérobies. On le distingue classiquement des deux autres domaines que sont les Bacteries et des Archées (mais le clade des Eucaryotes s'embranche en fait parmi ces Archées). Les Eucaryotes rassemblent trois grands règnes du monde du vivant : les animaux, les champignons, les plantes, et d'autres (comme par exemple les algues brunes). Les Eucaryotes unicellulaires sont parfois regroupés sous le terme de « protistes » et les non-Eukaryotes sous la dénomination de « procaryotes » (ces deux derniers groupes étant paraphylétiques).
| |
|
La Xbox de Microsoft est une console de jeux vidéo sortie aux États-Unis le . Microsoft fait avec elle ses premiers pas dans ce secteur hautement concurrentiel, après avoir collaboré avec Sega pour porter Windows CE sur Dreamcast. Une différence majeure avec un PC est qu'une Xbox ne peut à l'origine exécuter que des programmes provenant d'un médium au format propriétaire Microsoft. Ce format n'est lisible que par le lecteur DVD de la Xbox. D'abord annoncée comme une console consacrée entièrement au jeu vidéo, Microsoft cherche à étendre le domaine de la Xbox vers une station multimédia interactive en ligne. Microsoft, ce faisant, veut offrir une première idée de la télévision interactive, ou iTV. En fin 2005, la Xbox 360 lui succéda. Elle concurrence la Nintendo Wii et la Sony PlayStation 3 dans la lignée des consoles septième génération. En date du 12 février 2013, 75,9 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. La Xbox One est une console de jeux vidéo de huitième génération développée par Microsoft. Dévoilée le , elle succède à la Xbox 360 et se place en concurrence frontale avec la PlayStation 4 de Sony, et plus indirectement avec la Wii U de Nintendo. Elle est disponible depuis le dans treize pays et depuis dans vingt-six autres pays. D'abord uniquement commercialisée avec Kinect, Microsoft propose la console seule à partir du . |
 La kaolinisation est l'altération d'une roche dont le résultat est le kaolin. Le substratum de cette falaise de Pénestin (dans l'image ci-contre) est constitué de micaschistes chloriteux sains, plissés et à foliation métamorphique. Vers le sud de la falaise, les produits d'altération sont plus fréquents et riches en kaolinite et en quartz résiduel :
Ces argiles riches en kaolinite et en quartz résiduel, blancs, gris ou ocres, sont apparus en Bretagne sous des climats chauds et humides (hydrolyse) à saisons contrastées (fin du Crétacé et début du Tertiaire : Yprésien à Lutétien). De grands profils d'altération de type latéritique avec de grandes quantités de kaolinite s'y sont développés. Lire l'article KaolinAutres articles sélectionnés au sein du portail Minéraux et roches
| |
 L’Empire byzantin ou Empire romain d'Orient désigne l'État apparu vers le IVe siècle dans la partie orientale de l'Empire romain, au moment où celui-ci se divise progressivement en deux. Il se caractérise par sa longévité : il puise ses origines dans la fondation même de Rome, et la datation de ses débuts change selon les critères choisis par chaque historien. La fondation de Constantinople, sa capitale, par Constantin Ier en 330, autant que la division d’un Empire romain de plus en plus difficile à gouverner et qui devient définitive en 395, sont parfois citées. Plus dynamique qu’un monde romain occidental dont l'administration effective est de plus en plus réalisée par les élites barbares à la suite de leur arrivée progressive par traité ou par conquête, l’Empire d’Orient s’affirme progressivement comme une construction politique originale. Indubitablement romain, cet empire est aussi chrétien et de langue principalement grecque. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Empire byzantin devient alors l'unique successeur de l'Empire romain en place. À la frontière entre l’Orient et l’Occident, mêlant des éléments provenant directement de l’Antiquité avec des aspects innovants dans un Moyen Âge parfois décrit comme grec, il devient le siège d’une culture originale qui déborde bien au-delà de ses frontières, lesquelles sont constamment assaillies par des peuples nouveaux. Tenant d’un universalisme romain, il parvient à s’étendre sous Justinien Ier (empereur de 527 à 565), retrouvant une partie des antiques frontières impériales, avant de connaître une profonde rétraction. C’est à partir du VIIe siècle que de profonds bouleversements frappent l’Empire byzantin. Contraint de s’adapter à un monde nouveau dans lequel son autorité universelle est contestée, il rénove ses structures et parvient, au terme d’une crise iconoclaste, à connaître une nouvelle vague d’expansion qui atteint son apogée sous Basile II (qui règne de 976 à 1025). Les guerres civiles autant que l’apparition de nouvelles menaces forcent l'Empire à se transformer à nouveau sous l'impulsion des Comnènes, avant d’être disloqué par la quatrième croisade lorsque les croisés s'emparent de Constantinople en 1204. S’il renaît en 1261, c’est sous une forme affaiblie qui ne peut résister aux envahisseurs ottomans ni à la concurrence économique des républiques italiennes (Gênes et Venise). La chute de Constantinople en 1453 marque sa fin. Tout au long de son histoire millénaire, une continuité autant que des ruptures rythment l’existence de l’Empire byzantin, objet complexe à analyser dans sa diversité. Héritier d’une riche culture gréco-romaine, il la fait vivre et contribue à la transmettre à l’Occident au moment de la Renaissance. Il développe sa propre civilisation, profondément empreinte de religiosité. Pilier du monde chrétien, il est le défenseur d’un christianisme dit orthodoxe qui rayonne dans l’Europe centrale et orientale où son héritage est encore vivace aujourd’hui, tandis que la séparation des Églises d'Orient et d'Occident inaugure une rupture progressive avec le catholicisme romain. Qualifié d’« archaïque » ou de « déclinant » dans l’historiographie ancienne, parfois empreinte de mishellénisme, l’Empire byzantin a fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation face aux évolutions du monde qui l’entoure et aux menaces qui l’assaillent constamment, souvent sur plusieurs fronts. Il parvient souvent habilement à user de la diplomatie autant que de la force pour contenir ses ennemis. Sa situation exceptionnelle, au carrefour entre l'Orient et l'Occident dont il contribue à brouiller les frontières, entre monde méditerranéen et bassin pontique, lui permet de développer une économie dynamique, symbolisée par sa monnaie, souvent utilisée bien au-delà de ses frontières. Cette même abondance suscite aussi les convoitises de voisins ambitieux qui se heurtent régulièrement aux puissantes murailles de Constantinople. Celle-ci, plus encore que Rome pour l’Empire romain antérieur, est le centre du monde byzantin. Même lors de son déclin à partir de 1204, il préserve une vivacité culturelle qui favorise l’émergence de la Renaissance européenne. Les jugements sur l’Empire byzantin ont profondément varié en fonction des époques. Considéré comme un modèle à suivre par les régimes absolutistes du XVIIe siècle, il est, au XVIIIe siècle, vivement dénoncé pour cette même raison par les critiques de l’absolutisme, et décrit comme décadent. Ces interprétations ont laissé place à des perspectives historiques plus scientifiques. L’héritage du monde byzantin est cardinal dans la compréhension du monde slave, auquel il a laissé un alphabet et une religion. Au-delà, il a su rayonner, transmettant un droit romain codifié, des chefs-d’œuvre architecturaux, incarnés par la basilique Sainte-Sophie, et, plus largement, une culture originale. Autres articles sélectionnés au sein du portail Monde byzantin |
 Le Marwari, ou Malani, est une race de chevaux originaire de la région de Mârvar (ou Jodhpur), en Inde. Il descend vraisemblablement de poneys autochtones indiens, croisés avec le cheval arabe, et peut-être des chevaux mongols. Les Rathores, chefs traditionnels de la région de Mârvar dans l'Ouest de l'Inde, sont les premiers à élever le Marwari. À partir du XIIe siècle, ils suivent des critères de reproduction stricts qui favorisent la pureté et la rusticité. Employé dans l'Histoire comme cheval de cavalerie par les habitants de la région de Mârvar, le Marwari est remarqué pour sa fidélité et sa bravoure au combat. La race s'est affaiblie dans les années 1930, lorsque de mauvaises pratiques de gestion ont entraîné une réduction du cheptel des reproducteurs. Elle retrouve désormais la popularité. En 1995, une première association d'élevage est formée pour le Marwari en Inde. Ce cheval est connu pour ses oreilles incurvées vers l'intérieur en forme de croissant de lune, particularité propre à certains équidés du sous-continent indien. De taille variable, il peut porter toutes les robes, bien que les patrons de robe pie soient plus populaires auprès des acheteurs et des éleveurs. Il est connu pour sa rusticité, et assez similaire à la race voisine du Kathiawari. De nombreux représentants vont l'amble naturellement. Le Marwari est utilisé pour la traction légère afin de réaliser divers travaux agricoles, aussi bien que pour l'équitation et comme cheval de bât. Depuis les années 2000, ces chevaux commencent à être exportés vers les États-Unis et en Europe. Ils restent rares, mais ne sont pas menacés d'extinction. Autres articles sélectionnés au sein du portail Monde équestre
| |
 Le château de Clementigney, plus connu sous le nom de château de la Juive est l'une des plus remarquables demeures particulières de Besançon (Franche-Comté). Il est situé sur la commune limitrophe de Chalezeule, à deux pas du quartier historique de Bregille et sur le bout du mont de Brégille. Le bâtiment de base a été construit à une date inconnue, mais les premières traces à son sujet remontent à la fin du XVIIIe siècle, avant que la puissante famille juive Lippman n'en devienne propriétaire. C'est d'ailleurs une de leur descendante, Léonie Allegri, qui demande à l'architecte franc-comtois Alphonse Delacroix de la transformer en un véritable château. Entre 1850 et 1870, il donne naissance au bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec son style gothique et son échauguette caractéristique. Le dynamisme de la propriétaire donne à la demeure son surnom toujours actuel, le « château de la Juive ». Par la suite, l'édifice change de main et devient un hôtel-restaurant réputé pour sa gastronomie de qualité et ses décors remarquables, gagnant une réputation nationale et attirant plusieurs célébrités. Cependant, cette vocation se termine au début des années 2000, lorsque le dernier chef cuisinier meurt, le château acquérant depuis lors une fonction purement résidentielle. |
 Abbey Road est le onzième album du groupe britannique The Beatles, sorti le en Grande-Bretagne et le 1er octobre aux États-Unis. Produit par George Martin, il a été principalement enregistré en juillet et aux studios EMI de Londres, renommés plus tard « studios Abbey Road » suite au succès retentissant de ce disque. Souvent cité comme un des albums les mieux construits et les plus influents de tous les temps, Abbey Road est aussi un immense succès commercial : 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, soit la deuxième meilleure vente du groupe après Sgt. Pepper. Le disque se distingue par la présence d'un medley sur la seconde face, une pièce longue de 16 minutes, succession de huit chansons qui s'enchaînent les unes après les autres. L'album est également marqué par le guitariste George Harrison, qui propose deux de ses plus fameuses compositions avec les Beatles, Something et Here Comes the Sun, et qui popularise l'utilisation du synthétiseur (Moog) dans le rock. La pochette de l'album reste une des plus célèbres de l'histoire de la musique, représentant les Beatles traversant un passage piéton au croisement entre Grove End Road et Abbey Road, face aux studios où ils ont enregistré presque toutes leurs chansons depuis 1962…
| |
|
| |
|
La musique indienne est, sous ses formes variées, l'expression d'une très longue tradition qui malgré le fait qu'elle ait été en partie divisée par l'éclatement du système colonial, reste néanmoins la musique d'un sous-continent composé de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka. Malgré les différences linguistiques ou religieuses, un même genre de musique se retrouve par delà les frontières politiques. Si sa connaissance en Occident progresse aussi bien sous sa forme savante (les râgas) que dans des genres plus légers (en particulier la musique de film), il reste un pan méconnu : l'immense domaine de la musique folklorique, chaque région ayant son style et ses instruments propres, voire des castes vouées à la pratique musicale, en particulier les États indiens tels que le Bengale, le Cachemire, le Kérala ou le Rajasthan. Lire l’article |
 Dans la mythologie grecque, Ampélos (en grec ancien : Ἄμπελος / Ámpelos, « vigne ») est un jeune satyre, éromène aimé de Dionysos. Sa mort donne naissance à la vigne et au vin. Ovide au Ier siècle, puis Nonnos de Panopolis au Ve siècle présentent deux versions assez différentes du mythe. La figure d'Ampélos emprunte vraisemblablement plusieurs caractéristiques de mythes antérieurs, et occupe dans l'univers dionysiaque une place particulière, proche d'un syncrétisme entre la mythologie et le christianisme antique. Les représentations d'Ampélos dans la statuaire et la céramique antiques sont rares et relativement peu assurées. Elles deviennent un peu plus fréquentes à l'époque baroque. Autres articles sélectionnés au sein du portail Mythologie grecque
| |
 Les attaques allemandes sur Nauru survenues en sont les raids de deux croiseurs auxiliaires de l'Allemagne nazie, des navires de commerce reconvertis en bâtiments de guerre par l'adjonction d'armement et maquillés en bâtiments civils contre les intérêts des Alliés dans le Pacifique central. Elles comptent parmi les premières opérations du conflit mondial dans la région, avant le déclenchement de la Guerre du Pacifique proprement dite. À cette époque, l'Empire du Japon n'est pas encore entré en guerre contre les Alliés et le Pacifique ne constitue qu'un théâtre marginal de la Seconde Guerre mondiale. Les attaques visent à porter un coup d'arrêt à l'exportation du phosphate de Nauru, une petite île d'Océanie administrée depuis 1914 par l'Australie. La flottille allemande composée de l’Orion, du Komet et du Kulmerland a pour intention d'opérer un débarquement sur l'île et d'y détruire les infrastructures essentielles. Les attaques se déroulent en deux temps : entre le 6 et le 8 décembre les bâtiments allemands coulent cinq cargos évoluant autour de l'île puis le 27 décembre l'un des croiseurs revient bombarder le port de Nauru et les structures attenantes. Les dégâts provoqués conduisent à l'arrêt temporaire des exportations du phosphate de Nauru et ont pour conséquence d'accroître les mesures de surveillance maritime dans toute la région. |
 Harlem est un quartier du nord de l'arrondissement de Manhattan, dans la ville de New York, aux États-Unis. Il se situe entre le nord de la 96e rue et Washington Heights. Toutefois, l'espace est officieusement délimité par la 110e rue au sud et par la 155e rue au nord. Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l'histoire de Big Apple : au début du XXe siècle, le mouvement de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal foyer de la culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des centres de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a longtemps été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent les Afro-Américains. | |
 Les Poncas sont un peuple amérindien d'Amérique du Nord vivant dans les États actuels du Nebraska et de l'Oklahoma. Ils font partie de la branche des Dhegihas qui forment avec entre autres les Chiweres et les Winnebagos, l’ethnie Sioux. Originaires de la côte atlantique américaine, les Poncas ont migré au XVIe siècle à l'intérieur des terres pour finalement s'installer entre la Niobrara et le Missouri. Petite tribu, par son nombre d'individus, les Poncas sont néanmoins rentrés dans l'Histoire des Amérindiens d'Amérique du Nord par l’intermédiaire d'un de leurs chefs, Standing Bear, qui, à la fin du XIXe siècle, s'opposa à la politique gouvernementale de déplacement des tribus dans le Territoire indien. En 1879, une cour de justice reconnait qu'« un Indien est un homme », ce qui permet à Standing Bear et les siens de jouir de l'habeas corpus. Une partie des Poncas suivra Standing Bear dans le Nebraska tandis que l'autre restera sur ses terres de l'Oklahoma. Ainsi, la seule ethnie des Poncas forme aujourd'hui deux tribus distinctes : les Poncas du Nord et les Poncas du Sud. Depuis les années 1980, les deux tribus essaient de renforcer leurs liens afin de faire perdurer leur culture commune. |
 La Compagnie d'Hasnon est une société de recherche de houille créée en 1837 qui exécute quelques sondages et ouvre sans succès trois fosses en 1839 et 1840 à Hasnon et Wallers, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Elle a également possédé 25 % de la Compagnie de Vicoigne de 1841 à 1843. En février 1843, la troisième fosse tentée est abandonnée. La Compagnie tente fin 1843 et début 1844 deux derniers sondages, mais les résultats ne sont pas probants et les activités cessent en 1845, date à laquelle la Compagnie d'Hasnon cesse d'exister. Inexploitée, la concession est par la suite reprise par la Compagnie des mines d'Anzin, qui avait déjà racheté les parts de la Compagnie de Vicoigne que possédait la Compagnie d'Hasnon en 1843, et laisse la concession en sommeil jusqu'aux alentours de 1875, date à laquelle elle tente, sans succès, d'ouvrir une fosse. Plus aucune autre exploration n'a ensuite eu lieu sur la concession d'Hasnon. | |
 La bataille de la crête de Verrières est une bataille de la campagne de Normandie de la Seconde Guerre mondiale qui se déroula du 19 au . Située dans le Calvados, en France, elle opposa deux divisions d’infanterie canadiennes appuyées par la 2e brigade blindée canadienne du côté allié, à des éléments de trois divisions SS allemandes de Panzers. La bataille fut une des tentatives britanniques et canadiennes pour desserrer la pression allemande sur Caen. Elle fit partie des opérations Atlantic (18 – 21 juillet) et Spring (25 – 27 juillet). L’objectif principal des Alliés était la crête de Verrières, une position surélevée qui dominait la route Caen-Falaise. La crête était défendue par des vétérans allemands qui avaient été repoussés de Caen et qui y avaient établi une solide position défensive. Durant les six jours que dura la bataille, des forces britanniques et canadiennes importantes tentèrent à plusieurs reprises de s’emparer de la crête. Le respect par les Allemands des doctrines défensives et les puissantes et efficaces contre-attaques par les formations de Panzer firent subir de lourdes pertes aux Alliés qui n’obtinrent pas de réel gain stratégique. Au Canada, la bataille est citée en exemple pour les erreurs tactiques et stratégiques qui la caractérisent, la plus notable étant l’attaque controversée du Royal Highland Regiment (Black Watch) of Canada le 25 juillet. Aucun bataillon canadien n’avait subi de pertes aussi élevées sur une seule journée depuis le raid sur Dieppe de 1942. Cet assaut est l’un des événements les plus controversés et critiqués de l’histoire militaire canadienne. |
 Tukutuku rakiurae, nommé Hoplodactylus rakiurae jusqu'en 2011 et parfois appelé gecko arlequin, est une espèce de gecko de la sous-famille des diplodactylinés. Le genre Tukutuku est monotypique alors que Hoplodactylus regroupe classiquement une dizaine d'espèces. Particulièrement adaptée au climat frais de l'île Stewart, en Nouvelle-Zélande, où elle est endémique, cette espèce fait partie des geckos ayant l'aire de répartition la plus méridionale du monde. Discrète et vivant dans des endroits peu accessibles à l'homme, elle reste assez peu connue de la communauté scientifique, sa taxinomie étant notamment toujours sujette à débat. Elle est protégée par les lois néo-zélandaises et conventions internationales. | |
 Grasse, « capitale mondiale des parfums », est une commune française du département des Alpes-Maritimes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nommée Grassa ou Grasso en provençal. Les premières traces de présence humaine dans le pays de Grasse datent du Néolithique mettant en évidence une population plus importante qu’ailleurs. Ligures, Grecs puis Romains s'y installent, chassés successivement par les Burgondes, les Ostrogoths, les Francs et les Lombards. Lors du rattachement de la Provence au Royaume de France Grasse refuse de faire allégeance et rejoint le Royaume de Lombardie, celui de Bourgogne puis celui d’Arles qui la délivre des Arabes. Les Grassois rejètent le régime féodal et abolissent le servage. Une aristocratie de consuls se forme et prend le pouvoir. En 1171 et 1179, Grasse signe les premiers traités politiques et commerciaux avec Gênes et Pise pour l'exportation et l'importation de toiles, cuirs, blé, peaux brutes, peaux tannées, vin et bétail. Cette importance grandissante attire l’attention du Comte de Provence qui prend la ville en 1220 et la rattache au comté en lui octroyant cependant de nombreux privilèges. L’artisanat de la tannerie est la principale activité économique et commerciale. En 1482, Louis XI annexe la Provence et Grasse devient française. Pendant la Renaissance, Charles Quint pille et incendie la ville. Grasse prend position en faveur d’Henri IV et de l'édit de Nantes dans les guerres de religion. Durant le XVIIe siècle, c’est l’apogée de l’industrie de la tannerie, mais aussi le début de celle du parfum et des « gants parfumés ». Des hôtels particuliers sont construits pour la noblesse provençale. Lors de la division de la France en 83 départements par l'assemblée Constituante, en janvier 1790, Grasse fait partie du département du Var dont elle sera la préfecture de 1793 à 1795. Grasse est alors une ville de tradition opportuniste et commerçante. Une guillotine est installée où sont exécutés trente « ennemis du peuple » et de nombreux Grassois sont emprisonnés pour avoir montré leur hostilité à la Révolution. Le XIXe siècle est un siècle de prospérité. Le parfum se développe et Grasse devient « capitale mondiale des parfums ». De grandes usines apparaissent, signe d’adhésion à la Révolution industrielle. La Princesse Pauline y séjourne en 1811, de riches étrangers construisent de magnifiques villas et la ville s’enrichit. En 1860 l'arrondissement de Grasse est rattaché au département des Alpes-Maritimes. Au XXe siècle, Grasse garde sa réputation touristique et l’industrie des parfums se transforme et se modernise. |
Jules Massenet est un compositeur français né à La Terrasse, près de Saint-Étienne, le 12 mai 1842 et mort à Paris le 13 août 1912. Benjamin d'une famille de douze enfants, Jules Massenet entre au conservatoire de Paris à onze ans, obtient un premier prix de piano en 1859 puis remporte le Grand Prix de Rome en 1863 grâce à sa cantate David Rizzio. Il rencontre à cette occasion Franz Liszt qui lui demande de le seconder dans ses tâches d'enseignement. Trois ans plus tard, il regagne Paris et y connaît ses premiers succès avec les opéras : La Grand'tante, Don César de Bazan, Marie-Magdeleine et Le Roi de Lahore. En 1878, il est nommé professeur au Conservatoire et compte Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Georges Enesco, Henry Février, Charles Koechlin, Albéric Magnard, Gabriel Pierné et Florent Schmitt parmi ses élèves. En 1884 est créé un de ses opéras les plus populaires, Manon, d'après le roman Manon Lescaut de l'Abbé Prévost. Parmi ses autres œuvres célèbres, Don Quichotte, Hérodiade, Le Cid, Le Jongleur de Notre-Dame et plus encore, Werther, d'après Les Souffrances du jeune Werther de Goethe. Thaïs ne connut le succès qu'une décennie après sa création en raison de son sujet sulfureux, malgré sa superbe Méditation religieuse pour violon solo au deuxième acte, connue sous le nom de Méditation de Thaïs. L'influence de Massenet se ressentira chez de nombreux compositeurs tels Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini ou Claude Debussy dans son Pelléas et Mélisande. Lire l’articleAutres articles sélectionnés par le portail Opéra
| |
 Le monastère royal de Saint-Bernard, plus connu sous le nom de couvent des Feuillants, était un monastère parisien fondé en 1587 par Henri III pour les religieux de l'ordre cistercien réformé des Feuillants. Situés rue Saint-Honoré, derrière les actuels no 229-235 de cette rue, près de l'angle de l’actuelle rue de Castiglione, ses bâtiments ont été rasés au début du XIXe siècle. Sécularisé et nationalisé en 1790, le couvent servit notamment de lieu de réunion à un éphémère rassemblement politique, le club des Feuillants. |
 Archaeopteryx (« aile antique », en français archæoptéryx ou archéoptéryx) est un genre fossile de dinosaures à plumes disparus. Ces dinosaures aviens, d’une longueur inférieure à 60 cm, ont vécu à la fin du Jurassique, il y a 156 à 150 Ma dans un environnement alors insulaire, qui se situe actuellement en Allemagne. L'archéoptéryx a été le tout premier fossile découvert avec des plumes bien conservées, longtemps considéré comme le plus ancien oiseau fossile. Sa position phylogénétique reste controversée, même 150 ans après sa découverte. Une publication de 2011 place, par exemple, l'archéopteryx et les autres Archaeopterygidae plus proches des deinonychosaures que des oiseaux. Cependant, à la suite de la découverte en 2013 d'un nouveau fossile à plumes (nouveau genre, nouvelle espèce), une équipe de paléontologues propose de rétablir l'archéoptéryx dans son statut antérieur (voir le chapitre Des propositions controversées). En 2018, l'étude d'un fossile d'archéoptéryx à l'European Synchrotron Radiation Facility révèle que bien qu'il ne pratiquait pas le vol battu des oiseaux modernes, il pouvait faire un vol actif en se propulsant avec ses ailes. Les découvertes des différents spécimens d'archéoptéryx ont largement contribué à la construction de la théorie la plus courante de l'histoire évolutive des oiseaux, à savoir que les oiseaux descendent des dinosaures de l'ordre des théropodes. | |
 L’hérésie d'Orléans est une hérésie savante rapportée par plusieurs textes et chroniques du XIe siècle selon lesquels, en 1022, une douzaine des plus érudits parmi les chanoines de la cathédrale d'Orléans, liés notamment à l'entourage de la reine Constance d'Arles, furent brûlés comme hérétiques sur ordre du roi capétien Robert le Pieux. Il s'agit du premier bûcher de la chrétienté médiévale. Leur doctrine remettait en cause le rôle de la grâce et donc les sacrements qui la confèrent ; elle privilégiait une quête spirituelle intérieure accompagnée d'un ascétisme rigoureux. C'était une manière pour les hérétiques de contester l'autorité épiscopale, dont les préoccupations laïques étaient de moins en moins tolérées dans le cadre d'un mouvement de réforme de l'Église qui recueillait un large consensus au sein de la société médiévale. Mais, par leur radicalité, ces innovations théologiques allaient bien au-delà de la rénovation de l'Église et impliquaient un bouleversement majeur de l'organisation sociale de la chrétienté médiévale d'Occident. C'est pourquoi les autorités laïques et ecclésiales en place prirent soin, par un jugement et un châtiment exemplaire, de stigmatiser avec force les déviances de ces intellectuels orléanais. En outre, l'affaire d'Orléans se place dans le contexte d'un conflit de pouvoir majeur autour de l'évêché entre le roi de France Robert le Pieux et le comte de Blois Eudes II : si Orléans était cité royale et l'une des principales résidences du roi, les comtes de Blois, ses puissants voisins, étaient néanmoins tentés d'y imposer leur influence pour mieux relier les différents éléments de leur domaine. Cela pouvait passer par le contrôle du siège épiscopal et c'est d'ailleurs ce qui se déroula lors du synode de 1022 : sa première tâche consista à déposer l'évêque en place, nommé avec le soutien du roi dix ans plus tôt, pour le remplacer par son concurrent malheureux d'alors, un homme du comte de Blois. |
 Le massacre de Qibya (ou Kibiah ou Kibié), également connu sous le nom d’opération Shoshana (nom donné en mémoire d’une des victimes juives de l’attentat qui déclencha l’opération), fait référence à une action de représailles menée par l’Unité 101 de l’armée israélienne contre le village transjordanien de Qibya dans la nuit du 14 au et qui fit 70 victimes. À l’époque, l’opération est unanimement réprouvée dans le monde et fait l’objet d’une condamnation du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle est perçue comme le début de la politique controversée de représailles systématiques toujours appliquée aujourd’hui par Israël. Autres articles sélectionnés au sein du portail Palestine
| |
 Le parc national de Kaziranga est un parc national situé dans les districts de Golaghat et Nagaon de l'État d'Assam en Inde sur le bord est de l'Himalaya. Ce parc est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux tiers de la population de rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis) y vivent, et on y trouve la plus grande densité de tigres au monde, d'où son classement parmi les Tiger reserves en 2006. Le parc dispose d'importantes populations reproductrices d'éléphants, de buffles d'eau et de barasinghas. Kaziranga est en outre une ZICO. Kaziranga est une vaste étendue de hautes roselières, de prairies d'herbe à éléphants, de marécages et d'une forêt tropicale semi-sempervirente irriguée par quatre grandes rivières, dont le Brahmapoutre et ses nombreux bras morts. Kaziranga a été le thème de plusieurs livres, de documentaires et de chansons. Le parc a fêté son centenaire en 2005, après son classement en Reserved forest en 1905. |
 Martin Fréminet (Paris, 24 septembre 1567 – Paris, 18 juin 1619), est un peintre maniériste français, membre de la seconde École de Fontainebleau, et actif au début du XVIIe siècle. Après un voyage en Italie à la fin du XVIe siècle, Fréminet revient en France en 1603, et se voit confier la réalisation des décors de la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau, œuvre maîtresse de sa carrière, aboutissement de ses recherches et de ses influences, et qui le place comme l'un des derniers maîtres de l’école bellifontaine. Essentiellement peintre de scènes religieuses, rares sont les œuvres sûrement exécutées par sa main, car à l'exception des décors de la voûte de la chapelle de Fontainebleau, seules quelques toiles (parmi lesquelles une Adoration des bergers du musée de Gap et une Charité de saint Martin conservée au musée du Louvre) lui sont attribuées avec certitude. Son style puissant et coloré doit beaucoup à son admiration pour l'œuvre de Michel-Ange, du Parmesan, et sa découverte de l'école vénitienne. | |
 Les juifs (Hébreu : יְהוּדִים, Yëhûdîm ; Yiddish : ייִדן, Yiden ; Ladino ג׳ודיוס, Djûdios) sont les adhérents au judaïsme. Ce sont aussi, avec une majuscule (Juifs), les membres du peuple juif ('am yëhûdî), également appelés enfants d'Israël.
Ils forment un groupe dont la définition recoupe partiellement les catégorisations usuelles de groupe culturel, ethnique, national ou religieux. Ils se composent des descendants des anciens Israélites de Judée ainsi que des personnes converties au judaïsme au cours des siècles. La définition que les Israélites puis les Juifs ont donné d'eux-mêmes a varié dans le temps. L'idée que les Juifs sont un peuple, le « peuple d'Israël », apparaît dès les premiers livres de la Bible, et a continué à être affirmée au cours des siècles. La définition religieuse a par contre évolué, l'archéologie décrivant des Israélites polythéistes aux périodes les plus anciennes. L'idée de « royaume d'Israël », qui date de la Bible, a également varié dans le temps, ayant été largement mise de côté par les autorités religieuses à compter du IIe siècle, avant d'être réintroduite par des laïques et quelques religieux sous la forme du sionisme au XIXe siècle. Enfin, des cultures juives très diversifiées dans l'espace et le temps ont encore complexifié l'approche de l'identité juive. Le nombre total de Juifs est difficile à estimer avec précision, et fait l'objet de controverses. Selon un recensement effectué en 2002, il serait d'environ 13 millions, la majorité vivant en Amérique du Nord, en Europe et en Israël. Autres articles sélectionnés au sein du portail du peuple juif dans l'Antiquité |
 Les timbres postaux de la République d'Irlande sont publiés par l'autorité postale de la République indépendante d'Irlande. Le tout premier modèle, un timbre vert foncé d'une valeur de 2d (ancien pence), figurait une carte de l'île incluant l'Irlande du Nord, restée intégrée au Royaume-Uni. Depuis lors, au gré des besoins du pays et des changements de monnaie, de nouvelles images et de nouvelles valeurs ont façonné un total de neuf séries courantes, la dernière datant de 2004. Les timbres commémoratifs, apparus en 1929, sont émis de nos jours à raison de plusieurs séries annuelles. Ils éclairent divers aspects de la vie irlandaise (événements importants, dates anniversaires, coutumes, personnages irlandais illustres). En plus de la présentation traditionnelle en feuille prédécoupée, les timbres courants aussi bien que les timbres commémoratifs sont publiés sous forme de carnets, de rouleaux et de blocs-feuillets. Les timbres-taxe, les timbres de poste aérienne et les entiers postaux complètent la production de timbres en Irlande.
| |
 Le taoïsme (道教 dào jiào « enseignement de la Voie ») est à la fois une philosophie et une religion chinoise. Plongeant ses racines dans la culture ancienne, ce courant se fonde sur des textes, dont le Dao De Jing (tao te king) de Laozi (Lao-tseu), et s’exprime par des pratiques, qui influencèrent tout l’Extrême-Orient. Il apporte entre autres :
Ces influences, et d’autres, encouragent à comprendre ce qu’a pu être cet enseignement dans ses époques les plus florissantes. Lire l'article |
 A Free Ride, également connu sous le titre A Grass Sandwich, est un film pornographique américain réalisé à une date non précisément connue, entre les années 1910 et 1920. Le nom du réalisateur et des interprètes sont également inconnus. Massivement diffusé au moment de « l'ère du stag film » — sous-genre de films pornographiques muets produits anonymement et diffusés clandestinement —, il est considéré comme le premier film pornographique hardcore américain. Il représente un automobiliste qui accueille à son bord deux femmes marchant sur le bas-côté de la route et se livre plus tard à plusieurs actes sexuels avec elles. Une datation du tournage du film en 1915 fait consensus pour la plupart des chercheurs, bien que des dates ultérieures dans les années 1910 ou 1920 soient parfois avancées. Le lieu de tournage n'est pas connu, bien qu'il puisse se situer dans le New Jersey selon plusieurs travaux. Le réalisateur du film a utilisé un pseudonyme et le casting est resté anonyme : certaines sources suggèrent qu'il s'agit de personnes à faible statut social, quand d'autres affirment le contraire. Par son statut historique, le film connaît une notoriété pendant près d'un siècle après son tournage. Autres articles sélectionnés au sein du portail Pornographie
| |
 La bataille de Grunwald, (de nos jours Stębark en Pologne) a eu lieu 15 juillet 1410 entre l'ordre des ordre des chevaliers teutoniques avec quelques chevaliers d'Europe de l'Ouest et une coalition de la Pologne, de la Lituanie, des mercenaires bohémiens et des Tartares. Elle est appelée aussi bataille de Zalgiris par les Lituaniens et première bataille de Tannenberg par les Allemands. Lire l’article |
 Le siège de Hambourg se déroule de décembre 1813 à mai 1814, à la fin des guerres de la Sixième Coalition. La garnison française de Hambourg, commandée par le maréchal Davout, y résiste victorieusement pendant près six mois aux troupes coalisées de la Prusse, de la Russie et de la Suède. Isolé du principal théâtre d'opérations de la campagne d'Allemagne par la défaite du maréchal Oudinot à la bataille de Gross Beeren, le 13e corps du maréchal Davout regagne la région de Hambourg, que les Français ont fortifiée pendant l'été. Après la bataille de Leipzig et la retraite de la Grande Armée jusqu'au Rhin, le soulèvement de la Hollande et l'occupation de Brême par les Russes coupent les communications entre Hambourg et la France. Tout d'abord séparées par les défenses naturelles constituées du bas-cours de l'Elbe et du Bille, la garnison française et l'armée de siège se livrent une guerre psychologique tout le mois de décembre. En janvier, les bras de l'Elbe gèlent et les Russes lancent plusieurs assauts contre la place. Malgré la perte de quelques postes avancés, la garnison française parvient à conserver les positions stratégiques de Haarbourg et de Wilhelmsbourg. À partir du 23 mars, le dégel marque la fin des assauts et le retour à une guerre psychologique. Lorsque Napoléon Ier abdique le 6 avril 1814, le maréchal Davout tient encore solidement Hambourg. Il refuse de croire au retour des Bourbons jusqu'au 28 avril et continue après cette date à refuser la reddition de la place à son adversaire russe. Début mai, le maréchal est relevé de son commandement et le général Foucher de Careil négocie la restitution de la place tandis que le général Gérard reconduit le 13e corps en France. Celui-ci quitte Hambourg, libre, avec armes et bagages, les 27, 29 et 31 mai 1814. Le maréchal Davout est mis en cause dès le mois de mai 1814 pour sa gestion des relations avec les populations civiles et particulièrement pour la saisie des fonds de la Banque de Hambourg. Bien que rapidement abandonnées, ces accusations ainsi que son ralliement tardif à Louis XVIII vaudront au maréchal une disgrâce qui ne prendra fin qu'au retour de l'Empereur aux Cent-Jours. Autres articles sélectionnés au sein du portail Premier Empire
| |
 Les secours en montagne désignent l'ensemble des moyens mis en œuvre pour porter secours aux malades et victimes d'accidents ou de malaises en montagne. La montagne est un milieu difficilement prévisible et dangereux :
Ce milieu est d'autant plus propice aux accidents qu'il est fréquenté en périodes de vacances par des personnes peu habituées et donc connaissant mal les dangers, et pratiquant des activités parfois à risque (varappe, alpinisme, parapente). Les secours en montagne nécessitent une grande connaissance de la montagne de la part des sauveteurs, ainsi qu'une grande autonomie en raison de l'éloignement des structures de soins et des difficulté d'accès pour amener personnel et matériel. L'utilisation de l'hélicoptère est très fréquente. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Premiers secours et secourisme |
 D'origine irlandaise, Marie Gilbert (1821-1861) entame en 1842 une carrière de danseuse exotique et de courtisane en prenant le nom de scène de Lola Montez. Autres articles sélectionnés au sein du portail du Printemps des peuples
| |
 Les Séleucides (en grec ancien Σελεύκεια / Seleukeia) forment une dynastie hellénistique issue de Séleucos Ier, l'un des diadoques d'Alexandre le Grand, qui a constitué un empire formé de la majeure partie des territoires orientaux conquis par Alexandre, allant de l'Anatolie à l'Indus. Le cœur politique du royaume se situe en Syrie, d'où l'appellation courante de « rois de Syrie ». Les Séleucides règnent jusqu'au IIe siècle av. J.-C. sur la Babylonie et la Mésopotamie dans la continuité des Perses achéménides. La Perside et la Médie ont quant à elles été plus difficilement soumises. Les Séleucides ont dû faire face à la volonté sécessionniste de nombreux territoires, comme le royaume gréco-bactrien, le royaume d'Arménie, le royaume de Pergame ou la Judée. Au milieu du IIe siècle av. J.-C., la majeure partie des provinces iraniennes et mésopotamiennes tombent entre les mains des Parthes. En 64 av. J.‑C., le royaume séleucide, fortement amoindri par d'inextricables querelles de succession, passe sous la tutelle des Romains. Le royaume, « fusion » de l'Orient et du monde grec, semble au départ fidèle au projet d'Alexandre. Il comprend une multiplicité de groupes ethniques, de langues et de religions. Dans ce contexte, plus encore que pour les autres monarchies hellénistiques, le roi est supposé être le garant de l'unité de l'empire, l'armée apparaissant comme le meilleur soutien du pouvoir. Les Séleucides ont promu par ailleurs l'hellénisation en développant l'urbanisme, comme le montrent la tétrapole de Syrie et les nombreuses fondations ou refondations de cités et de villes-garnisons. Parallèlement, ils s'appuient sur les élites religieuses en honorant les divinités indigènes, comme celles de Babylonie. L'immensité et la diversité du royaume séleucide l'ont fragilisé face aux forces centrifuges, obligeant les souverains à reconquérir périodiquement leurs possessions. Le royaume, qui souffrirait d'une fragilité intrinsèque, a donc été souvent opposé par les historiens aux autres grands États hellénistiques : la monarchie « nationale » des Antigonides de Macédoine, l'Égypte des Lagides, héritière des pharaons et dotée d'une administration centralisée, la monarchie des Attalides bâtie autour de la cité-État de Pergame. Mais il s'avère que les Séleucides ont su faire fructifier l'héritage des Achéménides et d'Alexandre, en accordant une autonomie certaine aux cités et aux différentes communautés, tout en luttant contre de puissants adversaires à leurs frontières. Autres articles sélectionnés au sein du portail Proche-Orient ancien |
 La Durance (en occitan : Durença selon la norme classique, ou en provençal : Durènço selon la norme mistralienne) est une rivière du Sud-Est de la France se jetant dans le Rhône, dont elle est le deuxième affluent après la Saône pour la longueur et le troisième après la Saône et l’Isère pour le débit. Longue de 323,8 km, la Durance est la plus importante rivière de Provence. Rivière dite « capricieuse », autrefois redoutée pour ses crues, elle a été soumise à un effort continu d'aménagement, en particulier depuis le XIXe siècle, à des fins hydrauliques (approvisionnement en eau potable de Marseille et des villes alentour), agricole (irrigation de 75 000 ha de cultures irriguées, responsable du prélèvement de jusqu'à 114 m3/s d'eau dans la rivière, souvent au moment de l'étiage) et hydroélectriques (avec le Verdon, 6 à 7 milliards de kWh produits par an). | |
 Les rochers aux Oiseaux, en anglais Bird Rocks, sont un archipel inhabité du Canada, au Québec, situé dans le golfe du Saint-Laurent au large des îles de la Madeleine. Ces îles et la zone maritime environnante constituent un refuge d'oiseaux migrateurs sous le nom de refuge d'oiseaux des Rochers-aux-Oiseaux, propriété de la Garde côtière canadienne, qui accueille une importante colonie de fous de Bassan. Ce bloc de grès de quatre hectares de superficie et de trente mètres d'altitude est réputé comme étant un véritable cimetière de bateaux, ce qui encouragea l'installation d'un phare en 1870. Plusieurs de ses gardiens y laissèrent leurs vies suite à des accidents de travail ou à la chasse aux phoques. Le phare fut finalement automatisé en 1988, ce qui laissa l'île habitée seulement par les oiseaux marins. |
 La Renault 4CV, du constructeur français Renault, est une voiture conçue par Fernand Picard et Edmond Serre, deux ingénieurs de Renault, qui voit le jour en 1947, suite au développement de trois prototypes. C'est une petite voiture, mais elle est particulièrement spacieuse pour son époque et ses dimensions extérieures. Elle est la première voiture française à atteindre une production d'un million d'exemplaires. Présentée le 26 août 1944, au lendemain de la Libération de Paris, la Renault 4CV symbolise le retour de la paix et de la prospérité. Elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». Sa production s'étend de 1946 au 6 juillet 1961, date de sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire : outre la Dauphine, la 4CV sera, pendant près de 15 ans, le principal modèle commercialisé par Renault.
| |
 Tim Burton, né Timothy William Burton le à Burbank, Californie, est un réalisateur américain. Maître du fantastique et excellent conteur, fortement influencé par l’écrivain Edgar Allan Poe, on lui doit notamment Pee-Wee Big Adventure, Beetlejuice, Batman, Edward aux mains d’argent et Charlie et la chocolaterie. Il a également rédigé les scénarios de L’Étrange Noël de Monsieur Jack et Les Noces funèbres, deux films d’animation réalisés avec des marionnettes évoluant dans des décors réels. Son cinéma se caractérise par des histoires mettant en scène des personnages marginaux, et une grande influence du cinéma fantastique, du cinéma expressionniste allemand ainsi que des films de la Hammer Film Productions. Il fait partie des cinéastes qui parviennent à concilier succès critique et succès commercial. On reconnaît ses films grâce à plusieurs marques qu’il dissémine dans le décor, comme les crédits présentés au début du film en travelling, ou avec son casting souvent composé de Johnny Depp, Danny DeVito ou encore de Helena Bonham Carter. |
 La tour Eiffel est une tour de fer puddlé construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’exposition universelle de 1889. Situé à l’extrémité du Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, ce monument parisien, symbole de la France et de sa capitale est le neuvième site le plus visité du pays en 2006. D’une hauteur de 300 mètres à l’origine, prolongée par la suite de nombreuses antennes culminant à 325 mètres, la tour Eiffel est restée le bâtiment le plus élevé du monde pendant plus de 40 ans. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques et télévisés. Contestée par certains à l’origine, la tour Eiffel fut d’abord, à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, la vitrine du savoir-faire technologique français. Plébiscitée par le public dès sa présentation à l’exposition, elle a accueilli plus de 236 millions de visiteurs depuis son inauguration. Sa taille exceptionnelle et sa silhouette immédiatement reconnaissable en ont fait un emblème de Paris. Autres articles sélectionnés au sein du portail NOM DU PORTAIL
| |
 La basilique Saint-Sauveur de Rennes est une basilique mineure de l’Église catholique romaine, sous le vocable de Notre-Dame des Miracles et Vertus, située au cœur du centre-ville historique de Rennes en France. Sa fondation, sous le vocable de Saint-Sauveur, est antérieure au XIIe siècle. Agrandie à plusieurs reprises et reconstruite au début du XVIIIe siècle, elle a été le siège d'une paroisse pendant près de 300 ans, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau à partir de 2002. Suite à plusieurs événements qualifiés de miraculeux aux XIVe et XVIIIe siècle, le culte de Notre Dame s’y développe fortement pour aboutir à une érection en basilique en 1916. De style classique, cet édifice se distingue particulièrement par son mobilier : baldaquin du maître-autel, chaire en fer forgé, orgue, ainsi que les nombreux ex-voto déposés par les fidèles. |
 La papyrologie (du grec ancien : πάπυρος / pápyros, « papyrus », et λόγος / lógos, « parole, discours, sujet d'entretien ») est la branche des études classiques qui déchiffre les documents grecs et latins provenant de divers sites de l’Égypte et surtout en exploite les données (papyri et ostraca). Par extension, elle étudie aussi l'étude de bien d'autres supports d'écriture, à l'exclusion de la gravure sur pierre (voir l'article épigraphie) et noue des liens étroits avec l'étude des codex (codicologie), de même que les écritures subsistantes d'autres régions du monde (surtout le Levant, la Grèce avec, par exemple, le Papyrus de Derveni et l'Italie avec les riches collections de Papyrus littéraires d'Herculanum). Cette discipline historique apparaît principalement comme l’étude d’une société de notables grecs ou hellénisés dans un milieu oriental bien spécifique, le monde égyptien tardif avec ses vieilles traditions sociales et religieuses. Toutefois, les limites de son domaine d'étude évoluent considérablement depuis la dernière génération du XXe siècle et, elles doivent faire l'objet ci-dessous d'un développement spécifique.
 Le Livre des morts des Anciens Égyptiens a pour véritable titre, à l'époque de l'Égypte antique, Livre pour Sortir au Jour. Le « jour » en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, à l'anéantissement et à la mort. Dans cette perspective, le défunt Égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à traverser le royaume d'Osiris (version nocturne du soleil diurne en cours de régénération). Il s'agit de rouleaux de papyrus, recouverts de formules funéraires, placés à proximité de la momie ou contre celle-ci, dans les bandelettes. Ces différents exemplaires du Livre des Morts ne sont pas tous identiques, car le bénéficiaire choisit les formules qui lui conviennent, probablement en fonction de ce qu'il peut s'offrir car ces manuscrits représentent un investissement non négligeable. Certains peuvent donc être courts, alors que d'autres reproduisent l'ensemble, ou presque, du corpus. En 1842, l'égyptologue allemand Karl Richard Lepsius appela Todtenbuch (Livre des Morts) un papyrus conservé au musée égyptologique de Turin et dont il a effectué une première traduction. Ce nom est ensuite resté bien que dans la littérature égyptologique moderne on rencontre souvent la juxtaposition des deux titres, à savoir « Livre des Morts-Sortir au Jour ». Autres articles sélectionnés au sein du portail Religions et croyances
| |
 Assassin's Creed III est un jeu vidéo d'action-aventure et d'infiltration développé par Ubisoft Montréal et édité par la société Ubisoft fin 2012 sur PlayStation 3, Wii U et Xbox 360 ainsi que sur PC sous système Windows. C'est le cinquième jeu principal de la série Assassin's Creed et la suite directe de Assassin's Creed: Revelations qui concluait les aventures d'Ezio Auditore. Le jeu est une fiction historique qui se déroule avant, pendant et après la révolution américaine de 1753 à 1783 et son nouveau héros est un jeune homme d'origine britannique et mohawk nommé Connor Kenway. Assassin's Creed III poursuit l'histoire de la lutte ancestrale entre les Assassins, combattant pour la liberté, et les Templiers, luttant pour le pouvoir, dans la jeune nation qui deviendra les États-Unis d'Amérique. Il contient également une partie jouable se déroulant au XXIe siècle, où le protagoniste de la série, Desmond Miles, tente de prévenir la fin du monde de 2012, alors que son histoire arrive à sa conclusion. Comme les autres jeux de la série, celui-ci se déroule dans un monde ouvert pour une narration à la troisième personne, et se concentre sur l'utilisation des talents de combat et d'agilité de Desmond et Connor pour éliminer des cibles et explorer l'environnement dans une quête principale et une multitude de missions secondaires. Le jeu propose également un mode multijoueur en ligne : le joueur, seul ou par équipe, a pour objectif d'assassiner des cibles ou d'échapper à ses poursuivants. Assassin's Creed III est l'occasion pour le studio Ubisoft de présenter un nouveau moteur, Anvil Next, créé spécialement pour le jeu. Vendu à plus de 12 millions d'exemplaires, le jeu obtient un accueil public et critique positif. Une préquelle, intitulée Assassin's Creed IV: Black Flag, est annoncée pour l'automne 2013, et aura pour héros le grand-père pirate de Connor, Edward Kenway. Autres articles sélectionnés au sein du portail révolution américaine |
 Jules Michelet (21 août 1798 - 9 février 1874) est un historien français. Il naquit à Paris, d'une famille aux traditions huguenotes. Son père était un maître-imprimeur, ruiné par les ordonnances de Napoleon contre la Presse, et Jules l'assista concrètement aux travaux d'impression. Une place lui fut offerte à l'Imprimerie impériale, mais son père refusa, préférant s'imposer des sacrifices pour l'envoyer étudier au célèbre lycée Charlemagne, où il se distingua. Il réussit l’agrégation des lettres le 21 septembre 1821, et fut bientôt nommé professeur d’histoire au collège Rollin. Peu après, en 1824, il se maria. C'était une des périodes les plus favorables pour les érudits et les hommes de lettres en France, et Michelet avait de puissants appuis en Abel-François Villemain et Victor Cousin, entre autres. Bien qu'il possédât des idées politiques fermes que lui avait transmises son père (un républicanisme fervent teinté de romantisme libre-penseur), il était d'abord et avant tout un homme de lettres et un enquêteur sur l'histoire du passé. Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail de la Révolution française
| |
 Within Temptation est un groupe néerlandais de metal symphonique. Le groupe est créé en 1996 par la chanteuse Sharon den Adel et le guitariste Robert Westerholt. Leur musique est décrite comme du metal symphonique, bien que leurs premiers albums, comme Enter, soient catégorisés metal gothique. Sharon den Adel décrit la musique du groupe comme étant du rock symphonique aux influences variées. Après la parution de leur premier album, Enter, le groupe devient connu de la scène underground néerlandaise. Ce n'est qu'à partir de 2001 qu'il se popularise auprès d'un public plus large, avec le single Ice Queen issu de l'album Mother Earth, qui atteint la deuxième place des classements. Dès lors, le groupe remporte le Conamus Exportprijs pendant quatre années d'affilée. Leurs albums suivants The Silent Force et The Heart of Everything débutent à la première place des classements musicaux néerlandais. En 2008, ils font paraître un DVD live et CD, Black Symphony, enregistré au Metropole Orchestra. Dans le cadre d'une de leur tournée acoustique, en 2009, le groupe fait sortir l'album live An Acoustic Night at the Theatre. Le cinquième album du groupe, The Unforgiving, est commercialisé en mars 2011, en parallèle à une série de comics et de courts-métrages. Le 13 novembre 2012, le groupe célèbre sa quinzième année d'existence lors d'un énorme événement appelé Elements au palais des sports d'Anvers. Leur sixième album, Hydra, est commercialisé le au Japon, le 31 janvier en Europe, et le 4 février aux États-Unis. Plusieurs artistes comme Tarja Turunen, Howard Jones, Dave Pirner et Xzibit y ont collaboré. Le sort Resist, le septième album studio du groupe. Cet album est influencé par d'autres styles musicaux tels que l'industriel et l'EDM. En 2016, le groupe avait déjà vendu plus de 3,5 millions d'albums dans le monde. En tant que groupe reconnu et apprécié pour sa polyvalence musicale, Within Temptation a remporté un certain nombre de récompenses, et leurs enregistrements se sont vendus à près de 3 millions d'exemplaires sur le plan international. |
 Jean Gachassin, né le à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), est un joueur de rugby à XV international français, devenu ensuite président de la Fédération française de tennis (FFT). Il évolue durant sa carrière de joueur, de 1960 à 1978, au poste de demi d'ouverture après avoir débuté ailier. Il joue également à l'arrière ou au centre. Entre 1961 et 1969, il compte trente-deux sélections en équipe de France, au cours desquelles il marque huit essais. Il est un des acteurs de la victoire française lors de trois Tournois des Cinq Nations (1961, 1967 et 1968 où le XV de France réalise le premier Grand Chelem de son histoire). En 1964, il participe à une tournée en Afrique du Sud. Au niveau des clubs, il évolue avec le Football club lourdais de 1960 à 1969, puis avec le Stade bagnérais de 1969 à 1978. Il est champion de France en 1967-1968. Huissier de justice jusqu'à sa retraite professionnelle, il exerce en parallèle des responsabilités au sein de la FFT et de la ligue Midi-Pyrénées. Le , Jean Gachassin est élu président de la FFT, puis est réélu en 2013. | |
|
| |
|
| |
 Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un projet éditorial en cours depuis 1988, qui a pour but de présenter l’histoire de la Suisse sous la forme d’une encyclopédie dans les trois langues officielles du pays : allemand, français et italien. Le DHS est publié à la fois sur papier et sur Internet. Lors de son achèvement prévu fin 2014, il devrait contenir environ 36 000 articles répartis en treize volumes. En parallèle, une édition réduite du dictionnaire est prévue en romanche sous le titre de Lexicon istoric retic (LIR), et constituera le premier dictionnaire spécialisé de la Suisse rhéto-romane. Autres articles sélectionnés au sein du portail Sciences de l'information et des bibliothèques |
 Joan Miró est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol né à Barcelone le et mort à Palma de Majorque le . Se définissant avant tout comme « Catalan international », il est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste. Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour l'« esprit enfantin » et pour son pays. À ses débuts, il montre de fortes influences fauvistes, cubistes et expressionnistes, avant d'évoluer dans de la peinture plane avec un certain côté naïf. Le tableau intitulé La Ferme, peint en 1920, est l'une des toiles les plus connues de cette époque. À partir de son départ pour Paris, son œuvre devient plus onirique, ce qui correspond aux grandes lignes du mouvement surréaliste auquel il adhère. Dans de nombreux entretiens et écrits des années 1930, Miró manifeste son désir d'abandonner les méthodes conventionnelles de la peinture, pour — selon ses propres mots — « les tuer, les assassiner ou les violer », favorisant ainsi une forme d'expression contemporaine. Il ne veut se plier à aucune exigence, ni à celles de l'esthétique et de ses méthodes, ni à celles du surréalisme. En son honneur, la Fondation Joan-Miró a été créée à Barcelone, en 1975. C'est un centre culturel et artistique, dévolu à la présentation des nouvelles tendances de l'art contemporain. Elle est initialement alimentée par un important fonds offert par le maître. D'autres lieux possèdent d'importantes collections d'œuvres de Miró, comme la Fondation Pilar et Joan Miró de Palma de Majorque, le Musée national d'art moderne de Paris, le musée d'art moderne de Lille et le Museum of Modern Art de New York. | |
|
La sécurité de l'information est un processus visant à protéger des données contre l'accès, l'utilisation, la diffusion, la destruction, ou la modification non autorisée. La sécurité de l'information n'est confinée ni aux systèmes informatiques, ni à l'information dans sa forme numérique ou électronique. Au contraire, elle s'applique à tous les aspects de la sûreté, la garantie, et la protection d'une donnée ou d'une information, quelle que soit sa forme. Trois critères de sensibilité de l'information sont communément acceptés : Quelques autres aspects de la sécurité de l'information sont : La cryptographie et la cryptanalyse sont des outils importants pour assurer la confidentialité d'une information, son intégrité, et l'identification de son origine. Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail sur la sécurité de l'information |
En sécurité informatique, un hacker est un spécialiste disposant d'un savoir-faire exceptionnel dans la maîtrise de la sécurité informatique et donc des moyens de déjouer cette sécurité. Certains d'entre eux utilisent ce savoir-faire dans un cadre légal et d'autres l'utilisent hors-la-loi. Pour traduire cette réalité, le jargon informatique classe les hackers dans différentes catégories en fonction du degré de légalité de leurs actions :
Autres articles sélectionnés au sein du portail sur la sécurité informatique | |
 Le protée anguillard (Proteus anguinus), découvert en 1689, est un amphibien urodèle de la famille des Proteidae, de même type que les tritons et les salamandres. Il s'agit d'un animal cavernicole que l'on trouve principalement dans les grottes karstiques des Alpes dinariques. C'est le plus grand prédateur des fonds souterrains. Le protée est la seule espèce du genre Proteus, la seule espèce européenne de la famille des Proteidae et le seul chordé troglobie européen. On le surnomme parfois « poisson humain » (en slovène : človeška ribica) à cause de sa peau ressemblant à celle de l'homme. Il est aussi parfois baptisé « salamandre blanche » ou « salamandre des grottes ». Cet animal est intéressant pour son adaptation au milieu souterrain où la lumière est absente. Les yeux du protée ont une structure vestigiale, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur fonction initiale. L'animal, complètement aveugle, se débrouille donc grâce à ses autres sens très développés, odorat et toucher. Sa peau, en raison de l'obscurité, n'est pas pigmentée. Contrairement à d'autres amphibiens, il est exclusivement aquatique. Il se nourrit, dort et se reproduit sous l'eau. Il possède en outre des caractéristiques néoténiques : une fois adulte, il conserve certaines caractéristiques larvaires comme ses branchies externes. |
 La Brabham BT46 est une monoplace de Formule 1 conçue par l'ingénieur Gordon Murray pour l'écurie Brabham, alors propriété de Bernie Ecclestone. La BT46, engagée en 1978 et en 1979, intègre plusieurs innovations radicales, la plus connue étant le montage d'un panneau d'échangeur thermique en remplacement des radiateurs d'huile et d'eau. Le système ne fonctionne pas et contraint Brabham Racing Organisation à le retirer avant les débuts officiels en course. La voiture, propulsée par un bloc-moteur Alfa Romeo 115-12 à 12 cylindres opposés à plat, rencontre plus facilement le succès en course lorsqu'elle reçoit un radiateur monté dans le museau. Pilotée par Niki Lauda et John Watson, elle remporte une course dans sa variante A et marque suffisamment de points pour permettre à l'écurie de s'approprier la troisième place au championnat du monde des constructeurs. La Brabham BT46B est la variante de la voiture, également connue sous le surnom de « fan car » ou « voiture ventilateur », la plus notoire. Elle est engagée au Grand Prix de Suède 1978 en vue d'apporter une réponse viable à la Lotus 79 à effet de sol. La BT46B crée une très importante portance négative grâce à un ventilateur prétendument utilisé pour améliorer le refroidissement mais qui sert surtout d'extracteur d'air. La voiture ainsi présentée ne prend le départ que d'une seule course, le Grand Prix de Suède 1978 à Anderstorp, qu'elle remporte aux mains de Niki Lauda qui signe également le meilleur tour en course. La BT46B est déclarée illégale par la FIA au terme de la course mais conserve pour acquis ses résultats.
| |
 Tazio Giorgio Nuvolari, dit Tazio Nuvolari (ˈtattsjo ˈdʒordʒo nuvoˈlari), né le à Castel d'Ario et mort le à Mantoue, est un pilote motocycliste et un pilote automobile italien également connu sous les surnoms d'Il Mantovano Volante (le Mantouan volant) ou Nivola. Deux fois champion d'Italie de vitesse moto en 1925 et 1927, champion d'Europe de vitesse moto en 1926 et champion d'Europe des pilotes automobiles en 1932, il reste célèbre tant pour ses exploits en course que pour sa personnalité et son style de pilotage. Nuvolari commence à piloter en compétition motocycliste en 1920 alors qu'il est déjà âgé de vingt-sept ans. Quatre ans plus tard, en 1924, il devient champion d'Italie en catégorie 500 cm3 et, l'année suivante, coiffe la couronne de champion d'Europe en catégorie 350 cm3 avant de remporter de nouveau le championnat italien en 1926. Ces titres acquis, Nuvolari fonde son écurie, la Scuderia Nuvolari, et se tourne vers la compétition automobile tout en poursuivant la compétition motocycliste en parallèle jusqu'à la fin de la saison 1930 quand il décide de se consacrer exclusivement à l'automobile. Au cours de cette saison, il obtient sa première victoire majeure en automobile aux Mille Miglia. Devenu pilote officiel pour Alfa Corse, l'écurie de course officielle d'Alfa Romeo, il remporte, en 1932, le championnat d'Europe des pilotes. À la suite du retrait d'Alfa Corse, de la compétition, Nuvolari s'engage avec la Scuderia Ferrari qui engage semi-officiellement les Alfa Romeo et remporte les 24 Heures du Mans 1933. Déçu par les monoplaces de l'écurie, il entre en conflit avec Enzo Ferrari et rejoint Maserati en milieu de saison 1933 pour y rester jusqu'en 1934, date à laquelle la firme se retire de la compétition. Nuvolari se tourne de nouveau vers la Scuderia Ferrari, avec le soutien du premier ministre italien Benito Mussolini. La relation avec Enzo Ferrari empirant courant 1937, il s'essaye au pilotage d'une des Flèches d'Argent d'Auto Union puis rejoint la firme allemande en 1938 et lui reste fidèle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir du conflit, âgé de cinquante-quatre ans et malgré la maladie, il obtient plusieurs résultats notables et se retire en sur une victoire de catégorie. Il meurt en 1953 d'un accident vasculaire cérébral. |
Le parc national de Padjelanta (en suédois Padjelanta nationalpark, en same de Lule Bádjelándda) est un parc national du Nord de la Suède, à la frontière norvégienne, dans la commune de Jokkmokk du comté de Norrbotten en Laponie. Il couvre 1 984 km2, ce qui en fait le plus vaste parc national du pays, et il est bordé par les parcs nationaux de Sarek, de Stora Sjöfallet et le parc norvégien de Rago. Le toponyme Padjelanta signifie Haute Terre en same, ce qui traduit assez bien la géographie du site. En effet, le parc est avant tout une haute plaine des Alpes scandinaves, d'une altitude d'environ 700 m, avec quelques douces montagnes. Ce paysage contraste fortement avec les zones bordant le parc, au caractère alpin plus marqué, quoiqu'au sud la limite soit moins nette, avec certains hauts sommets dans le parc même. Ceci est dû aux roches du parc, schistes et calcaires, peu résistantes à l'érosion. Le réseau hydrographique est très riche, le parc étant situé à la source du fleuve Luleälven et de plusieurs de ses affluents majeurs. Mais une des principales caractéristiques de Padjelanta est la présence de grands lacs, dont en particulier le Virihaure et le Vastenjaure. Padjelanta, ainsi que le reste de la Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de « plus grande zone encore vierge » d'Europe. En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7 000 ans par les Samis, peuple nomade du Nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier au renne, mais peu à peu ils ont développé une culture fondée sur l'élevage de cet animal associé à des déplacements de transhumance. Padjelanta devint alors l'un des principaux sites d'estive des montagnes, et un grand nombre de camps Samis sont présents dans le parc, souvent à proximité des grands lacs. Pour les Suédois, la zone fut tout d'abord utilisée au XVIIe siècle pour la mine de Kevdekare, de laquelle ils extrayaient de l'argent. Après la fermeture de la mine, c'est surtout l'exploration botanique du parc qui motiva les visites dans la région. En effet Padjelanta possède une flore particulièrement riche, avec un certain nombre d'espèces rares, bien qu'il soit situé quasi-intégralement au-dessus de la limite des arbres. À partir du XXe siècle, le tourisme se développa aussi. C'est l'alliance des associations touristiques et celles de protection de la nature, menée par le botaniste Sten Selander, qui permit la création du parc national en 1962, protégeant ainsi la zone des menaces liées au développement de l'énergie hydroélectrique. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour leur nature préservée et pour leur culture Sami toujours présente. De nos jours, le parc est toujours une zone importante pour l'élevage des rennes par les Samis. C'est aussi une destination touristique, traversée par plusieurs grands sentiers de randonnée, tels que le Padjelantaleden et le Nordkalottleden. Parmi les attractions du sites, les grands lacs sont réputés pour leur beauté. | |
 Le Sony Ericsson K800i est un modèle de téléphone portable produit par l'entreprise Sony Ericsson, lancé à partir de mai 2006 à un prix initial sans abonnement de 479 € ou encore environ 2 400 元 en Chine. Le K800i se veut le successeur du K750i. Axé sur la photo, il est l'un des premiers téléphones à être équipé d'un capteur de 3,2 mégapixels. Le K800i offre aussi de nombreuses fonctions multimédias. Ses connectivités réseau sont importantes et l'intégration de la technologie 3G permet la vidéoconférence et la navigation internet. À la suite d'une forte promotion publicitaire, et grâce à ses caractéristiques techniques innovantes, ce modèle a été un véritable succès et s'est vendu à près de 10 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Ce téléphone, modèle charnière entre deux générations, a défini les standards en matière de qualité photo, et a entraîné une course aux mégapixels dans le monde de la téléphonie mobile. |
 Le théâtre nô, ou nô (能, nō), est un des styles traditionnels du théâtre japonais venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Le nô allie des chroniques en vers à des pantomimes dansées. Arborant des costumes somptueux et des masques spécifiques (il y a 138 masques différents), les acteurs jouent essentiellement pour les shoguns et les samouraïs. Le théâtre nô est composé de drames lyriques des XIVe et XVe siècles, au jeu dépouillé et codifié. Ces acteurs sont accompagnés par un petit orchestre et un chœur. Leur gestuelle est stylisée autant que la parole qui semble chantée. La gestuelle est entrecoupée par les fameux miiye qu'ont représentés les graveurs d'acteurs japonais. Ce sont des arrêts prolongés dans le temps du geste et de la mimique afin d'en accroître l'intensité. Constitué fin XIIIe siècle au Japon, le nô est une forme théâtrale unissant deux traditions : les pantomimes dansées et les chroniques versifiées récitées par des bonzes errants. Le drame, dont le protagoniste est couvert d'un masque, était joué les jours de fête dans les sanctuaires. Ses acteurs, protégés par les daimyos et les shoguns, se transmettent depuis lors de père en fils les secrets de leur art. Le nô a évolué de diverses manières dans l'art populaire et aristocratique. Il formera aussi la base d'autres formes dramatiques comme le kabuki. Après que Zeami a fixé les règles du nô, le répertoire s'est figé vers la fin du XVIe siècle et nous demeure encore intact. Le nô est unique dans son charme subtil (yūgen) et son utilisation de masques distinctifs. Lorsqu'ils mettent le masque, les acteurs quittent symboliquement leur personnalité propre pour interpréter les personnages qu'ils vont incarner. Au lieu de narrer une intrigue compliquée, le théâtre nô, hautement stylisé et simplifié, développe donc une simple émotion ou une atmosphère. Fonctionnant sur le même mode que les autocaricatures, la théâtralité permet de passer à une autre interprétation de soi. Le nô fut une des premières formes d'art dramatique à être inscrite en 2008 (originellement proclamé en 2001) sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, étant un des types de théâtre du nōgaku, conjointement au kyōgen. Autres articles sélectionnés au sein du portail Théâtre
| |
 The Long and Winding Road est une chanson des Beatles, écrite et composée par Paul McCartney, bien que signée Lennon/McCartney. Parue initialement sur l'album Let It Be sous le label Apple, c'est le dernier single américain du groupe, son vingtième et ultime No 1 au Billboard Hot 100 en juin 1970. Son écriture débute en 1968, lorsque McCartney se repose en Écosse, exaspéré par les tensions qui règnent durant la réalisation de l'Album blanc. Le bassiste des Beatles se sert des souvenirs heureux du groupe, et s'inspire du sentiment de nostalgie qui en ressort pour concevoir la chanson. The Long and Winding Road fait partie de la liste de morceaux du « projet Get Back », dont le concept pour le groupe est d'enregistrer dans des conditions live en étant filmés par une équipe de télévision. Cependant, les tensions renaissent sous l’œil des caméras durant sa réalisation en , conduisant même au départ temporaire de George Harrison. Dans sa version initiale, enregistrée en direct dans le studio Apple des Beatles les et , la chanson est une ballade lente chantée et jouée au piano par Paul McCartney, avec George Harrison à la guitare, Ringo Starr à la batterie, Billy Preston aux claviers, et exceptionnellement John Lennon à la basse. Cependant, insatisfait du résultat général, le groupe décide de se concentrer sur l'enregistrement d'une dernière œuvre, Abbey Road, et les bandes de ce qui deviendra l'album Let it Be restent au placard. Un an plus tard, alors que John Lennon a quitté la formation, le nouveau manager des Beatles, Allen Klein confie les enregistrements inexploités, dont celui de The Long and Winding Road à Phil Spector, producteur américain connu pour sa technique de « mur de son ». Le , il post-produit la chanson au sein des studios Abbey Road, en y ajoutant un arrangement interprété par un orchestre de trente-huit musiciens, comprenant chœurs féminins, cordes et cuivres, provoquant la colère de McCartney, qui n'a pas été consulté. Malgré les vives protestations de ce dernier, The Long and Winding Road parait sous cette forme sur l'album Let It Be le , après l'annonce officielle de la séparation du groupe, et en single aux États-Unis trois jours plus tard. Paul McCartney utilise le traitement de sa chanson comme une des six raisons du procès qu'il intente à ses trois camarades en dans le but d'obtenir la dissolution juridique des Beatles. Malgré des critiques mitigées, The Long and Winding Road se hisse à la première place du hit-parade aux États-Unis durant deux semaines. Le titre bénéficie par ailleurs de nombreuses reprises par divers artistes et figure sur les compilations The Beatles 1967–1970, 1, et dans une version alternative sur Anthology 3. En 2003, sous l'impulsion de Paul McCartney, Apple publie l'album Let It Be... Naked, qui propose The Long and Winding Road telle qu'enregistrée au départ et débarrassée des ajouts de Phil Spector. |
 Le métro de Toulouse est un réseau de métro automatique, desservant 37 stations situées sur Toulouse et son agglomération, exploité par la société Tisséo. Ouvert en 1993, il est composé des deux lignes A et B, dans des axes respectifs sud-ouest – nord-est et nord – sud. Les véhicules utilisés sont des véhicules automatiques légers VAL 206 et VAL 208. La première ligne, ligne A, dessert 18 stations. Ouverte en 1993, elle a été prolongée de 3 stations en 2003, jusqu'à Balma, commune limitrophe de Toulouse. La seconde ligne, intitulée ligne B, dessert quant à elle 20 stations, dont une en commun avec la ligne A : la station Jean Jaurès. Ouverte le , elle passe par plusieurs lieux stratégiques de Toulouse. Une 3ème ligne, la ligne C, longue de 27 km et desservant 4 communes avec un total de 21 stations, est actuellement en construction. Son ouverture est prévue en 2028. Lire l’article | |
 L'historique des publications des Aventures de Tintin, série de bandes dessinées créée par le dessinateur belge Hergé, concerne 24 albums, dont une aventure inachevée. Chaque histoire, excepté la dernière, connaît une prépublication dans un périodique avant d'être éditée en album. La première aventure de la série, Tintin au pays des Soviets, est lancée le dans Le Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire pour la jeunesse du quotidien catholique, nationaliste et conservateur belge Le Vingtième Siècle. C'est dans ce même périodique que toutes les histoires écrites avant la Seconde Guerre mondiale sont publiées, jusqu'à l'interruption de Tintin au pays de l'or noir après l'invasion de la Belgique en . La série reprend au mois de septembre suivant dans Le Soir, un quotidien dont le tirage est près de vingt fois supérieur à celui du Petit Vingtième, et ce pour toute la durée de l'occupation allemande de la Belgique. Après la libération du pays, Hergé est un temps frappé d'une interdiction de publication, puis il reprend finalement ses activités dans un nouveau périodique, le magazine Tintin, créé par Raymond Leblanc et dont le premier numéro paraît en . Tous les récits du dessinateur, jusqu'à sa mort en 1983, paraissent dans ce périodique. C'est également Le Vingtième Siècle qui se charge d'éditer en album les trois premières aventures, avant qu'Hergé signe un contrat d'exclusivité avec Casterman. D'abord en noir et blanc, les albums sont directement imprimés en couleurs à partir de 1942, ce qui entraîne un long travail de refonte des premières histoires pour les adapter au nouveau format standard de parution en 62 planches colorisées. Les différentes aventures connaissent aussi des publications dans des journaux et des revues du monde entier. C'est d'abord en France, dans l'hebdomadaire Cœurs vaillants, que la série est reprise, puis en Suisse dans L'Écho illustré, tandis que le journal portugais O Papagaio, en 1936, offre à Tintin sa première traduction. En 1940, le héros d'Hergé fait son entrée dans la presse néerlandophone de Belgique, avant de connaître une large diffusion et un succès international à partir des années 1950. C'est à cette période que se développent également les premiers albums en langues étrangères, pour atteindre plus de 100 traductions dans les années 2010, dont de nombreux dialectes ou langues régionales. En prenant place dans des périodiques du monde entier, les Aventures de Tintin subissent un certain nombre de modifications, que ce soit pour des raisons commerciales ou éditoriales. Les textes et les dessins originaux de l'auteur sont parfois adaptés sans son accord. De même, les éditeurs étrangers de la série poussent l'auteur à procéder à de nombreuses retouches, aussi bien pour apporter des corrections à son travail que pour se plier à la censure.
| ||
 Skylab a été la première station spatiale américaine. Elle fut lancée le et se désintégra au-dessus de l’océan Indien le en rentrant dans l’atmosphère. Pour leur première station spatiale, les Américains choisiront d’abord de convertir le matériel construit pour les missions lunaires (comme les fusées Saturn V ou les modules Apollo). Ce sera le programme AAP (Apollo Application Program), qui deviendra Skylab en 1973. Ainsi, la station Skylab a été fabriquée en réutilisant le troisième étage de la fusée Saturn V et fut lancé par la dernière fusée de ce type. La station américaine demeure l’une des structures les plus importantes jamais construites, lancées et maintenues sur orbite. Elle était constituée de quatre éléments principaux :
Ce laboratoire spatial avait un volume utile de 330 m3 et pesait 82 tonnes. Toutefois, la station subit des dommages importants lors de son lancement et ne put déployer un de ses panneaux solaires. Puis, un accident survint après une intense activité solaire qui dévia la course fatalement. Malgré les efforts de la NASA pour contrôler la descente, l’ouest de l’Australie reçut de nombreux débris de la station. |
 L'Ironman est dans le langage commun du triathlon le nom donné à un des plus longs formats de la discipline. D'une distance totale de 226 kilomètres (140,6 miles), une compétition Ironman, « Homme de fer » en français, est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km). Cette appellation est associée au triathlon Ironman d'Hawaï originel crée en 1978 par John et Judy Collins, qui est depuis 1990 le championnat du monde d'Ironman (Ironman World Championships). Ironman et Triathlon Ironman sont des noms déposés, propriétés de la World Triathlon Corporation (WTC). Cette société privée organise et décerne, chaque année, le titre de « Champion du monde d'Ironman » à l'issue d'un circuit de courses qualificatives et d'une épreuve finale qui se déroule au mois d'octobre à Kailua-Kona, dans l'état d'Hawaï aux États-Unis. Sa devise, adoptée par tous les compétiteurs — les Ironmen —, est « Tout est possible » (Anything is possible). Au fil de son histoire, l'Ironman devient un nom dans le sport. Celui d'une compétition à la naissance du triathlon d'endurance très longue distance (XXL), d'une distance (226 km), d'un mythe (Ironman d'Hawaï), d'une marque (World Triathlon Corporation) pour devenir enfin, celui du championnat du monde de triathlon très longue distance le plus connu de la planète : l'Ironman World Championship.
| |
 La mosaïque du cirque de Gafsa est une mosaïque romaine datée de l'Antiquité tardive découverte en 1888 à Gafsa, ville du sud-ouest de l'actuelle Tunisie. Elle est désormais conservée au musée national du Bardo. La mosaïque représente une course de chevaux et, outre le spectacle sur la piste, figure des spectateurs de façon stylisée. Cette représentation des spectateurs fait de la mosaïque une œuvre exceptionnelle. Elle constitue, en outre, selon Mohamed Yacoub, spécialiste des mosaïques tunisiennes antiques relatives au monde du cirque, « l'exemplaire le plus tardif d'une importante série de pavements africains inspirés par le monde du cirque ». |
Symon Petlioura (en ukrainien : Симон Васильович Петлюра, Symon Vassyliovytch Petlura) est un homme politique et publiciste ukrainien né à Poltava le et mort assassiné à Paris le . Il fut l’un des personnages les plus importants du mouvement national, commandant suprême de l’Armée et le troisième président de la République populaire ukrainienne. Homme de lettres, il fut l’une des figures du mouvement socialiste ukrainien au début du XXe siècle. Autonomiste puis indépendantiste, Simon Petlioura participa à la formation d’une armée ukrainienne pour protéger son pays du bolchevisme durant la révolution russe. Vaincu, il partit à l’étranger et dirigea le gouvernement ukrainien en exil. | |
 Le massacre de la Glacière a eu lieu au palais des papes d'Avignon dans la nuit du 16 octobre au . L'assassinant de Lescuyer, le secrétaire-greffier de la commune, par une foule de « papistes » en colère au couvent des Cordeliers pensant avoir été volé par les « patriotes », entrainera des arrestations douteuses, un jugement bâclé et l'exécution de la sentence par de fanatiques bourreaux inexpérimentés provoquant ainsi un véritable bain de sang. Dernier épisode marquant d'une lutte entre partisans et adversaires de la réunion des États pontificaux à la France, il fait suite à un enchainement de rivalités, de privations et de jalousies. |
 Audrey Hepburn, née Audrey Kathleen Ruston le à Ixelles (Belgique) et morte le à Tolochenaz (Suisse), est une actrice britannico-néerlandaise. Le succès de la pièce Gigi (1951) lui ouvre les portes du cinéma ; dès 1953, Vacances romaines lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice. Ses autres grands succès incluent Sabrina ou My Fair Lady. En 1967, à 38 ans, elle met fin à sa carrière d’actrice. Elle est entrée dans l'histoire du cinéma comme l'une de ses plus grandes actrices. En 1999, l'American Film Institute la distingue ainsi comme la troisième plus grande actrice de tous les temps dans le classement AFI's 100 Years… 100 Stars. Elle a un engagement important pour des causes humanitaires. Elle est ambassadrice de l'UNICEF entre 1988 et 1992 et son action est aujourd'hui poursuivie par l'Audrey Hepburn Children's Fund, œuvre caritative fondée en 1994, un an après sa mort d'un cancer du côlon. Elle marque également son époque par l’incarnation d'un certain « chic » inspiré par le couturier Hubert de Givenchy dont elle est l'amie et l'égérie. Autres articles sélectionnés au sein du portail Warner Bros. Discovery
| |
 Charles Louis Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte (Paris, 20 avril 1808 - Chislehurst, 9 janvier 1873), est le premier président de la République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel masculin avant de devenir empereur des Français (1852-1870) sous le nom de Napoléon III du 2 décembre 1852 au 4 septembre 1870. Issu de la famille Bonaparte, prince français à sa naissance et prince de Hollande, il est le neveu de Napoléon Ier et le troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine (à la fois sa grand-mère et, par son mariage avec Napoléon, sa tante). Il devient héritier présomptif du trône impérial après les morts successives de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et du duc de Reichstadt (Napoléon II, roi de Rome) en 1832. Ses premières tentatives de coup d'État, mal conçues et sans base populaire, échouent. Mais il profite des suites de la Révolution française de 1848 pour s'imposer en politique et se faire élire représentant du peuple puis président de la République. Son coup d'État du 2 décembre 1851 met fin à la Deuxième République, et lui permet ensuite de mener la restauration impériale à son profit. Il exerce d'abord un pouvoir personnel sans partage, puis ce caractère très autoritaire du Second Empire s'atténue après 1859 pour faire place progressivement à « l'empire libéral ». Il met en œuvre la philosophie politique qu'il a publiée de bonne heure dans ses Idées napoléoniennes et dans L'Extinction du Paupérisme (1844), mélange de romantisme, de libéralisme autoritaire, et de socialisme utopique. Le règne de cet admirateur de la modernité britannique est marqué par un développement industriel, économique et financier considérable, et par la transformation de Paris sous l'autorité du préfet Haussmann. La fin de son régime est scellée par la bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, lors de la guerre franco-prussienne. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Napoléon III meurt en exil, en janvier 1873, en Angleterre... Autres articles sélectionnés au sein du portail du XIXe siècle
|






















