Explications :
- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique
- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.
- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.
- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.
 L'Aviation royale du Canada ou ARC (en anglais : Royal Canadian Air Force), anciennement connue sous le nom de Commandement aérien des Forces canadiennes, est l'un des sept commandements des Forces canadiennes. Il est responsable des opérations aériennes qui se déroulent au Canada et à l'étranger. Les unités opérationnelles de l'ARC font partie de la 1re Division aérienne du Canada qui se divise en treize escadres réparties sur l'ensemble du territoire canadien. L'ARC est responsable de la région canadienne du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). La Force aérienne du Canada a été créée en 1920. Elle devint officiellement l’Aviation royale du Canada en 1924. Avant 1920, des Canadiens servaient avec le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service britanniques. Le Corps d’aviation canadien fut la première tentative de créer une force aérienne au Canada en 1914, mais il cessa d’exister en 1915. L’Aviation royale du Canada fut unifiée avec la Marine royale canadienne et l’Armée canadienne sous une structure unifiée, les Forces canadiennes, en 1968. À ce moment, les éléments aériens furent placés sous différents commandements, avant d’être regroupés sous le Commandement aérien en 1975. Autres articles sélectionnés au sein du portail Aéronautique |
 La civilisation carthaginoise ou civilisation punique est une ancienne civilisation située dans le bassin méditerranéen et à l'origine de l'une des plus grandes puissances commerciales et militaires de l'Antiquité. Fondée par des Phéniciens sur les rives du golfe de Tunis, Carthage a pris peu à peu l'ascendant sur les cités phéniciennes de la Méditerranée occidentale, avant d'essaimer à son tour et de développer sa propre civilisation. Celle-ci est cependant moins connue que celle de sa rivale, en raison de la destruction de la cité par l'armée romaine à la fin de la troisième guerre punique, une fin relatée par des sources gréco-romaines qui furent largement et durablement relayées dans l'historiographie. Bien que décriée au travers de la célèbre punica fides, préjugé issu d'une longue tradition de méfiance envers les Phéniciens à partir d'Homère, cette civilisation suscita néanmoins des avis plus favorables :
— Appien, Libyca, 2 Cette civilisation résulte du mélange de la culture indigène, constituée par les Berbères en Afrique, et de la civilisation qu'apportèrent avec eux les colons phéniciens. Il n'est ainsi pas aisé de distinguer ce qui relève des Puniques de ce qui relève des Phéniciens dans le produit des fouilles archéologiques, dont le dynamisme depuis les années 1970 a ouvert de vastes champs d'études où apparaît l'unité de cette civilisation en dépit de particularismes locaux. Malgré ces progrès, de nombreuses inconnues sur la civilisation non-matérielle perdurent, liées à la nature des sources : toujours secondaires, par la perte de toute la littérature punique, lacunaires et souvent subjectives. Autres bons articles du portail Afrique
| ||
|
Thomas Johnson dit Tommy Johnson est un chanteur (chantant souvent avec une voix de fausset) et guitariste américain de blues, né près de Terry au Mississippi en 1896. Plongé très tôt dans le monde de la musique, Tommy Johnson devient assez jeune un artiste reconnu. Il sillonne l'État du Mississippi et fait quelques incursions dans les États voisins. Il mène une vie de bohème, constamment sur la route, de séducteur (il se marie quatre fois et a de nombreuses maîtresses) mais aussi d'alcoolique chronique (il va jusqu'à consommer de l'alcool utilisé normalement comme combustible) bien qu'il tente parfois de se ranger, mais toujours sans succès. Il enregistre une quinzaine de titres dans les années 1928-1929 pour deux labels, Victor et Paramount, avant de retourner sur la route. Ses premiers disques, avec des titres tels que Canned Heat Blues ou Big Road Blues, connaissent le succès mais les derniers enregistrements ne se vendent pas assez pour qu'il soit rappelé. De 1930 à sa mort, il continue donc sa carrière de musicien itinérant, jouant ses succès mais sachant aussi s'adapter aux demandes du public. Il meurt à Crystal Springs au Mississippi le . Bien qu'il ait très peu enregistré, Tommy Johnson a eu une énorme influence sur le blues. De nombreux musiciens, comme Howlin' Wolf, se sont inspirés de son jeu de guitare et de son chant ; dans les années 1960, le groupe Canned Heat lui rend hommage, d'abord en prenant le titre d'une de ses chansons pour nom de groupe mais aussi en s'inspirant de Big Road Blues pour écrire On the Road Again. En 2000, il devient un personnage de fiction lorsqu'il apparaît dans le film des frères Coen O'Brother. Ce Tommy Johnson, bien qu'il soit inspiré du personnage réel, reste cependant une invention des auteurs puisqu'il devient musicien dans le groupe formé par les trois personnages principaux du film.
|
Olaf Gothfrithson (Óláfr Guðrøðarson en vieux norrois, Amlaíb mac Gofraid en vieil irlandais, Ánláf en vieil anglais) est un roi viking actif dans les îles Britanniques dans la première moitié du Xe siècle. Il règne sur Dublin de 934 à 939, puis sur York de 939 jusqu'à sa mort, en 941. Fils du roi de Dublin Gothfrith, Olaf appartient aux Uí Ímair, la dynastie des descendants d'Ivar. Il succède à son père à sa mort. En 937, il étend son autorité sur les Vikings de Limerick en s'emparant de leur roi Amlaíb Cenncairech. La même année, il s'allie avec le roi écossais Constantin II contre le roi anglais Æthelstan en vue de reconquérir le royaume viking d'York, sur lequel son père a brièvement régné en 927. Leur campagne se termine par une défaite à la bataille de Brunanburh. En 939, Olaf profite de la mort d'Æthelstan pour retraverser la mer d'Irlande et s'établir comme roi à York, laissant le royaume de Dublin à son frère Blácaire. Lors d'une rencontre à Leicester, il conclut un accord avec Edmond, le successeur d'Æthelstan, concernant la division de l'Angleterre. Les Vikings ne tardent pas à rompre cet accord en occupant la région des Cinq Bourgs, un événement qui prend peut-être place après la mort d'Olaf en 941. Son cousin Olaf Kvaran lui succède à York. Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings
| ||
 Le stade de la Meinau, communément appelé la Meinau, est un stade de football situé à Strasbourg, en France. Il s’agit du principal équipement sportif de la ville. Le site du stade de la Meinau est utilisé pour y jouer au football depuis 1906, lorsque le club du FC Frankonia transforme progressivement la prairie du jardin Haemmerlé en terrain de football. À partir de 1914, le pré est utilisé par le FC Neudorf, qui se renomme Racing Club de Strasbourg en 1919. La première tribune, en bois, est construite en 1921, année où le jardin prend le nom de stade de la Meinau. L’enceinte est rénovée en 1951, avant d’être complètement reconstruite en 1984. De plus de 40 000 places, la capacité est ensuite réduite à 29 000 places, dont 24 000 assises, pour mettre le stade aux normes de sécurité et de confort. La Meinau est le douzième plus grand stade français en nombre de places proposées. Si le club résident est le RC Strasbourg, l’enceinte accueille ponctuellement d’autres évènements sportifs ou culturels. Le stade se situe le long du Krimmeri, un bras non canalisé du Rhin, dans le quartier de la Meinau. |
Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse. La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :
| ||
 L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité. Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...
|
L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels. Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne
| ||
 Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias Enjolras, est une militante anarchiste et l’une des actrices de la Commune de Paris. On lui prête l'idée d' arborer un drapeau noir pour regrouper les combattants communards. Fille naturelle d'une servante et d'un bourgeois (qui prendra en charge son éducation d'institutrice), Louise Michel enseigne quelques années avant de monter à Paris en 1856. Là, elle développe une activité poétique, pédagogique en créant une école alternative et se lie avec le milieu révolutionnaire blanquiste du Paris des années 1860. En 1871, elle participe activement à la Commune de Paris. Capturée en mai sur une barricade, elle échappe à la condamnation à mort grâce à l'intervention du fidèle Victor Hugo. Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'éveille à la pensée anarchiste grâce à l'influence de Nathalie Le Mel, militante libertaire, co-détenue avec elle. De retour en France en 1880 elle multiplie les conférences et meetings en faveur des prolétaires. Surveillée par la police, emprisonnée à plusieurs reprises, Louise Michel poursuit inlassablement son activisme politique dans toute la France (y compris l'Algérie) et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans. Louise Michel, femme de courage, de conviction et d'engagement, est devenue une légende de la Commune de Paris au point, hélas, de rejeter au second plan les biographies de dizaines de femmes qui payèrent de leur vie leur croyance dans une révolution sociale d'essence proudhonienne. Lire la suite |
 Wilfrid ou Wilfrith, né vers 633 et mort en 709 ou 710, est un religieux anglo-saxon. Originaire de Northumbrie, Wilfrid bénéficie dans sa jeunesse du soutien de la reine Eanflæd et étudie à Lindisfarne et à Cantorbéry avant de se rendre sur le continent pour poursuivre sa formation à Lyon et à Rome. De retour en Angleterre, il joue un rôle important dans l'adoption de la méthode romaine du calcul de la date de Pâques lors du concile de Whitby en 664. Nommé évêque d'York la même année, il ne le devient effectivement qu'en 669 et fait preuve d'une grande activité dans son diocèse en fondant plusieurs églises et monastères. L'important pouvoir qu'il détient en tant que seul évêque du Nord de l'Angleterre suscite la méfiance du roi Ecgfrith et de l'archevêque Théodore de Tarse, qui le dépose en 678. Après avoir fait appel en vain au pape, Wilfrid s'exile dans le royaume de Sussex, où il entreprend la conversion des Saxons du Sud et fonde l'évêché de Selsey. Wilfrid retrouve brièvement son siège d'York dans la deuxième moitié des années 680, mais il en est à nouveau chassé en 691 par le successeur d'Ecgfrith, Aldfrith. Il se rend alors en Mercie et apporte son soutien à l'effort missionnaire en direction de la Frise. En 702, un concile réuni afin de régulariser la situation de Wilfrid décide la confiscation de tous ses biens. Il tente une nouvelle fois de plaider sa cause à Rome, mais ses opposants profitent de son absence pour l'excommunier. Le pape intercède en sa faveur, et après la mort d'Aldfrith, un accord est conclu entre les différentes parties, laissant à Wilfrid les monastères de Hexham et Ripon. Il meurt quelques années plus tard, en 709 ou 710. Peu après sa mort, Étienne de Ripon rédige une hagiographie de Wilfrid, la Vita sancti Wilfrithi, qui constitue la principale source des historiens modernes à son sujet. Bède le Vénérable parle également beaucoup de lui dans ses écrits, de manière moins dithyrambique. Le portrait de Wilfrid que ces sources permettent de dessiner est contrasté : un prélat ambitieux au train de vie dispendieux qui se montre néanmoins tout dévoué à son Église, comme en témoignent ses efforts missionnaires et ses fondations. Il fait rapidement l'objet d'un culte, avec une fête le 24 avril ou le 12 octobre. Voir les autres articles sélectionnés
| ||
|
Simon Wells, né en 1961 à Cambridge, est un réalisateur, scénariste et animateur britannique. Attiré par le dessin, il désire devenir illustrateur. Toutefois, lors de ses études, ses professeurs lui conseillent de continuer dans l'animation. D'abord embauché par l'animateur Richard Williams, il a l'occasion de travailler sur le film Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Remarqué, il intègre le studio Amblimation et réalise l'ensemble des films de cette branche d'Amblin Entertainment, dont une production tout seul. À la fermeture du studio, il est transféré à DreamWorks Animation, filiale de la nouvelle société DreamWorks SKG, et réalise, avec Brenda Chapman et Steve Hickner, Le Prince d'Égypte, qui est un succès. Il réalise également son unique film avec acteurs, La Machine à explorer le temps, adaptation du roman de son arrière-grand-père H. G. Wells. Ensuite, Wells travaille dans l'ombre de diverses productions de DreamWorks au scénario, à l'animation ou encore comme consultant. Il retourne derrière la caméra, cette fois-ci pour Disney, avec Milo sur Mars, film dont il a écrit le scénario avec son épouse, Wendy. Toutefois, le film reçoit un accueil assez négatif de la critique ainsi que du public, et entraîne la perte de près de 110 millions de dollars ainsi que la fermeture d'Imagemovers Digital, la société de Robert Zemeckis, qui renaît néanmoins quelques mois plus tard. Après cet échec, il revient à DreamWorks où il continue d'apporter son expérience à la production de longs métrages. |
 L’univers de Naruto est un univers de fiction créé par Masashi Kishimoto dans lequel se déroule l’histoire du shōnen manga Naruto, et des anime associés. Dans l’univers de Naruto, issu de nombreuses influences, les protagonistes principaux sont des ninjas animés d’une force spirituelle appelée chakra, qui leur permet d’utiliser toute une palette de techniques de combat (jutsu) fictives, variant selon l’utilisateur. En complément à cette originalité, l’apparence de ces ninjas est loin des stéréotypes habituels du Japon féodal auxquels la série emprunte cependant de nombreuses notions, les mélangeant avec certaines venues du shintoïsme, du bouddhisme, ou même du taoïsme et de l’hindouisme. Les ninjas sont organisés en villages cachés, servant leur pays par des missions diverses et variées lorsqu’ils ne sont pas en guerre. Chaque village a sa propre organisation interne, et le chef, le plus puissant des ninjas du village, appelé kage, possède une certaine autonomie, même s’il est nommé par le daimyo, représentant le commandement civil du pays, et auquel il reste subordonné. La hiérarchie suit les règles du shōnen, où les jeunes sont formés par leurs aînés.
| ||
 L’assassinat de William McKinley est l’attentat perpétré dans l’État de New York le contre le président des États-Unis, William McKinley, alors qu’il visitait l’exposition Pan-américaine au Temple of Music à Buffalo. Au moment de lui serrer la main, l’anarchiste Leon Czolgosz tira deux coups de pistolet sur le président, qui d’abord se remit de ses blessures, avant que son état se détériore rapidement six jours plus tard et qu’il ne meure le . Après l’assassinat, Theodore Roosevelt prit la succession et fit voter une loi interdisant l’entrée du territoire aux anarchistes. Le Congrès chargea officiellement le Secret Service de la protection rapprochée des présidents. |
 L’équipe de France de rugby à XV en tournée en 1958 est la première équipe de rugby à XV représentant la France à se déplacer dans l’hémisphère Sud dans une nation du Commonwealth. Elle effectue une tournée en Afrique du Sud en 1958 et termine invaincue en test match avec une victoire et un match nul. Les Springboks — surnom de l’équipe d’Afrique du Sud — affrontent les Français dans une série historique pour les Bleus — surnom de l’équipe française — pourtant handicapés par plusieurs absences. Lors du premier test match, la sélection française obtient un match nul 3-3. La tournée est un succès complet car le , l’équipe de France remporte sa première victoire par 9-5 face aux Springboks lors du second test match à l’Ellis Park de Johannesburg, sous la conduite de Lucien Mias, le Docteur Pack. L’équipe de France démontre alors qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes au monde. Ces bons résultats préfigurent les succès à venir dans le Tournoi des cinq nations. | ||
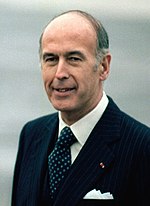 Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au . Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans. Lire l’article |
 Macintosh (prononcé /makintɔʃ/) ou Mac est une série de différentes familles d'ordinateurs personnels conçus, développés, et vendus par Apple. Le premier Macintosh est lancé le 24 janvier 1984 (il a été renommé Macintosh 128K dès le lancement du Macintosh 512K). Il constitue le premier succès commercial pour un ordinateur utilisant une souris et une interface graphique (au lieu d'une interface en ligne de commande). Le Macintosh remplace l'Apple II comme principal produit d'Apple. Cependant les parts de marché d'Apple baissent, avant un renouveau des Macintosh en 1998, avec la sortie de l'ordinateur grand public tout-en-un iMac, qui permet à Apple d'échapper à une probable faillite et marque un succès pour la firme. Le principe de production des Mac repose sur un modèle d'intégration verticale : Apple se charge de la conception de ses machines et de certains de leurs composants et des logiciels de base en pré-installant son propre système d'exploitation sur tous les Mac. Ceci contraste avec la plupart des ordinateurs vendus avec des systèmes d'exploitation différents, pour lesquels plusieurs constructeurs se chargent de créer du matériel conçu pour utiliser le système d'exploitation d'une autre entreprise. Entre 1984 et 1994, les Macintosh fonctionnaient avec des processeurs de la famille 68000 de Motorola, avant d'utiliser entre 1994 et 2006 des processeurs PowerPC de l'Alliance AIM. Depuis 2006, les Mac vendus utilisent des processeurs x86 d'Intel. Pour faire fonctionner son ordinateur Mac, Apple a développé une famille de systèmes d'exploitation spécifiques. Basés sur une interface utilisateur graphique, ils sont connus sous le nom de Système (versions de 1 à 7), avant de devenir Mac OS (7.6, 8, 9 et 10). À l'aube des années 2000, cette lignée est remplacée par Mac OS X, développé à partir de NeXTSTEP, rebaptisé OS X en 2012 puis macOS en 2016. Sur les Macintosh à microprocesseur Intel, il est possible d'installer des systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows, Linux, FreeBSD ou bien d'autres. Avec les processeurs PowerPC ou même 68k, il était cependant déjà possible d'installer des systèmes d'exploitation UNIX tournant sous ces plates-formes matérielles. Autres bons articles du portail des années 1980
| ||
|
La techno est un genre de musique électronique apparue au début des années 1980 dans la ville de Détroit. Ses premières influences ont été la musique house de Chicago, l'electro, la new wave, le funk et les thèmes musicaux futuristes qui prévalaient dans la culture populaire, relatifs à la culture moderne de l'Amérique industrielle de la fin de la guerre froide. Dans les années 1990, suite au succès initial de la techno de Détroit se développant en véritable culture musicale (au moins au plan régional), a émergé de manière globale tout un sous-ensemble de genres plus ou moins directement reliés au genre initial. Le terme « techno » est dérivé de « technologie ». Les journalistes musicaux et les amateurs du genre sont en général prudents quant à l'utilisation du terme, soucieux de l'assimilation qui peut être faite avec les autres sous-genres même s'ils sont en réalité très distincts (par exemple : house, trance ou hardcore). À la même période, le terme « techno » s'est aussi répandu pour désigner toute forme de musique électronique, et même toute forme de technologie (en France du moins). Lire l'article |
 Urt (prononcé [yrt]) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Le village est proche de la frontière floue du Pays basque et de la Gascogne. Fondé au XIe ou XIIe siècle par des pêcheurs, le village devient rapidement une cité prospère grâce à sa situation favorable sur l'Adour permettant d'établir un port fluvial actif, des chantiers navals, des marchés. Urt est propriété des Gramont jusqu'à la Révolution française, où la paroisse devient commune. Elle vit une nouvelle période de prospérité au XIXe siècle, et profite des progrès techniques. Puis elle décline au XXe siècle et subsiste grâce à son activité agricole ; l'explosion démographique et immobilière de la côte basque lui permet un fort accroissement de sa population à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. | ||
 La primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne (dite aussi, plus simplement, cathédrale Saint-Jean) est le siège épiscopal de l'archidiocèse de Lyon. Elle a rang de cathédrale et de primatiale : l'archevêque de Lyon a le titre de Primat des Gaules ; le titulaire depuis 2002 est Mgr Philippe Barbarin. Elle est située dans le cinquième arrondissement de Lyon, au cœur du quartier médiéval et Renaissance du Vieux Lyon, dont elle est un des éléments marquants. Au Moyen Âge, elle faisait partie d'un complexe d'églises et d'autres bâtiments ecclésiaux, le groupe cathédral, qui comprenait entre autres les églises Saint-Étienne et Sainte-Croix, détruites à la Révolution, ainsi que l'actuelle manécanterie. Originellement, l'église a été consacrée sous le patronage de saint Étienne, tandis que son baptistère était consacré sous celui de saint Jean-Baptiste, mais, comme cela est fréquent, le vocable du baptistère s'est ensuite appliqué dans la désignation courante. La première cathédrale dont l'existence est attestée, et que les sources de l'époque se contentent d'appeler maxima ecclesia, c'est-à-dire la « grande église », a été bâtie par Patient. La seconde, plus grande et datée du IXe siècle, est l'œuvre de Leidrade. L'édifice actuel est un projet de longue haleine, porté dans sa conception par trois archevêques successifs au moment où l'architecture occidentale bascule du roman au gothique : Guichard de Pontigny envisage et entame la construction d'une église romane, Jean Belles-mains entame la transformation de l'édifice en un ouvrage gothique dont les ressorts techniques ne sont pas encore pleinement maîtrisés, enfin Renaud de Forez transforme le projet, grâce à l'évolution des savoir-faire, pour donner à la cathédrale son aspect actuel. La construction s'étale sur trois siècles, de 1175 à 1480. Le site contraint, entre colline et rivière, ainsi que les luttes politiques entre les différentes puissances régentant Lyon au Moyen Âge central, ont empêché la cathédrale de disposer d'un terrain aussi vaste et aussi favorable que ses concepteurs l'auraient souhaité. Par ailleurs, l'absence du savoir-faire particulier des bâtisseurs de cathédrale du Bassin parisien est une des causes de la relative modestie des dimensions et de l'ornementation de Saint-Jean. Fortement endommagée par les guerres de religion en 1562, puis par la Révolution française et le siège de Lyon en 1793, la primatiale est restaurée au XIXe siècle. Les premiers travaux sont assez modestes et fortement empreints de classicisme ; mais cette politique change vigoureusement avec l'arrivée d'un nouvel architecte, Tony Desjardins, qui donne un élan inédit à la restauration. De son point de vue, non seulement les travaux doivent rendre à l'église son aspect médiéval, mais cet aspect est à sublimer pour faire de Saint-Jean une « cathédrale idéale » reflétant l'esprit gothique du XIIIe siècle... Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne |
 L'Urartu ou Ourartou (en arménien Ուրարտու) est un royaume constitué vers le IXe siècle av. J.-C. sur le haut-plateau arménien, autour du lac de Van (actuelle Turquie orientale). À son apogée au milieu du VIIIe siècle, son territoire s'étend également sur les pays voisins : Arménie autour du lac Sevan, nord-ouest de l'Iran autour du lac d'Ourmia, nord de la Syrie et de l'Irak, voire le sud de la Géorgie. Le terme « Urartu » servait à désigner cet État dans les sources de l'Assyrie, son grand adversaire. Dans leurs inscriptions dans leur propre langue, ses rois parlaient de Biaineli. Ce royaume et sa culture disparaissent dans le courant de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. dans des conditions inconnues, laissant la place aux Arméniens. L'Urartu a d'abord été connu par les sources écrites provenant de l'Assyrie, royaume qui est son principal adversaire au sud de son territoire (du Xe au VIIIe siècle av. J.-C.). Cela a permis de situer les rois urartéens dans la chronologie de l'histoire du Proche-Orient ancien. L'exploration des territoires qu'ils ont dominés a permis la redécouverte de plusieurs de leurs inscriptions. Les fouilles régulières ou clandestines sur de nombreux sites urartéens ont permis de mieux connaître l'organisation de ce royaume et sa culture, même si les connaissances restent encore essentiellement limitées aux manifestations de son administration et de ses élites. Cela a révélé un État qui a certes été marqué par l'influence assyrienne, mais a aussi développé de forts caractères propres, qui se voient notamment dans la réalisation de vastes forteresses servant de centres administratifs, ou encore la mise au point d'une métallurgie du bronze d'une qualité remarquable. Autres articles sélectionnés au sein du portail Arménie
| ||
|
L’aïkibudō est un art martial traditionnel d’origine japonaise (budō) essentiellement basé sur des techniques de défense. Il est très proche de l’aïkidō. Il hérite des mêmes enseignements issus des pratiques martiales des samouraïs. Il ne peut être décrit seulement comme une évolution de l’aïkidō, bien plus connu, mais comme une autre forme de l’enseignement d’un même fondateur, Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, également fondateur de l’Aïkidō, a fait évoluer sa vision de l’art martial tout au long de sa vie. L’Aïkidō moderne correspond à la forme la plus récente de son enseignement. Avant d’arriver à cette forme épurée, la forme de sa pratique et le nom de son école ont connu des changements. Ueshiba avait ainsi nommé son école Daitōryū aikijūjutsu, en référence à l’école traditionnelle d’où il tirait ses techniques, puis Aïkibudō (1930), qui deviendra ultérieurement Aïkidō (1942). |
Acrimed (acronyme d'« Action critique Médias ») est une association française de critique des médias, créée en 1996 par deux universitaires proches de Pierre Bourdieu, dans la foulée du mouvement social de novembre et décembre 1995 et dans le sillage d'un appel à la solidarité avec les grévistes, en réponse à la façon dont les grands médias auraient pris parti contre ce mouvement et neutralisé l'expression de ses acteurs.
| ||
|
Le programme Venera (russe : Венера, qui signifie « Vénus ») est une suite de missions spatiales automatiques développées par l'Union soviétique dans les années 1960 et 1970 pour étudier la planète Vénus. Au début de l'exploration spatiale, les caractéristiques de la planète, dont la surface est masquée par une épaisse couche de nuages, sont pratiquement inconnues. Le programme Venera est lancé dans le cadre de la Course à l'espace qui oppose l'Union soviétique aux États-Unis et constitue un enjeu autant politique que scientifique. Les sondes spatiales du programme Venera vont progressivement dévoiler la structure de l'atmosphère et certaines caractéristiques du sol vénusien. Le programme constitue le plus grand succès de l'astronautique soviétique dans le domaine de l'exploration du système solaire. Après une série d'échecs entre 1961 et 1965 qui sont autant dus au lanceur Molnya utilisé qu'à la qualité des sondes spatiales construites, le programme est confié au bureau Lavotchkine. Celui-ci obtient une longue série de succès. Les premières données in situ sur l'atmosphère vénusienne sont renvoyées par la mission Venera 4 en 1967. Venera 7 réussit à se poser sur le sol intact malgré la pression écrasante de 93 atmosphères. Venera 8 fournit les premières données depuis le sol. En 1975 le programme inaugure un nouveau type de sonde de 5 tonnes particulièrement bien équipé en instrumentation scientifique et lancé par la fusée Proton. La première mission ayant recours à ce modèle, Venera 9, est lancée en 1975. Les missions suivantes qui s'achèvent en 1981 avec Venera 14 ramènent une moisson de données sur l'atmosphère de Vénus ainsi que les premières photos de sa surface. Le programme se conclut par les orbiteurs Venera 15 et Venera 16 qui dressent une première carte de la surface de la planète à l'aide d'un radar capable de percer la couche nuageuse. Le programme Vega en 1985, constitue un prolongement du programme Venera. Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique |
 L’Émeu d’Australie (Dromaius novaehollandaiae) est la seule espèce de la famille des dromaiidés, encore vivante de nos jours. C’est aussi, par sa taille, le deuxième plus grand oiseau du monde actuel derrière l’autruche. Il peut atteindre deux mètres de haut. Cet oiseau brun, au plumage original est commun sur presque tout le territoire australien bien qu’il évite les régions trop densément peuplées, les zones trop humides ou trop sèches. Il peut voyager sur de grandes distances d’un bon pas et si besoin courir à 50 kilomètres/heure. Ce sont des oiseaux nomades capables de parcourir de nombreux kilomètres à la recherche d’une nourriture variée à base de plantes et d’insectes. La sous-espèce d’émeu qui habitait la Tasmanie (diemenensis) s’est rapidement éteinte après l’arrivée des premiers Européens en 1788. La répartition des différentes sous-espèces (novaehollandiae, woodwardi et rothschildi) a aussi été modifiée par les Européens. Alors qu’autrefois les émeus étaient très communs sur la côte est de l’Australie, ils y sont maintenant devenus rares ; en revanche, le développement de l’agriculture et la création de points d’eau pour le bétail à l’intérieur du continent ont fait augmenter leurs effectifs dans les régions arides. On les élève pour leur viande, leur huile et leurs plumes. Autres articles sélectionnés au sein du portail Australie
| ||
 Pirelli est un fabricant italien de pneumatiques, exerçant quatre grandes activités : les pneumatiques (5e producteur mondial), les câbles et systèmes pour l'énergie électrique (1er producteur mondial), les câbles et systèmes pour les télécommunications (4e producteur mondial), l'immobilier (1er en Italie, activité réalisée par la filiale Pirelli & C. Real Estate, contrôlée à 61,1 %), et présent industriellement dans 25 pays. Le chiffre d'affaires du groupe est d'environ 6 milliards d'euros (2003) et l'effectif employé de 36 000 salariés. Le capital est très dispersé, avec une présence à hauteur de 15 % d'investisseurs institutionnels italiens. La société fut créée en 1872 à Milan par un jeune ingénieur de 24 ans : Giovanni Battista Pirelli.
|
Valérian, agent spatio-temporel est une série de bandes dessinées de science-fiction réalisée par le scénariste Pierre Christin, le dessinateur Jean-Claude Mézières et la coloriste Évelyne Tranlé. Elle est publiée pour la première fois en 1967 dans Pilote et éditée en album chez Dargaud à partir de 1970. Pour le quarantième anniversaire de sa création, en 2007, la série est rebaptisée Valérian et Laureline. Valérian et sa compagne Laureline sont des agents du Service Spatio-Temporel (SST) de Galaxity, une mégapole terrienne et la capitale au XXVIIIe siècle d’un empire galactique. La Terre est devenue, à la suite d’un âge noir, l’une des grandes puissances cosmiques. Les agents du SST se déplacent dans le temps et dans l’espace pour préserver les intérêts de Galaxity. Les règles du SST leur interdisent de modifier les évènements du passé. Valérian et Laureline explorent de nouvelles planètes (Les Oiseaux du Maître), participent à des expériences historiques (Sur les terres truquées), aident des peuples inconnus (Bienvenue sur Alflolol), règlent des conflits planétaires (Le Pays sans étoile), représentent Galaxity (L’Ambassadeur des Ombres), etc. Ils n’interviennent pas pour prévenir l’explosion nucléaire de 1986 qui transforme l’aspect et l’organisation de la Terre. Mais c’est l’avenir de Galaxity qu’ils réécrivent en aidant le superintendant du SST à empêcher ultérieurement ce cataclysme. Hélas, dans cette manipulation temporelle à hauts risques, ils annulent aussi le futur de leur planète. Dans la dernière quadrilogie de la série, Valérian et Laureline partent en quête de la Terre pour lui assurer un nouvel avenir… | ||
 La structure des protéines est la composition en acides aminés et la conformation en trois dimensions des protéines. Elle décrit la position relative des différents atomes qui composent une protéine donnée. Les protéines sont des macromolécules de la cellule, dont elles constituent la « boîte à outil », lui permettant de digérer sa nourriture, produire son énergie, de fabriquer ses constituants, de se déplacer, etc. Elles se composent d’un enchaînement linéaire d’acides aminés liés par des liaisons peptidiques. Cet enchaînement possède une organisation tridimensionnelle (ou repliement) qui lui est propre…
|
 L’écologie est la science étudiant les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu (environnement). Le terme « écologie » vient du grec οικος (maison, habitat) et λογος (science, connaissance) : c’est la science de la maison, de l’habitat. Il fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, particulièrement utilisée en écologie humaine, consiste à définir l’écologie comme le rapport triangulaire entre les individus d’une espèce, l’activité organisée de cette espèce et l’environnement de cette activité. L’environnement est à la fois le produit et la condition de cette activité, et donc de la survie de l’espèce. Lire l’article | ||
|
 Une mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est une structure à l'intérieur d'une cellule (plus précisément, c'est un organite), dont la taille est de l'ordre du micromètre. Leur rôle physiologique est primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules organiques est récupérée puis stockée sous forme d'ATP, la source principale d'énergie pour la cellule eucaryote, par le processus de phosphorylation oxydative...
| ||
 Le Baleinoptère de Rudolphi, Rorqual boréal, Rorqual de Rudolphi ou encore Rorqual sei (Balaenoptera borealis) est une baleine à fanons présente dans tous les océans du monde et dans toutes les mers attenantes, avec une prédilection pour la haute mer et les océans profonds. Il évite les eaux glaciales et tropicales ainsi que les mers semi-fermées. Le rorqual boréal effectue une migration annuelle des mers subpolaires froides en été, vers les mers subtropicales tempérées l'hiver, sans que l'on connaisse précisément ses routes de migration dans la plupart des régions du globe. C'est, derrière la baleine bleue et le rorqual commun, le troisième plus grand rorqual au monde. Ces baleines atteignent une longueur de vingt mètres et un poids de quarante-cinq tonnes. Elles ingèrent quotidiennement en moyenne 900 kg de nourriture, se composant essentiellement de copépodes, de krill et d'autres formes de zooplancton. Elles comptent parmi les cétacés les plus véloces, avec une vitesse pouvant dépasser 50 km/h sur de courtes distances. Dans de nombreuses langues, son nom est associé au lieu noir (sei dans les langues scandinaves), car ce poisson migre périodiquement vers les côtes de Norvège à la même saison que le Rorqual boréal. À la suite de la pêche industrielle qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, décima cette espèce avec plus de 238 000 individus capturés, le Rorqual boréal est aujourd'hui reconnu comme une espèce protégée par les accords internationaux, bien qu'une chasse confidentielle demeure autorisée dans le cadre de « programmes de recherche » controversés, menés par l'Islande et le Japon. Pour l'année 2006, la population mondiale de Rorquals boréaux était estimée à 54 000 individus, soit environ un cinquième de l'effectif d'avant la pêche à la baleine. |
 La forêt de Chantilly est un massif forestier de 6 344 hectares situé sur le territoire de seize communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise, à 37 kilomètres au nord de Paris. La forêt a été constituée progressivement par les acquisitions des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle dans le but principal d’en faire une réserve de chasse. Propriété de l’Institut de France depuis 1897, elle appartient au domaine de Chantilly et est protégée au titre des sites classés. Elle est soumise au régime forestier et gérée par l’Office national des forêts (ONF). Les peuplements forestiers sont principalement constitués de chênes à 48 %, de pins sylvestres à 12 % et de hêtres à 9 %. À la fois espace naturel et historique, plusieurs de ses sites appartiennent au réseau Natura 2000 afin de protéger leurs habitats naturels rares et menacés et ses populations d’oiseaux. Par ailleurs, son territoire abrite six monuments historiques. Elle reste encore un terrain de chasse et notamment de grande vénerie, mais aussi d’entraînement pour chevaux de courses. Septième forêt la plus visitée de l’agglomération parisienne, elle forme avec la forêt d’Halatte et la forêt d’Ermenonville, le massif des Trois Forêts.
| ||
 L’équitation en Bretagne est pratiquée dès l'époque celte, perdurant par nécessité militaire et pour les déplacements. Si les courses de chevaux représentent une tradition très ancienne en Basse-Bretagne, le sport hippique, codifié en Angleterre, s'implante au XIXe siècle, au détriment de traditions plus populaires. La pratique de l'équitation se raréfie avec l'amélioration des transports aux XIXe siècle et XXe siècle, avant de connaître de profondes mutations causées par la croissance des marchés du sport et du loisir. Le tourisme équestre est désormais très présent en Bretagne, notamment le long du circuit régional de randonnée Equibreizh. Les sports équestres ont valu, depuis la fin du XXe siècle, des récompenses européennes et mondiales à des Bretons, en particulier en endurance grâce à des cavaliers de niveau international comme Stéphane Fleury et Élodie Le Labourier. Nonobstant, la plupart des compétitions équestres organisées en Bretagne concernent le saut d'obstacles, en particulier au stade équestre du Val Porée et à Lorient. |
 Les Jeux olympiques d'hiver de 1960, officiellement connus comme les VIIIes Jeux olympiques d'hiver, ont lieu à Squaw Valley aux États-Unis, du 18 au . En 1955, le Comité international olympique fait le choix inattendu d'attribuer les Jeux d'hiver de 1960 à Squaw Valley. La station est alors très peu développée. Tous les équipements sportifs et les infrastructures sont construits ou améliorés entre 1956 et 1960 pour un coût de 80 millions de dollars. Les athlètes logent dans le premier véritable village olympique et les organisateurs conçoivent les sites pour que les spectateurs et les athlètes puissent les atteindre à pied. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont produites par Walt Disney et diffusées par la chaîne CBS. C'est la première fois que les droits de télévision pour diffuser les Jeux olympiques sont vendus au plus offrant. C'est aussi la première fois depuis 28 ans que les Jeux sont organisés en Amérique du Nord. 665 athlètes de 30 nations participent à 4 sports et 27 épreuves. Le patinage de vitesse féminin et le biathlon font leurs débuts olympiques. Les organisateurs décident de ne pas construire de piste de bobsleigh à cause des coûts élevés et du faible nombre de participants. C'est la seule fois de l'histoire que ce sport n'est pas au programme des Jeux d'hiver. L'Union soviétique est de loin la nation la plus médaillée : elle gagne 21 médailles, dont 7 en or. Les patineurs de vitesse soviétiques Evgueni Grichine et Lidia Skoblikova sont les seuls doubles champions olympiques. Le bûcheron suédois Sixten Jernberg ajoute une médaille d'or et une d'argent aux quatre récompenses obtenues aux Jeux d'hiver de 1956. Avec ses trois médailles gagnées quatre ans plus tard, il finit sa carrière avec 9 médailles olympiques. En 1964, c'est l'athlète le plus médaillé de l'histoire aux Jeux d'hiver. La situation politique affecte la préparation des Jeux. Les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique s'intensifient et le CIO est obligé de débattre sur la participation de la Chine, de Taïwan, de la Corée du Nord et de l'Allemagne de l'Est à cause de la Guerre froide. En 1957, le gouvernement américain menace de refuser les visas aux athlètes des pays communistes. Le CIO menace donc de retirer l'organisation des Jeux d'hiver de 1960 à Squaw Valley. Sous la pression internationale, les États-Unis autorisent la participation des sportifs des pays communistes.
| ||
 Larry Clark Robinson (né le à Winchester en Ontario, Canada) est un joueur et entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Mesurant 1,93 mètre et ayant une masse de 100 kg, Larry Robinson est un grand et imposant défenseur, pourtant mobile et agile sur les patins. Il joue dix-sept saisons pour les Canadiens de Montréal et trois de plus avec les Kings de Los Angeles. Il remporte à deux reprises le trophée James-Norris, trophée remis chaque année au meilleur défenseur de la LNH, et une fois le trophée Conn-Smythe du meilleur joueur des séries éliminatoires. Il remporte avec les Canadiens six Coupes Stanley. Un des défenseurs les plus dominants de sa génération, il fait partie d'une des meilleures brigades défensives de l'histoire de la LNH : en compagnie de Serge Savard et Guy Lapointe, ils forment le Big Three. À la fin de sa carrière, il occupe le premier rang de l'histoire chez les joueurs de la LNH pour son différentiel de +730 ; il arrête sa carrière de joueur en 1992 après avoir joué 1 384 rencontres en saison régulière et 227 lors des séries. Lors de sa retraite, il devient entraîneur assistant des Kings puis entraîneur en chef de la même équipe pour la saison 1995-1996. Après quatre saisons passées en tant qu'entraîneur principal des Kings, il rejoint les Devils du New Jersey qu'il mène à la victoire de la Coupe Stanley lors de la saison 1999-2000. Le 19 novembre 2007, son chandail numéro 19 est retiré au Centre Bell. |
 L’édition 2005 de Taboo Tuesday est une manifestation de catch professionnel télédiffusée et visible uniquement en paiement à la séance. L'événement, produit par la World Wrestling Entertainment (WWE), a eu lieu le dans la salle omnisports iPayOne Center (devenue aujourd'hui Valley View Casino Center) à San Diego, en Californie. Il s'agit de la deuxième édition de Taboo Tuesday, pay-per-view durant lequel les spectateurs ont la possibilité de choisir les stipulations des matchs. Le main event de la soirée est un Triple Threat match, match simple faisant intervenir trois catcheurs, pour le championnat de la WWE. John Cena, le champion en titre, remporte la rencontre face à Kurt Angle et Shawn Michaels. La rencontre pour le championnat intercontinental de la WWE oppose Triple H à Ric Flair dans un Steel Cage match, combat se déroulant à l'intérieur d'une grande cage en acier. Ric Flair conserve son titre en sortant le premier de la cage. Enfin, les deux seuls représentants de la division SmackDown, Rey Mysterio et Matt Hardy, défont Chris Masters et Snitsky dans un match par équipe sans enjeu... • Lire l'article
| ||
 Théophane ou Jean-Théophane Vénard, né le à Saint-Loup-sur-Thouet et mort le à Hanoï, est un prêtre des Missions étrangères de Paris. Missionnaire au Tonkin, il y est condamné à mort et exécuté. Il est par la suite déclaré bienheureux, puis saint par l'Église catholique. Après ses études, il entre au séminaire et décide de devenir prêtre missionnaire au sein des Missions étrangères de Paris. Ordonné prêtre en 1852, il est envoyé en Chine comme missionnaire. Après un long voyage de plus de sept mois, il arrive à Hong Kong, porte d'entrée de la Chine. Après avoir attendu son affectation, il est finalement nommé au Tonkin, la partie nord de l'actuel Viêt Nam. Entré clandestinement au Tonkin en 1854, il apprend le vietnamien et se met au service de son évêque. La situation est alors difficile pour les chrétiens et les persécutions sont intenses contre eux. Il se réfugie dans des grottes ou des cachettes, protégé par des villageois chrétiens. Il y traduit des épîtres en vietnamien et est nommé supérieur du séminaire. En 1860, il est dénoncé par un villageois et capturé, puis exécuté l'année suivante par décapitation. Les nombreuses lettres qu'il a écrites tout au long de sa vie, et notamment pendant sa période missionnaire, sont recueillies et publiées par son frère Eusèbe après sa mort. Elles font grande impression en France. Thérèse de Lisieux le considère comme un saint qui lui ressemble, affirmant à la lecture de ses écrits : « ce sont mes pensées, mon âme ressemble à la sienne », et contribuant à en faire, pour les catholiques, l'un des martyrs les plus populaires du XIXe siècle. De nombreuses similitudes existent entre la spiritualité de Théophane Vénard et celle de Thérèse de Lisieux, tant dans la recherche de la petitesse spirituelle que sur la vision de la mission. Le procès en béatification de Théophane Vénard s'ouvre peu après sa mort. Il est béatifié en 1909, puis canonisé en 1988 par Jean-Paul II. Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme |
 La Rochelle est une ville du Sud-Ouest de la France, capitale historique de l'Aunis et préfecture du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle est la commune la plus peuplée du département, devant Saintes, Rochefort et Royan. Ses habitants sont appelés les Rochelais et les Rochelaises. Située en bordure de l’océan Atlantique, au large du pertuis d'Antioche, et protégée des tempêtes par la « barrière » des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix, la ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le XIIe siècle. Elle conserve plus que jamais son titre de « Porte océane » par la présence de ses trois ports (de pêche, de commerce et de plaisance). Cité millénaire, dotée d’un riche patrimoine historique et urbain, La Rochelle est aujourd’hui devenue la plus importante ville entre l'estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde. Ses activités urbaines sont multiples et fort différenciées. Ville aux fonctions portuaires et industrielles encore importantes, elle possède un secteur administratif et tertiaire largement prédominant que viennent renforcer son université et un tourisme en plein développement. | ||
|
La ligne 10 du métro de Paris est une des seize lignes du réseau métropolitain de Paris. Son parcours traverse d'est en ouest les quartiers situés sur la rive gauche de la Seine dans la moitié sud de Paris, ainsi que le quartier d'Auteuil et la ville de Boulogne-Billancourt, reliant les stations Gare d'Austerlitz à Boulogne - Pont de Saint-Cloud. La ligne 10, dont le parcours est entièrement souterrain, est longue de 11,7 kilomètres et comporte vingt-trois stations. C'est la moins fréquentée du réseau, mises à part les deux courtes lignes de rabattement, les 3bis et 7 bis. On y a expérimenté un matériel roulant original de type articulé, le MA 51, qui a de nos jours été remplacé par des rames à roulement fer plus classiques de type MF 67. Son histoire est liée à celle des lignes 7, 8 et 13. Une partie de la section d'origine a été reprise par la ligne 13 ; elle a utilisé une partie de la ligne 7 pendant plus d'un an et enfin elle a repris le tronçon occidental de la ligne 8 quand celle-ci a changé de terminus pour Balard. Elle est l'une des lignes du métro de Paris dont le tracé a le plus évolué au cours de son histoire. Les parois des tunnels de cette ligne ont la particularité d'être peintes en blanc, ce qui lui confère une luminosité que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur le réseau. Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer |
 Hôtel Chevalier (Hotel Chevalier) est un court-métrage écrit et réalisé par Wes Anderson et sorti en 2007. Natalie Portman et Jason Schwartzman y jouent le rôle de deux amants qui se retrouvent dans une chambre d’hôtel à Paris. Ce court-métrage de treize minutes sert de prologue au film de Wes Anderson sorti en 2007, À bord du Darjeeling Limited. Il est tourné dans un hôtel parisien par une équipe réduite et est financé par Wes Anderson qui pensait initialement en faire un court-métrage autonome. Il est montré pour la première fois au festival du film de Venise (la Mostra de Venise) dans le cadre de la première de À bord du Darjeeling Limited le 2 septembre 2007 et il est ensuite diffusé plus tard dans le mois dans les Apple Stores de quatre villes américaines. Le lendemain de sa sortie il est mis à disposition gratuitement sur l’iTunes Store, et ce pendant un mois ; il est téléchargé plus de 500 000 fois durant cette période. Hôtel Chevalier est un des courts-métrages les plus commentés en 2007, avec une part importante de cette attention orientée vers la scène de nu de Natalie Portman. Le film est quasiment universellement acclamé par la critique qui loue sa richesse, son caractère poignant et sa construction méticuleuse.
| ||
 Jean-Pierre Mocky, de son vrai nom Jean-Paul Adam Mokiejewski, né le à Nice, est un acteur, scénariste et réalisateur français. Il débute en tant qu'acteur au cinéma et au théâtre. Il joue notamment dans Les Casse-pieds (1948) de Jean Dréville, Orphée (1950) de Jean Cocteau ou Le Gorille vous salue bien (1957) de Bernard Borderie. Mais c'est surtout en Italie qu'il devient célèbre, notamment grâce à son rôle dans Les Vaincus de Michelangelo Antonioni. Après avoir travaillé comme stagiaire auprès de Luchino Visconti pour Senso (1954) et de Federico Fellini pour La strada (1954), il écrit un premier film, La Tête contre les murs (1959) et projette de le réaliser lui-même, mais le producteur préfère confier cette tâche à Georges Franju. Il passe à la réalisation l'année suivante avec Les Dragueurs (1959). Depuis lors, il n'a jamais cessé de tourner. Dès les années 1960, il a su toucher un vaste public avec des comédies déjantées comme Un drôle de paroissien (1963) ou La Grande Lessive (!) (1968). Après mai 68, il se tourne vers le film noir avec Solo (1969) dans lequel il montre un groupe de jeunes terroristes d'extrême gauche puis L'Albatros (1971) qui montre la corruption des hommes politiques. Dans les années 1980, il renoue avec le succès avec un film dénonçant, un an avant le drame du Heysel, les dérives de certains supporters de football (À mort l'arbitre, 1984) puis une comédie dénonçant les hypocrisies autour du pèlerinage de Lourdes (Le Miraculé, 1987). Dans les années 1990 et 2000, ses films rencontrent moins de succès mais Jean-Pierre Mocky continue de tourner avec autant d'enthousiasme. Il a ainsi réalisé plus de 60 longs métrages. Son cinéma, souvent satirique et pamphlétaire, s'inspire généralement de faits de société. Il travaille avec peu de moyens et tourne très rapidement. Il a notamment tourné avec Bourvil (Un drôle de paroissien, La Cité de l'indicible peur, La Grande Lessive (!) et L'Étalon), Fernandel (La Bourse et la Vie), Michel Simon (L'Ibis rouge), Michel Serrault (douze films dont Le Miraculé), Francis Blanche (cinq films dont La Cité de l'indicible peur), Jacqueline Maillan (cinq films) et Jean Poiret (huit films). Il a reçu en 2010 le prix Henri-Langlois pour l'ensemble de sa carrière. |
Henri Storck est un cinéaste et documentariste belge né à Ostende le et décédé à Uccle (Bruxelles) le . Auteur de plus de soixante films, célèbre pour des courts-métrages comme Misère au Borinage, son nom reste associé durablement à l’école documentaire belge, un peu à la manière d’un John Grierson dans le cas du mouvement britannique. Henri Storck commence par tourner des essais documentaires d'avant-garde sur sa ville natale puis, il expérimente le found footage et réalise quelques films militants. À la Libération, il devient en Belgique un cinéaste au statut quasi officiel, le Père du documentaire belge. Il a inspiré de nombreux cinéastes belges et les frères Dardenne, recevant la palme d'or pour Rosetta, lui ont rendu hommage. | ||
 Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle. |
 Le voyage de Charles de Gaulle en Amérique du Sud est une série de visites d'État effectuées par le président de la jeune Ve République française en Amérique du Sud entre le et le 1964. Durant ce périple de trois semaines et 32 000 km, le plus long effectué par Charles de Gaulle, il visite le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil. Ce voyage est motivé par la volonté du président français de tourner la page de la décolonisation, après la fin de la guerre d'Algérie en 1962, et de poursuivre sa « politique de grandeur » en mettant l'accent sur la coopération, notamment en resserrant les liens entre la France et l'Amérique latine. L'opération fait l'objet d'une préparation minutieuse par le Quai d'Orsay et les ambassades françaises des pays concernés. Le voyage est précédé d'une visite au Mexique, du 16 au 19 mars 1964, au cours de laquelle de Gaulle lance son célèbre « Marchemos la mano en la mano ». De Gaulle, accompagné d'une délégation française, effectue le périple en Caravelle. Par deux reprises, il voyage aussi à bord du croiseur Colbert. La visite du chef d'État français suscite un véritable engouement dans les pays traversés. L'« homme du 18 Juin » est précédé de son aura de chef de la France libre et sait se gagner les faveurs des foules, notamment par ses allocutions en espagnol. Cependant, certaines des thématiques qu'il développe dans ses discours ne sont pas bien reçues par certains pouvoirs en place, notamment sa critique de l'hyperpuissance américaine. Le bilan du voyage est finalement mitigé. Sur le plan de la communication, c'est un franc succès mais qui n'est pas suivi par beaucoup de traductions concrètes. En effet, la France reste un acteur mineur sur le plan économique en Amérique du Sud et la position des États-Unis dans la région n'est pas bousculée. | ||
 La participation du Maroc aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver au Canada, du 12 au 28 février 2010, constitue la cinquième participation du pays à des Jeux olympiques d'hiver. La délégation marocaine est représentée par un seul athlète, Samir Azzimani, en ski alpin, qui est également porte-drapeau du pays lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux. Le Maroc ne remporte aucune médaille durant ces Jeux olympiques, son seul sportif inscrit terminant 44e en slalom et 74e en slalom géant. |
Le Crédit Agricole Centre France est l'une des 39 caisses régionales du Groupe Crédit agricole. Elle est implantée sur 2 régions (Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine) et 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy-de-Dôme. Près d'un habitant sur 2 de ce territoire est client du Crédit agricole Centre France, soit 900 000 clients. Le Crédit agricole Centre France compte 136 Caisses locales. Ces coopératives de base forment le socle du fonctionnement du groupe Crédit agricole. Les sociétaires des Caisses locales élisent ainsi 1 702 administrateurs. En 2010, le Crédit agricole Centre France rassemble 175 000 sociétaires. En savoir plus sur Crédit Agricole Centre France...
| ||
 Saint-Quentin-sur-Indrois (prononcé [sɛ̃ kɑ̃.tɛ̃ sy.ʁ‿ɛ̃d.ʁwa]) est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire et l'ancienne province de Touraine. Dès le Néolithique, l'Homme s'installe à Saint-Quentin, sur le plateau fertile de la Champeigne tourangelle. Cette occupation est pérenne au fil des millénaires, attestée par les vestiges de mégalithes, de tumulus, de voies antiques et de sarcophages mérovingiens. L'histoire médiévale de la paroisse, dont le nom apparaît dans les textes vers la fin du XIIe siècle, est marquée par les figures de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé qui y naquit et d'Adam Fumée, médecin et proche conseiller de plusieurs rois de France qui se rendit acquéreur du château des Roches. Saint-Quentin fut également le lieu d'une des scènes d'une tentative d'enlèvement politique du sénateur Clément de Ris à l'instigation de Fouché. Partagée entre le plateau de la Champeigne au nord, la forêt domaniale de Loches au sud et parcourue dans sa partie médiane par la vallée de l'Indrois, Saint-Quentin offre une grande variété de paysages et d'habitats naturels qui hébergent une flore et une faune très diversifiée. Son territoire communal est d'ailleurs intégré à un site du réseau Natura 2000 et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). La courbe démographique de Saint-Quentin-sur-Indrois présente une physionomie très comparable à celle d'autres communes rurales du même département. Après un exode rural important entre les années 1880 et la fin des années 1960, la commune regagne peu à peu une part de sa population depuis le dernier quart du XXe siècle et compte, en 2014, 512 habitants. Ce redressement ne se traduit pourtant pas par une redynamisation de l'économie locale : les habitants de Saint-Quentin-sur-Indrois travaillent en très grande majorité en dehors de la commune, sur les pôles d'emploi attractifs constitués par Amboise et Loches, que dessert la même route passant par Saint-Quentin-sur-Indrois. |
 La réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon est une réserve écologique du Québec (Canada) située à Shannon. Cette réserve de 169 hectares a pour mission de protéger une tourbière ombrotrophe qui s'est développée en milieu deltaïque. Il s'agit d'une tourbière bombée qui s'est formée sur les dépôts d'un ancien delta de la rivière Jacques-Cartier sur la mer de Champlain. On y retrouve deux espèces d'orchidées susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables, soit la platanthère à gorge frangée et la listère du Sud. Elle a été protégée en 2011 et elle est administrée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. | ||
|
 Abidjan est la capitale économique de la Côte d’Ivoire, dont la capitale administrative et politique est Yamoussoukro, et la ville la plus peuplée de l’Afrique de l’Ouest francophone. Elle compte, selon les autorités du pays, en 2006, 5 068 858 habitants pour l’agglomération, et 3 796 677 habitants pour la ville, soit 20 % de la population totale du pays. Seule Lagos, l’ancienne capitale anglophone du Nigeria la dépasse en nombre d’habitants dans cette région. Considérée comme le carrefour culturel Ouest africain voire africain, Abidjan connaît une perpétuelle croissance caractérisée par une forte industrialisation et une urbanisation galopante. | ||
 Grani (ou Greyfell) est, selon les textes qui composent l'Edda poétique et la Völsunga saga, dans la mythologie nordique, un cheval gris fils de la propre monture à huit jambes d'Odin, Sleipnir. Il est capturé puis chevauché par le héros Sigurd grâce aux conseils d'un vieil homme qui est en fait le dieu Odin déguisé. Ce cheval est ensuite mentionné durant plusieurs épisodes où il accompagne Sigurd dans ses aventures. Grani possède des pouvoirs merveilleux, une grande force ainsi qu'une remarquable intelligence, il le prouve notamment en franchissant le cercle de flammes qui entoure la valkyrie Brunehilde et en refusant de se laisser chevaucher par un autre que son maître (dans la Völsunga saga), puis en pleurant la mort de Sigurd auprès de Guðrún, la femme de celui-ci (dans le Guðrúnarkviða II). Plusieurs théories ont été proposées, notamment par Carl Gustav Jung, pour décrypter sa symbolique, et voient dans Grani un animal psychopompe lié au feu. L'histoire de Grani, étroitement liée à celle de Sigurd (ou Siegfried selon les versions) a été reconstituée de diverses façons et avec plus ou moins de succès à partir de sources fragmentaires anciennes, notamment au XIXe siècle dans de nombreuses adaptations de la légende des Nibelungen, et plus récemment dans La Légende de Sigurd et Gudrún retranscrite par Tolkien, ou encore dans la trilogie de La Malédiction de l'Anneau par Édouard Brasey. Dans l'opéra de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, Grane est le nom du cheval de Brunehilde. |
 Jungle Jack (Jungledyret ou Jungledyret Hugo) est un film d'animation danois réalisé par Stefan Fjeldmark et Flemming Quist Møller, sorti en décembre 1993 au Danemark. Ce film est surtout connu pour être le premier de la société de production A. Film A/S, fondé en partie par le réalisateur Stefan Fjeldmark et le producteur Anders Mastrup en 1988. Tiré du livre pour enfants de Flemming Quist Møller, sorti en 1988, Jungle Jack a obtenu un grand succès dans son pays d'origine. Il est aussi le précurseur de l'arrivée du cinéma d'animation danois sur la scène internationale qui verra aussi des films comme Gloups ! je suis un poisson ou Astérix et les Vikings, eux aussi produits par A. Film A/S. D'autre part, le film est le premier volet d'une trilogie sur le personnage de Jungle Jack : le second volet sort trois ans plus tard, en 1996, et il faut attendre 2007 avant que le troisième volet ne sorte, ce dernier étant réalisé en image de synthèse contrairement aux deux premiers de la franchise. Le personnage a également connu une adaptation en série télévisée en 2003, qui a servi de transition entre les second et troisième volets. Le film est aussi l'occasion à certains membres de l'équipe du film de se faire connaître. Stefan Fjeldmark réalise son premier long métrage avec Jungle Jack ; de même, la jeune chanteuse Kaya Brüel se faire connaître du grand public à travers son rôle de Rita. Jungle Jack est considéré comme un film culte du paysage cinématographique danois. | ||
 La contredanse désigne une danse supposée d'origine anglaise (country dance : danse de campagne), bien que certains historiens la disent d'origine française (contre-danse : danse vis-à-vis). La contredanse anglaise est apparue au milieu du XVIe siècle, et le maître à danser John Playford (1623-1686) lui donna ses lettres de noblesse en publiant, en 1651, The English Dancing Master. La contredanse se diffuse en France à partir de 1684, grâce au maître à danser anglais Isaac et au danseur André Lorin, qui invente un système de notation dont Pierre Beauchamp et Feuillet vont s'inspirer pour fonder une écriture qui aura cours jusqu'au milieu du XIXe siècle. La contredanse anglaise s'est perpétuée jusqu'à nous, notamment sous la forme du reel écossais, tandis que la contredanse française a donné naissance, au début du XIXe siècle, à une forme simplifiée et standardisée, le quadrille. Lire l'article |
 Allosaurus, également francisé allosaure, est un genre fossile de grands dinosaures théropodes ayant vécu durant les étages Kimméridgien et Tithonien du Jurassique supérieur, il y a entre 155 et 145 millions d’années, dans ce qui sont actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe. Le nom générique du taxon signifie littéralement « lézard différent », faisant allusion à ses vertèbres concaves uniques observées au moment de sa découverte. Les premiers restes fossiles pouvant être définitivement attribués à ce genre sont décrits en 1877 par le paléontologue américain Othniel Charles Marsh. Le genre a une taxonomie très complexe et comprend au moins trois espèces valides, dont la plus connue est A. fragilis. La majeure partie des restes d’Allosaurus proviennent de la formation de Morrison en Amérique du Nord, avec du matériel également connu de la formation de Lourinhã au Portugal. Pendant plus de la moitié du , l'animal était connu sous le nom d’Antrodemus, mais une étude des restes abondants de la carrière de dinosaures de Cleveland-Lloyd remet le nom d’Allosaurus au premier plan. Figurant parmi les premiers dinosaures théropodes bien connus, ce dernier attire l'attention en dehors des cercles paléontologiques. Allosaurus figure parmi les plus grands prédateurs bipèdes de son temps. Son crâne est léger, robuste et équipé de dizaines de dents acérées et dentelées. L'animal mesure en moyenne 8,5 m de long chez A. fragilis, les plus gros spécimens étant estimés à 9,7 m de long. Par rapport à ses pattes larges et puissantes, ses mains à trois doigts sont petites et son corps est équilibré par une longue queue musclée. C'est le genre type de la famille des Allosauridae, des dinosaures théropodes appartenant au groupe des carnosauriens. Étant le grand prédateur le plus abondant de la formation de Morrison, Allosaurus se trouvait au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrissait probablement de grands dinosaures herbivores contemporains, avec la possibilité de chasser d'autres prédateurs. Les proies potentielles incluent les ornithopodes, les stégosauridés et les sauropodes. Certains paléontologues interprètent Allosaurus comme ayant eu un comportement social coopératif et chassant en meute, tandis que d'autres pensent que les individus peuvent avoir été agressifs les uns envers les autres et que les congrégations de ce genre sont le résultat d'individus solitaires se nourrissant des mêmes carcasses.
| ||
 Les Aventures de Winnie l'ourson ou Les Merveilleuses Aventures de Winnie l'ourson au Québec (The Many Adventures of Winnie the Pooh) est le 28e long métrage d'animation et le 22e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1977 et basé sur les personnages d'Alan Alexander Milne créés en 1926, ce film est en fait la réunion de trois moyens métrages préexistants : Winnie l'ourson et l'Arbre à miel (1966), Winnie l'ourson dans le vent (1968) et Winnie l'ourson et le Tigre fou (1974), agrémentés de transitions inédites. Les critiques sont peu nombreuses en raison de l'exploitation d'abord en moyen métrage puis en une compilation. Certains spécialistes de Disney font même l'impasse sur ce long métrage dans leur anthologie. Le principal intérêt du film est de regrouper les premiers moyens métrages consacrés à Winnie l'ourson avant que le studio ne se lance à partir des années 1980 dans une exploitation plus large de la franchise Winnie l'ourson, avec des séries d'animations et plusieurs longs métrages. À partir de 2002, les éditions DVD du film Les Aventures de Winnie l'ourson comportent, en bonus, un moyen métrage supplémentaire, Sacrée journée pour Bourriquet, produit en 1983. |
 « J’accuse…! » est le titre d’un article rédigé par Émile Zola lors de l’affaire Dreyfus. Il est publié dans le journal L’Aurore du sous la forme d’une lettre ouverte au Président de la République française, Félix Faure. Alfred Dreyfus est un officier français d’état-major général, d’origine juive, accusé à tort d’avoir livré des documents secrets à l’attaché militaire allemand en poste à Paris, à l’automne 1894. Après une enquête à charge, et sous la pression d’une importante campagne de presse à caractère antisémite, le capitaine Dreyfus est condamné à l’emprisonnement à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Dégradé publiquement, il est expédié sur l’île du Diable, en Guyane française. Sa famille organise sa défense. Peu à peu, les informations s’accumulent à propos d’irrégularités graves dans l’instruction et le procès de 1894. Le véritable traître est finalement officiellement identifié en novembre 1897 : c’est le commandant Walsin Esterházy. Devant le risque d’une contestation populaire et d’un retour de l’affaire sur le devant de la scène, les militaires qui ont fait condamner Dreyfus s’organisent afin que leurs irrégularités ne soient pas exposées publiquement. Pourtant, le lieutenant-colonel Georges Picquart, chef du service des renseignements militaires, avait découvert l’identité du véritable traître dès 1896. Mais il est limogé par l’état-major, qui se livre à des manœuvres de protection du véritable coupable, dont le but est de maintenir coûte que coûte Dreyfus au bagne. À la fin de l’année 1897, le cercle des dreyfusards s’élargit. Le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner décide de prendre fait et cause pour Alfred Dreyfus. De proche en proche, ces rumeurs atteignent Émile Zola, jusque-là totalement étranger à l’affaire Dreyfus. Il publie quelques articles, sans effet majeur. Mais la rumeur enfle. L’état-major de l’armée décide en retour de faire comparaître le commandant Esterházy en Conseil de guerre, où il est acquitté à l’unanimité le 11 janvier 1898… Autres articles sélectionnés au sein du portail Droit
| ||
 L’économie de la culture contemporaine prend le plus souvent comme point de départ l’ouvrage fondateur de Baumol et Bowen sur le spectacle vivant, selon lequel la réflexion sur l’art entre dans l’histoire de la pensée économique dès la naissance de l’économie moderne, soit au XVIIe siècle. Jusqu’à cette époque, les arts avaient une image ambivalente. Ils faisaient en effet l’objet d’une condamnation morale en tant qu’activité dispendieuse offrant peu de bénéfice à la société et liée aux péchés d’orgueil et de paresse. Si on leur trouvait quelque mérite, c’était dans leur valeur éducative, ou dans leur capacité à éviter aux riches de gaspiller leurs ressources dans des activités encore plus néfastes. Au XVIIIe siècle, Hume et Turgot contribuent à donner une image plus positive des activités culturelles, les présentant comme d’utiles incitations à l’enrichissement, et donc à la croissance économique. De son côté, Adam Smith relève les particularités de l’offre et de la demande de biens culturels qui formeront une partie du socle du programme de recherche de l’économie de la culture… |
 Situé à 14 kilomètres à l’ouest de la ville écossaise d’Édimbourg, le pont du Forth est le deuxième plus long pont de type cantilever au monde quant à sa portée libre (le premier étant le Pont de Québec) et le premier de grande taille jamais construit. Sa longueur est supérieure à 2,5 kilomètres. Il est uniquement destiné au trafic ferroviaire et permet de relier le council area d’Édimbourg à celui de Fife and Kinross en enjambant le fleuve Forth. Il constitue ainsi un axe majeur de transport entre le nord-est et le sud-est du pays, doublé depuis 1964 par le pont autoroutier du Forth. Il est inscrit depuis 1999 sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Autres articles sélectionnés au sein du portail Écosse
| ||
 L'identité numérique (IDN) peut être définie comme un lien technologique entre une entité réelle (personne, organisme ou entreprise) et des entités virtuelles (sa ou ses représentation(s) numériques). Le développement et l’évolution des moyens de communication, au travers notamment de la multiplication des blogs et des réseaux sociaux, changent le rapport de l’individu à autrui. Ainsi, l’identité numérique permet l’identification de l’individu en ligne et la mise en relation de celui-ci avec cet ensemble de communautés virtuelles qu’est Internet. Dès lors, l’identité numérique peut être divisée en trois catégories (Georges, 2009) :
Le décalage ou du moins les divergences qui peuvent subsister entre l’identité déclarative et l’identité agissante soulèvent une question majeure. Qui est vraiment l’individu auquel nous avons affaire sur la toile ? Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique |
 L’université de Bretagne-Sud (nom officiel : Bretagne-Sud, abrégée en UBS), est une université publique située dans le département du Morbihan en France. Créée en 1995, l’UBS est la quatrième et la plus jeune université publique bretonne après celles de Rennes-I, Rennes-II et de Bretagne occidentale. Les six composantes de l’université sont réparties sur les campus de Vannes et de Lorient. Une antenne de l’IUT de Lorient est implantée depuis 2001 à Pontivy. L’université est pluridisciplinaire (droit, économie, gestion, arts, lettres, langues étrangères, histoire, géographie, action sociale, mathématiques, informatique, biologie, chimie). Elle forme quelque 7 800 étudiants. Elle est membre de plusieurs pôles de recherche comme l’université européenne de Bretagne, dont elle est co-fondatrice et qui regroupe les principaux centres de recherche bretons, ou encore le réseau des universités de l’Ouest Atlantique qui regroupe les dix universités présentes dans les quatre régions de Bretagne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. Elle dispose par ailleurs d’une fondation depuis le . Autres articles sélectionnés au sein du portail Éducation
| ||
 Ahmôsis Ier (ou Ahmès Ier, Iâhmes Ier ou encore Amosis), dont le nom signifie « Né de Iâh » est un pharaon de l'Égypte antique, fondateur de la XVIIIe dynastie. Il est membre de la maison royale de Thèbes, fils du pharaon Séqénenrê Taâ II et proche parent du dernier pharaon de la XVIIe dynastie, le roi Kamosé. Manéthon lui attribue vingt-cinq années de règne. Il est d'abord roi de Thèbes de -1550/-1549 à -1540, puis de toute l'Égypte jusqu'en -1525/-1524. Pendant le règne de son père ou grand-père, Thèbes s'était déjà révoltée contre les Hyksôs, souverains étrangers qui régnaient sur la Basse-Égypte. Ahmôsis n'a que sept ans lorsque son père est tué au cours de ce conflit. Après avoir régné trois ans seulement, Kamosé, qui est monté sur le trône de Thèbes, meurt de causes inconnues. Ahmôsis a alors environ dix ans quand il monte à son tour sur le trône. Il prend le nom de Neb-Pehty-Rê lors de son couronnement. Durant son règne, il poursuit la reconquête du delta du Nil qui s'achève par l'expulsion des Hyksôs. Il restaure la domination thébaine sur l'ensemble de l'Égypte et réaffirme avec succès la puissance égyptienne au-delà de ses frontières. Les anciens territoires de la Nubie et de Canaan sont alors à nouveau sous son contrôle. Il réorganise l'administration du pays, rouvre des carrières, des mines et des routes commerciales et commence de grands projets de construction d'une importance jamais atteinte depuis le Moyen Empire qui aboutissent à l'édification de la dernière pyramide d'Égypte. Le règne d'Ahmôsis Ier jette les bases du Nouvel Empire, durant lequel la puissance égyptienne atteint son apogée. Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique |
 La machine asynchrone, connue également sous le terme « anglo-saxon » de machine à induction, est une machine électrique à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Les machines possédant un rotor « en cage d'écureuil » sont aussi connues sous le nom de machines à cage ou machines à cage d'écureuil. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcément proportionnelle à la fréquence des courants qui les traversent. La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance. On la retrouve aujourd'hui dans de nombreuses applications, notamment dans le transport (métro, trains, propulsion des navires), dans l'industrie (machines-outils), dans l'électroménager. Elle était à l'origine uniquement utilisée en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, elle est de plus en plus souvent utilisée en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, les machines asynchrones nécessitent un système de démarrage. Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement alimentés par des systèmes de courants triphasés. Autres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique
| ||
 La Bentley 6½ Litre ou Bentley 6,5 Litre est une automobile sportive de luxe de la seconde moitié des années 1920, développée par le constructeur automobile britannique Bentley. Destinée à concourir en compétition, elle doit d’une certaine manière assurer la relève de la Bentley 3 Litre, la première automobile du constructeur, dont le palmarès sportif compte, en 1926, une victoire aux 24 Heures du Mans. Créée en 1923 et se déroulant sur le circuit de la Sarthe, cette course d’endurance de 24 heures séduit rapidement de nombreux pilotes et écuries, dont Bentley, qui y engage officiellement plusieurs automobiles dès 1925. Cependant, la concurrence se fait de plus en plus vive, les performances et les vitesses de pointe des automobiles de course ne cessant d’augmenter. Pour préserver sa compétitivité, Bentley développe son premier moteur 6 cylindres en ligne d’une cylindrée de 6,6 litres, capable de délivrer une puissance de 147 ch. Pour autant, la 6½ Litre ne connaîtra que des déboires, mettant Bentley dans une situation difficile. En 1928, Bentley entame la production d’une déclinaison plus performante de la 6½ Litre, grâce notamment à l’ajout d’un second carburateur. Connue sous le nom de Bentley Speed Six, cette version améliorée redore le blason de la 6½ Litre, en signant deux victoires consécutives aux 24 Heures du Mans 1929 et 1930 – succédant ainsi dignement à la 3 Litre et à la 4½ Litre, qui ont respectivement remporté les trophées de 1927 et de 1928 –, faisant d’elle l’une des plus fameuses automobiles du début du XXe siècle et de Bentley, l’un des constructeurs automobiles les plus célèbres. |
 La machine à vapeur est une invention dont les évolutions les plus significatives datent du XVIIIe siècle. C'est un moteur thermique à combustion externe, il transforme l'énergie thermique que possède la vapeur d'eau fournie, par une ou des chaudières, en énergie mécanique. Comme première source d'énergie d'origine mécanique constructible et maitrisable par l'Homme (contrairement à l'énergie de l'eau, des marées et du vent, qui nécessite des sites spéciaux, que l'on ne peut actionner facilement à la demande), elle a eu une importance majeure, lors de la Révolution industrielle. Mais au XXe siècle, elle a été supplantée par la turbine, le moteur électrique et le moteur à combustion interne. Lire l'article
| ||
 Le Livre d'heures d'Étienne Chevalier est un ancien livre d'heures manuscrit, œuvre de Jean Fouquet réalisée entre 1452 et 1460. Aujourd'hui en grande partie détruit, seuls 49 feuillets contenant 47 miniatures subsistent, dispersés dans huit lieux de conservation différents en Europe et aux États-Unis. Quarante de ces feuillets sont exposés au musée Condé à Chantilly (ms.71). Commandé par Étienne Chevalier, trésorier du roi Charles VII, ce livre est décoré par l'un des plus célèbres peintres et enlumineurs français du XVe siècle, Jean Fouquet. C'est au début du XVIIIe siècle que les miniatures du manuscrit sont découpées et vendues séparément, le reste du texte étant en grande partie détruit. L'ensemble de l'ouvrage, bien que sa reconstitution exacte soit complexe, présente des cycles originaux d'illustrations de la vie du Christ, de la Vierge et de vies de saints, qui se retrouvent rarement dans d'autres manuscrits de cette époque. Chaque miniature constitue un petit tableau en soi, assimilant des influences italiennes et flamandes mais tout en présentant un caractère typique de l'enluminure française de son époque, à la jonction entre le Gothique et la Renaissance. Elles contiennent des mises en page novatrices et font preuve d'une grande maîtrise de la géométrie et surtout de la perspective, alors naissante, dans leur composition. En outre, un grand nombre d'édifices et de paysages de la fin du Moyen Âge, de Paris ou d'ailleurs, y sont représentés avec un grand réalisme. L'iconographie de ces miniatures marque durablement tout un courant de l'enluminure française de son siècle, mais surtout, elle fascine un grand nombre d'historiens et d'esthètes à l'époque contemporaine, qui contribuent à en faire l'une des œuvres enluminées les plus célèbres de son temps. Autres articles sélectionnés au sein du portail de l'enluminure |
 Tintin au pays des Soviets (titre complet sur la couverture : Les Aventures de Tintin, reporter du « Petit Vingtième », au pays des Soviets) est le premier album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, créée par Hergé, dessinateur belge. Alors responsable du Petit Vingtième, le supplément jeunesse du journal belge Le Vingtième Siècle, Hergé reçoit de son rédacteur en chef l'abbé Norbert Wallez commande d'une bande dessinée dont le héros ferait un reportage en URSS. L'abbé fournit à Hergé le pamphlet Moscou sans voiles, dont l'auteur s'inspire très fortement, ce qui fait de cette aventure une critique particulièrement virulente du régime communiste. Hergé considère cette œuvre comme une « erreur de jeunesse ». Bien qu'il fasse preuve d'inconstance dans le caractère des personnages et dans le ton anticommuniste, Hergé y introduit l'usage exclusif du dessin et des phylactères dans la bande dessinée européenne, comme Alain Saint-Ogan avant lui, et fait preuve d'un réel talent pour représenter le mouvement et le son. Outre la première apparition des célèbres personnages Tintin et Milou, plusieurs moments de l'album sont passés à la postérité, par exemple la scène de la manipulation des élections. L’histoire est prépubliée dans Le Petit Vingtième du 10 janvier 1929 au 8 mai 1930, puis paraît en album en septembre 1930. Elle est également publiée dans le magazine français Cœurs vaillants à partir d'octobre 1930. Rapidement introuvable en librairie et victime de la contrefaçon sur le marché noir, l'album n'est réédité par les éditions Casterman qu'en 1973, au sein des Archives Hergé. Cette histoire n'a jamais été redessinée par les Studios Hergé : c'est la seule de l'ensemble des Aventures de Tintin à être restée dans son format original, en noir et blanc. | ||
 La Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (SOLIBRA) est une société anonyme de droit ivoirien créée en 1955 sous l’appellation « Société de limonaderies et glaces d’Abidjan » (SOCIGLACE) et alors spécialisée dans la fabrication de boissons gazeuses et de glace. Elle prend son nom actuel en 1958 lorsqu’elle s’assure le concours de la société anonyme « Brasserie Artois » (plus importante brasserie de Belgique) et ouvre ses activités au marché de la bière en Côte d’Ivoire. Depuis 1994, la Société de limonaderies et brasseries d’Afrique a été rachetée par le groupe BGI (Brasseries et glacières internationales, filiale du Groupe Castel). La Solibra, qui a un capital de 4 110 000 000 FCFA au , est cotée à la bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM) où elle a obtenu le 3e prix Palmes BRVM de l’édition 2006. |
 Le premier club d'espéranto naît en 1888 sur les ruines du club de volapük de Nuremberg lorsque ses membres découvrent la langue proposée par le Zamenhof. C'est aussi dans cette même ville de Nuremberg, en 1889, que paraît La Esperantisto, le premier journal en Langue Internationale. Le cercle des personnes qui se lancent dans son étude s'agrandit. La liste des mille premières adresses paraît la même année avec cinq noms en France, dont celui de Louis de Beaufront. Autres articles sélectionnés au sein du portail Espéranto
| ||
 L'artiste américaine Madonna a entamé sa carrière d'actrice dès 1979, avant même d'avoir enregistré son premier 45 tours, en jouant dans le film underground A Certain Sacrifice, qu'elle a tourné entre 1979 et 1981 lors de son arrivée à New York. Toutefois, c'est en 1985 que sa carrière d'actrice débute vraiment grâce au film Recherche Susan désespérément. Les critiques positives pour ses débuts dans ce qui est son premier film commercial la poussent à participer à plusieurs films, dont les films à succès Dick Tracy (1990), Une équipe hors du commun (1992) et Evita (1996), pour lequel elle reçoit un Golden Globe de la meilleure actrice en 1997. Cependant, la plupart de ses films ont été des échecs critiques et commerciaux, lui rapportant 11 nominations pour les Razzie Awards entre 1987 et 2010, dont 9 récompenses, faisant d'elle l'actrice ayant reçu le plus de fois un Razzie Award. Non seulement actrice au cinéma, elle a joué dans trois pièces de théâtre, produit plusieurs films à travers sa société de production Maverick et réalisé deux films, Obscénité et Vertu en 2008 puis W./E. : Wallis & Édouard en 2011, pour lequel elle a gagné un Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Masterpiece, ainsi que quelques spots publicitaires. Deux documentaires à succès ont suivi les coulisses de deux de ses tournées mondiales : In Bed with Madonna (1991) et I'm Going to Tell You a Secret (2005). Madonna a également contribué à plusieurs bandes originales de films, avec notamment Crazy for You et Gambler (extraites de Vision Quest), Into the Groove (extraite de Recherche Susan désespérément), Live to Tell (extraite du film Comme un chien enragé), Who's That Girl (extraite du film éponyme), This Used to Be My Playground (extraite d'Une équipe hors du commun), I'll Remember (extraite du film Avec les félicitations du jury), Beautiful Stranger (extraite du film Austin Powers 2 : L'Espion qui m'a tirée) et Die Another Day pour le 20e James Bond, Meurs un autre jour. |
 Le Murray (en anglais : Murray River) est un fleuve d’Australie d'une longueur de 2 530 kilomètres de sa source dans la Cordillère australienne à son embouchure dans l'océan Indien. Né dans les Alpes australiennes, il draine la partie sud-est du pays et se jette dans l’océan Indien près d’Adélaïde après avoir reçu l’apport de ses deux grands affluents : le Murrumbidgee et surtout le Darling. Bien qu'étant le plus long d'Australie, le fleuve présente un débit faible pour un cours d’eau de cette importance en raison des précipitations insuffisantes sur les régions qu'il traverse et de l’utilisation massive de ses eaux par l’agriculture et les villes proches de ses rives. Le Murray, largement présent dans la mythologie des Aborigènes (qui l'appelaient Millewa), n’a été exploré qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle par les Européens installés dans le pays mais a joué ensuite un grand rôle dans la mise en valeur de l’Australie grâce à la navigation de nombreux bateaux à vapeur et au développement des activités agricoles. Sa faune et sa flore endémiques offrent un riche patrimoine naturel, aujourd’hui menacé par l’introduction d’espèces invasives et par la surexploitation de ses eaux. Autres articles sélectionnés au sein du portail Eau
| ||
 Aavasaksa, en suédois Avasaksa, anciennement orthographié Avasaxa, est une colline de Finlande culminant à 242 mètres d'altitude dans la commune d'Ylitornio. Elle est située dans la région et province de Laponie, à quelques kilomètres au sud du cercle polaire arctique, et fait face à la frontière suédoise, délimitée par la rivière Torne, qui coule à l'ouest. Offrant depuis son sommet un large panorama de la nature lapone, elle constitue le point le plus méridional de Finlande permettant l'observation du soleil de minuit. Théâtre de l'expédition Maupertuis au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, la colline est ensuite utilisée comme repère dans l'arc géodésique de Struve au cours du XIXe siècle, ce qui lui vaut de faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005 aux côtés de 33 autres sites de mesures. Site touristique renommé depuis le milieu du XIXe siècle, elle accueille désormais des milliers de visiteurs chaque année. En raison de son intérêt historique et de sa localisation originale, elle a été classée parmi les 27 paysages nationaux de Finlande. |
 Le stade de la Meinau, communément appelé la Meinau, est un stade de football situé à Strasbourg, en France. Il s’agit du principal équipement sportif de la ville. Le site du stade de la Meinau est utilisé pour y jouer au football depuis 1906, lorsque le club du FC Frankonia transforme progressivement la prairie du jardin Haemmerlé en terrain de football. À partir de 1914, le pré est utilisé par le FC Neudorf, qui se renomme Racing Club de Strasbourg en 1919. La première tribune, en bois, est construite en 1921, année où le jardin prend le nom de stade de la Meinau. L’enceinte est rénovée en 1951, avant d’être complètement reconstruite en 1984. De plus de 40 000 places, la capacité est ensuite réduite à 29 000 places, dont 24 000 assises, pour mettre le stade aux normes de sécurité et de confort. La Meinau est le douzième plus grand stade français en nombre de places proposées. Si le club résident est le RC Strasbourg, l’enceinte accueille ponctuellement d’autres évènements sportifs ou culturels. Le stade se situe le long du Krimmeri, un bras non canalisé du Rhin, dans le quartier de la Meinau. | ||
 Le Northrop F-20 Tigershark (initialement F-5G) est un chasseur léger, conçu sur une initiative et des fonds privés et construit par Northrop. Son développement commence en 1975, comme évolution supplémentaire du Northrop F-5E Tiger II, recevant un nouveau moteur qui améliore considérablement ses performances, ainsi qu'une avionique moderne comprenant un radar puissant et flexible. Comparé au F-5E, le F-20 est plus rapide, il accroît sa capacité de combat air-air grâce au BVR, et il possède une gamme complète de modes air-sol capables de tirer la plupart des armes américaines. Avec ces capacités améliorées, le F-20 devient compétitif avec les modèles de chasseurs de l'époque tel que le General Dynamics F-16 Fighting Falcon, mais est beaucoup moins cher à l'achat et à l'emploi. La majeure partie du développement du F-20 est réalisée sous un projet du département de la Défense des États-Unis nommé « FX ». Le but du programme est de développer les avions de chasse qui doivent être capables de combattre les derniers avions soviétiques, mais sans utiliser les technologies sensibles de première ligne utilisées par l'United States Air Force ; le FX doit être vendu à l'étranger sans risquer que les progrès technologiques significatifs tombent entre les mains des Soviétiques. C'est un produit des politiques militaires d'export de l'administration Carter. Northrop fonde de grands espoirs pour le marché international ; cependant, les changements politiques à la suite de l'élection de Ronald Reagan amènent le F-20 à devoir rivaliser pour les ventes face à des appareils comme le F-16, le dernier projet d'avion de chasse de l'USAF. Le programme de développement est abandonné en 1986, après que trois prototypes ont été construits et un quatrième partiellement achevé. Autres articles sélectionnés au sein du portail Forces armées des États-Unis |
 Le Grand Prix automobile du Canada 2011 (Formula 1 Grand Prix du Canada 2011), disputé le sur le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, est la 846e épreuve du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950, la septième manche du championnat 2011 et la quarante-et-unième édition de l'épreuve comptant pour le championnat du monde. La course est marquée par des conditions climatiques extrêmes qui entraînent son interruption pendant plus de deux heures, ainsi que six interventions de la voiture de sécurité. L'épreuve, qui dure au total plus de quatre heures, est remportée par le Britannique Jenson Button. Sebastian Vettel, pilote Red Bull Racing et leader du championnat du monde, termine deuxième après être parti de la pole position et avoir mené soixante-huit des soixante-dix tours de course. Son coéquipier Mark Webber complète le podium. À l'issue de la course, Button se classe deuxième au championnat du monde des pilotes tandis que Vettel conforte sa première place, avec 161 points sur 175 possibles. À la fin du Grand Prix, dix-sept des vingt-cinq pilotes en lice au championnat du monde ont marqué au moins un point. Chez les constructeurs, Red Bull Racing conserve la tête du championnat des constructeurs avec 255 points, devant McLaren et Ferrari. À l'issue de la course, neuf des douze écuries engagées au championnat ont marqué des points, Lotus, Virgin et HRT n'en ayant pas encore inscrit.
| ||
 Levens est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Levensans (ou Levensois). En niçois (Georges Castellana), le toponyme est aussi Levens et ses habitants sont lu Levensan. |
 Anne Jean Marie René Savary, premier duc de Rovigo, est un général français, homme de confiance de Napoléon Bonaparte et, pendant quelques années, son ministre de la Police. Il est né à Marcq, près de Vouziers, dans les Ardennes, le , et mort à Paris le . Fils d'un ancien major roturier, Savary entre tôt dans l'armée, et combat durant les guerres révolutionnaires. Il sert successivement les généraux Custine, Pichegru, Moreau, Férino et Desaix avant d'être remarqué par Bonaparte, dont il devient l’aide de camp. Le Premier Consul lui confie plusieurs missions spéciales, dont le commandement d'une force de renseignement concurrente de la police de Fouché. En 1803, il dénoue le complot de Cadoudal avant de tenir le premier rôle dans l'exécution du duc d'Enghien en mars 1804. Il devient l'homme de confiance du Premier Consul, et un de ses proches, marié, par le bon vouloir de Bonaparte, à une parente de Joséphine de Beauharnais. Général de division en 1805, il s'illustre notamment à la bataille d'Ostrolenka, en 1807. Après la paix de Tilsit, il est envoyé en ambassade en Russie auprès du tsar. En 1808, fait duc de Rovigo par l'Empereur, il part pour l'Espagne. Là, il escorte le prince des Asturies, Ferdinand, à l’entrevue de Bayonne. Retourné en Espagne, Savary y commande les forces françaises jusqu'à l'arrivée du roi Joseph Bonaparte. En juin 1810, l'Empereur confie le ministère de la Police à Savary, en remplacement de Fouché, en qui il n'a plus confiance. Savary s'attache à intensifier la conscription, la propagande impériale et la censure. Il est toutefois ridiculisé par la tentative de coup d'État du général Malet en octobre 1812. L'imminence de la campagne de France pose cependant un problème bien plus grave à l'Empereur. Toujours fidèle à Napoléon, quoique de plus en plus certain de la défaite, Savary quitte Paris avec l'impératrice en mars 1814, laissant Talleyrand offrir les clés de la capitale à l'ennemi. Au retour de l'Empereur, Savary le rejoint aussitôt. Chargé de la gendarmerie, le résultat de la bataille de Waterloo interrompt rapidement sa mission. Savary est fait prisonnier par les Anglais puis par les Autrichiens avant de s'exiler dans l'Empire ottoman après sa condamnation à mort par contumace en 1816. Rejugé en 1819, à sa demande, le duc de Rovigo est innocenté, rétabli dans ses titres, mais mis à la retraite. La chute des Bourbon en 1830 lui donne une dernière occasion de servir. Il participe à la conquête de l'Algérie, de manière brutale, de 1831 à 1833. Cette année-là, malade, il rentre en France, et s'éteint à Paris le . Autres articles sélectionnés au sein du portail France au XIXe siècle
| ||
|
Les mythes maçonniques occupent une place centrale dans la franc-maçonnerie. Issus de textes fondateurs ou de diverses légendes bibliques, ils sont présents dans tous les rites maçonniques et dans tous les grades. Ils utilisent des paraboles conceptuelles et peuvent servir aux francs-maçons de sources de connaissance et de réflexion où l'histoire le dispute souvent à la fiction. Ils s'articulent principalement autour des histoires légendaires de la construction du temple de Salomon, de la mort d'Hiram son architecte, et de la chevalerie. Quelques thèmes mythiques originels font encore partie, de manière plus ou moins importante et explicite, des symboles qui composent le corpus et l'histoire de la franc-maçonnerie spéculative. Certains mythes toutefois n'ont pas eu de réelle postérité, mais transparaissent encore dans quelques hauts grades, ou dans la symbolique de quelques rituels. D'autres empruntent parfois à l'imaginaire médiéval ou à des mystiques religieuses et ne s'encombrent pas de vérités historiques pour créer des filiations légendaires avec des corporations ou des ordres disparus. ' |
 New York (Écouter), officiellement City of New York, autrement connue sous les noms et abréviations de New York City ou encore NYC, est la plus grande ville des États-Unis et se situe dans le sud de l'État de New York, sur la côte Atlantique. La commune comprend cinq arrondissements (en anglais : boroughs) : Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. New York regroupe aujourd'hui l'ensemble des critères caractéristiques d'une ville mondiale. Si elle n'est plus la capitale fédérale des États-Unis depuis plus de deux siècles, New York n'en est pas moins la ville la plus peuplée du pays avec 8 214 426 habitants et un centre décisionnel, économique et culturel majeur. Au cœur d'une agglomération de 19 818 536 habitants qui s'étend sur trois États (l'État de New York, le New Jersey et le Connecticut), New York compte des institutions d'importance mondiale. Parmi ces institutions, on peut notamment citer le siège de l'ONU, le New York Stock Exchange, mais aussi de nombreux sièges de multinationales et des centres culturels et universitaires tels que le Metropolitan Museum of Art, le MoMA, le Lincoln Center ou l'université Columbia et l'université de New York. Autres bons articles du portail Géographie
| ||
 La géométrie projective est une branche des mathématiques qui étudie les notions de perspective et d'horizon. Elle permet de simplifier des théorèmes de géométrie plane comme le théorème de Pappus : le calcul barycentrique est légitimé dans les coordonnées barycentriques. Lire l’article |
Katsia II Dadiani (en géorgien : კაცია II დადიანი ; mort le à Zougdidi) est un prince géorgien qui gouverne la principauté de Mingrélie de 1758 à 1788. Membre de la dynastie des Tchikovani-Dadiani qui règne sur la Mingrélie depuis la fin du XVIIe siècle, il est le fils du prince Otia, à qui il succède à sa mort en 1758. Héritant d'une principauté au cœur de guerres intestines dans la région, il sert d'abord comme proche allié de son suzerain, le jeune roi Salomon Ier d'Iméréthie, qu'il aide durant la bataille de Khressili puis soutient lors de l'assemblée royale de 1759, durant laquelle le royaume interdit la traite des esclaves. Malgré une politique alignée sur celle des autres États géorgiens, Katsia est contraint de rejoindre l'Empire ottoman lors de son invasion de la Géorgie occidentale de 1765, entamant une guerre entre la Mingrélie et l'Iméréthie qui dure jusqu'en 1776 et cause le schisme de l'Église orthodoxe géorgienne occidentale de 1769-1774, malgré de nombreuses tentatives de médiation par le Catholicossat d'Abkhazie, le royaume de Kartl-Kakhétie et la Russie impériale. Durant la guerre russo-turque de 1768-1774, Katsia II change son alliance et rejoint les forces russes du général Tottleben, qui encourage la rébellion mingrélienne contre Salomon Ier et s'engage avec Dadiani à un siège de Poti, qui finit en désastre pour les Russes. Le traité de Koutchouk-Kaïnardji place officiellement la Mingrélie sous protectorat ottoman mais cela ne reste qu'une formalité et seul Poti reste sous possession turque. En 1780, Katsia et Salomon préviennent une large invasion abkhazo-circassienne soutenue par la Turquie durant la bataille de Roukhi, à la suite de quoi il intervient en Abkhazie pour placer sur le trône princier Zourab Chervachidzé. À la suite de la mort de Salomon en 1784, il proclame rapidement David II comme roi d'Iméréthie contre le dauphin légitime, ce qui enclenche une série de révoltes nobiliaires, dont une tentative d'invasion ottomane pour placer le prince Kaïkhosro Abachidzé sur le trône imère. Sous le règne de David II, il s'enrichit et augmente la taille de ses domaines, garantit l'indépendance de jure de la Mingrélie et demande le protectorat de la Russie. | ||
 La Willis Tower (anciennement Sears Tower) est un gratte-ciel de Chicago aux États-Unis, achevé en 1973 et œuvre de l'architecte Bruce Graham. Il a été le plus haut immeuble du monde pendant 25 ans, et des États-Unis pendant 40 ans, avant d'être dépassé en 2013 par le One World Trade Center à New York. Il est à ce jour le deuxième plus haut immeuble du continent américain et de l'Hémisphère ouest. Dépassant l'ancien World Trade Center, c'était également le bâtiment le plus haut du monde (442 mètres et 108 étages) entre 1973 et 1998, jusqu'à la construction de la Tour Petronas de Kuala Lumpur à Malaisie, elle-même étant surclassée le 12 août 2007 par le Burj Khalifa à Dubaï aux Émirats arabes unis (828 m) |
 La Filikí Etería (en grec : Φιλική Εταιρεία) ou Société amicale ou Société des Amis ou Société des Compagnons ou aussi Hétairie des amis fut créée en 1814 à Odessa. L'Hétairie était une société secrète dont le but était l'indépendance de la Grèce soumise à l'occupation ottomane. Elle fut autant une manifestation du sentiment national grec que la cause qui transforma ce sentiment national en insurrection. Elle connut des débuts difficiles, tant au point de vue du recrutement qu'au plan financier. Si, elle ne réussit pas à convaincre Ioánnis Kapodístrias de prendre sa tête, Alexandre Ypsilántis accepta en avril 1820. Elle joua un rôle fondamental dans la préparation et le déroulement de la guerre d'indépendance grecque. Ce fut à l'initiative de la Filikí Etería que le soulèvement se déclencha dans les provinces danubiennes et dans le Péloponnèse. Le 1er janvier 1822, l'indépendance grecque fut proclamée par l'Assemblée nationale réunie à Épidaure. Quinze jours plus tard, le drapeau de l'Hétairie était remplacé par le drapeau grec bleu et blanc. La Société était de fait dissoute. | ||
 La Louisiane était un territoire de la Nouvelle-France, espace contrôlé par les Français en Amérique du Nord, du XVIIe au XVIIIe siècle. Elle fut baptisée en l'honneur de Louis XIV par l'explorateur Cavelier de la Salle. Immense espace allant des Grands Lacs au Golfe du Mexique, elle était divisée en deux secteurs appelés « Haute-Louisiane » (au nord de la rivière Arkansas, appelée parfois le « Pays des Illinois ») et « Basse-Louisiane » (au sud). Le fleuve Mississippi constituait l'épine dorsale de la colonie. Aujourd'hui, l'état américain de la Louisiane est beaucoup plus réduit que le territoire contrôlé par les Français il y a trois cents ans. Explorée sous le règne du Roi Soleil, la Louisiane française fut relativement peu mise en valeur par manque de moyens humains et financiers. La monarchie ne la conserva que pour faire pièce à l’impérialisme anglais en Amérique et joua des alliances avec les divers peuples amérindiens pour se maintenir. Les défaites de la guerre de Sept Ans finirent par avoir raison de la Louisiane française qui dut être cédée aux Anglais et aux Espagnols. La France récupéra un temps sa souveraineté sur ce territoire mais Napoléon Bonaparte décida de s’en séparer définitivement en 1803 au profit des États-Unis. |
 Jean Siméon Chardin (1699–1779) est un peintre français du XVIIIe siècle. Il est surtout reconnu pour ses natures mortes, ses peintures de genre et ses pastels. Admiré de son vivant par Louis XV et Mme de Pompadour autant que par la bourgeoisie cultivée de l’époque, Chardin était un membre notoire de l’Académie des Beaux-Arts. Il possède une remarquable faculté de concentration sur ce qu’il représente, et à propos des natures mortes, Gide va jusqu’à parler d'une « dévotion à l’objet ». Et si l’on a vu en lui le précurseur de Cézanne et du cubisme, il faut ajouter que le génie de Chardin consiste à maîtriser la construction, à la domestiquer, pour qu’elle ne vienne pas troubler la « délectation » du spectateur, pour reprendre l’expression de Poussin. Autres articles sélectionnés au sein du portail Histoire de l'art
| ||
Anna Maria Sibylla Merian (née le 2 avril 1647 à Francfort-sur-le-Main, décédée le 13 janvier 1717 à Amsterdam) était naturaliste et artiste. En raison de ses observations très détaillées sur la métamorphose des papillons et de sa documentation sur le sujet, elle est considérée comme une importante initiatrice de l’entomologie moderne bien que longtemps fort peu connue. Lire l'article |
La saison 1917-1918 est la première saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), nouvelle ligue de hockey sur glace du Canada. Chacune des quatre équipes qui commencent la saison joue vingt-deux parties sauf les Wanderers de Montréal qui ne disputent que six rencontres en raison d'un incendie qui détruit leur patinoire en janvier. Finalement, les Canadiens de Montréal et les Arenas de Toronto finissent en tête des deux parties de la saison mais ce sont les Arenas qui remportent la finale de la LNH. Par la suite, ils jouent et remportent la finale de la Coupe Stanley contre les Millionnaires de Vancouver de l'Association de hockey de la Côte du Pacifique. Autres articles sélectionnés au sein du portail Hockey sur glace
| ||
 Tynwald Day, la fête de Tynwald, est la fête nationale de l’île de Man, généralement célébrée le 5 juillet. Les représentants du pouvoir législatif (Tynwald) se rassemblent exceptionnellement à St John’s et non à Douglas comme ils le font d’ordinaire. La session du parlement a lieu à la fois dans l’église Saint-Jean et sur la butte artificielle de Tynwald Hill. La première occurrence authentifiée de cette pratique remonte à 1417, la session prenant le nom de "Midsummer Court" (cour du solstice d’été). Y assistent les membres des deux chambres du Tynwald, la chambre des clefs (House of Keys), et le conseil législatif de l’île de Man. L’assemblée est généralement présidée par le lieutenant-général gouverneur de l’île de Man, représentant du seigneur de Man (en l’occurrence la Couronne britannique), sauf dans les cas où un membre de la famille royale est présent. Tous les projets de loi qui ont reçu l’approbation de la couronne sont promulgués le jour de la fête de Tynwald. L’ordre du jour comporte également la présentation de pétitions et l’assermentation de hauts fonctionnaires. Lire l’article |
Lumière sur...Le problème du sac à dos, aussi noté KP (en anglais, Knapsack Problem) est un problème d’optimisation combinatoire. Il modélise une situation analogue au remplissage d’un sac à dos, ne pouvant supporter plus d’un certain poids, avec tout ou partie d’un ensemble d’objets ayant chacun un poids et une valeur. Les objets mis dans le sac à dos doivent maximiser la valeur totale, sans dépasser le poids maximum. Le problème du sac à dos est l’un des 21 problèmes NP-complets de Richard Karp, de son article de 1972. Il est intensivement étudié depuis le milieu du siècle dernier. La formulation du problème est fort simple, mais sa résolution est plus complexe. Les algorithmes existants peuvent résoudre des instances pratiques de taille conséquente. Cependant, la structure singulière du problème, et le fait qu’il soit présent en tant que sous-problème d’autres problèmes plus généraux, en font un sujet de choix pour la recherche. | ||
 L'Assyrie est une ancienne région du Nord de la Mésopotamie, qui tire son nom la ville d'Assur, qui est aussi celui de sa divinité tutélaire, le dieu Assur. À partir de cette région, s'est formé au IIe millénaire av. J.-C. un royaume puissant, qui est devenu, par la suite, un véritable Empire. Aux VIIIe et VIIe siècles av. J.-C., l'Assyrie contrôlait des territoires qui s'étendaient sur la totalité ou sur une partie de plusieurs pays actuels, tels l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie ou encore l'Iran. L'assyriologie, discipline qui étudie l'Assyrie antique et plus largement la Mésopotamie antique, distingue trois phases dans l'histoire assyrienne, sachant qu'avant les environs de 700 av. J.-C., les dates sont approximatives : la période paléo-assyrienne, du XXe au début du XIVe siècle av. J.-C. ; la période médio-assyrienne, jusqu'à 911 av. J.-C. ; et la période néo-assyrienne, jusqu'à 612-609 av. J.-C., date de la fin du royaume assyrien. Schématiquement, pendant la première, l'Assyrie se réduit à la cité-État d'Assur, connue surtout par le dynamisme de ses marchands. La deuxième période voit la naissance du royaume assyrien à proprement parler, en tant qu'État territorial puissant, qui connaît cependant un affaiblissement important au tournant des IIe et Ier millénaires av. J.-C. La troisième période voit l'Assyrie se muer progressivement en un Empire, grâce notamment à sa redoutable armée. C'est par cette période que l'Assyrie est la mieux connue, grâce aux découvertes effectuées à partir du XIXe siècle dans ses capitales successives, Assur, Kalkhu (Nimrud), Dur-Sharrukin (Khorsabad) et Ninive. C'est également la puissance de cet Empire et de ses souverains qui a permis au souvenir de l'Assyrie de perdurer, par la tradition de la Bible hébraïque et des auteurs grecs classiques. La grande quantité de documentation épigraphique et archéologique collectée pour la période assyrienne depuis près de deux siècles permet de bien connaître de nombreux aspects de ce royaume, qui est une des composantes essentielles de la civilisation mésopotamienne ancienne, au même titre que celui qui est devenu son rival méridional, le royaume de Babylone. C'est la dernière phase du royaume qui est, toutefois, de loin la mieux connue. On peut dresser un tableau conséquent de plusieurs aspects de l'administration du royaume, les activités économiques, les composantes de la société, la culture assyrienne, notamment la religion et l'art. De nombreuses zones d'ombre demeurent cependant car la documentation n'est pas répartie de façon homogène selon les lieux, les périodes et les aspects de la vie des anciens Assyriens, du fait de la disparition de nombreuses sources depuis l'Antiquité, mais aussi parce que les découvertes concernent essentiellement le milieu des élites. |
Les Artaxiades ou Artašesian (en arménien Արտաշեսյաններ) sont des rois d'Arménie qui ont régné sur ce royaume d'environ 189 av. J.-C. à environ 12 apr. J.-C. Sous cette dynastie, le pays subit deux influences majeures : une influence perse, qui poursuit son action, et une influence hellénistique croissante ; il s'ouvre en outre au commerce international. Sous l'un des rois artaxiades, Tigrane II, l'Arménie va connaître son expansion maximale, avant de devenir un enjeu, sous ses successeurs, entre Parthes et Romains. À la fin de cette dynastie, au début de l'ère chrétienne, le royaume est proche de l'anarchie et sera pendant plusieurs décennies gouverné par des souverains étrangers, avant de connaître l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie arsacide. À la différence de certains de ses membres, la dynastie artaxiade se caractérise par une historiographie peu développée. Elle est en même temps considérée par la République d'Arménie comme une des quatre dynasties historiques arméniennes et figure à ce titre sur ses armoiries. | ||
 La colonne Nelson (en anglais : Nelson's Pillar, aussi connue comme Nelson Pillar ou simplement The Pillar) était une grande colonne commémorative de granite mesurant près de 37 mètres coiffée par une statue d'Horatio Nelson de 4 mètres, construite au centre de l'avenue qui s'appelait alors Sackville Street (rebaptisée plus tard O'Connell Street) à Dublin, en Irlande. Achevée en 1809, alors que l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, la colonne est gravement endommagée en mars 1966 par des explosifs posés par des membres de l'armée républicaine irlandaise (IRA). Ses vestiges sont ensuite détruits par l'armée irlandaise. La décision de construire le monument est prise par la Dublin Corporation dans l'euphorie suivant la victoire de Nelson à la bataille de Trafalgar en 1805. La première version imaginée par William Wilkins est considérablement modifiée par Francis Johnston pour des raisons de coût. La statue est sculptée par Thomas Kirk. Dès son inauguration le , la colonne est une attraction touristique populaire, mais elle provoque aussitôt une controverse esthétique et politique durable. Un éminent monument du centre-ville honorant un Anglais consterne le sentiment nationaliste grandissant, et tout au long du XIXe siècle, des mouvements appellent à son enlèvement et son remplacement par un monument à la mémoire d'un héros irlandais. Des parties du centre de Dublin sont détruites au cours de l'insurrection de Pâques 1916 ; même si la colonne se trouve près du siège des rebelles, elle demeure indemne. Après la scission de l'île, la partie sud de l'Irlande devient l'État libre d'Irlande en 1922, qui laisse ensuite place à une république en 1949. Une barrière légale s'oppose à tout retrait ou modification du monument du fait qu'il est géré par une fiducie. Les gouvernements irlandais successifs échouent à surmonter ce problème. Bien que des personnalités littéraires influentes telles que James Joyce, William Butler Yeats et Oliver St John Gogarty défendent la colonne pour des raisons historiques et culturelles, la pression pour sa suppression s'intensifie dans les années précédant le 150e anniversaire de son érection. Sa suppression brutale par l'explosion qui brise la colonne en 1966 suivie du retrait du reste de la base, est, dans l'ensemble, bien accueillie du public. Bien qu'il soit largement admis que l'action est l'œuvre de l'IRA, la police se montre incapable d'identifier les responsables. Après des années de débats et de nombreuses propositions, le Spire de Dublin est installé sur le site en 2003. Cette structure en forme d'aiguille mesure plus de trois fois la hauteur de l'ancienne colonne. En 2000, un ancien militant républicain revendique dans une interview la pose des explosifs en 1966, mais après l'avoir interrogé, la police décide de ne pas le poursuivre. Des restes de la colonne se trouvent dans des musées de Dublin ou apparaissent ailleurs comme pierres décoratives. Le souvenir de la colonne apparaît également dans de nombreux ouvrages de la littérature irlandaise. |
 Thomas Andrews (né le et mort le ) est un architecte naval britannique qui a travaillé à la construction de plusieurs paquebots. Il grandit au sein d'une famille aisée, puis devient apprenti dans les chantiers navals Harland & Wolff de Belfast dont le président, Lord Pirrie, est son oncle. Pendant quelques années, Andrews gravit progressivement les échelons avant d'être nommé directeur général de l'entreprise. La réparation du paquebot de la White Star Line Suevic, à laquelle il participe, fait de lui un des architectes navals les plus renommés de son époque. En 1908, Andrews est chargé de superviser la construction de trois grands paquebots de classe Olympic pour la White Star Line. Ces paquebots se démarquent de leurs contemporains par leur taille et leur luxe. Pour l'architecte, ils représentent la consécration de sa carrière. Andrews prête d'ailleurs une attention particulière aux moindres défauts de son premier né, l’Olympic, afin de les corriger sur le deuxième navire, le Titanic. Après de nombreux mois de travail le Titanic entame son voyage inaugural le 10 avril 1912. Thomas Andrews embarque à bord avec son groupe de garantie, composé de huit ouvriers et ingénieurs chargés de prendre en note toutes les imperfections du paquebot. Cependant le 14 avril, le Titanic heurte un iceberg et l'architecte se rend très vite compte que son navire est condamné. Tout au long du naufrage, il participe à l'évacuation des passagers, en mène plusieurs aux canots et s'assure que tout le monde est en possession d'un gilet de sauvetage. De nombreux témoignages font état de son comportement au cours de cette nuit tragique. Andrews meurt dans le naufrage le 15 avril 1912, laissant derrière lui une femme et une petite fille de deux ans. En juin 1912, l'écrivain Shan Bullock signe une biographie faisant l'éloge de Andrews, et sa famille fait construire un mémorial en son honneur, dans sa ville natale. Son nom, ainsi que celui des hommes du groupe de garantie, figure également sur un mémorial érigé à Belfast en 1920. Enfin, le personnage de Thomas Andrews apparaît dans plusieurs documentaires et films consacrés au naufrage, dont le plus connu est celui de James Cameron, Titanic. Autres articles sélectionnés au sein du portail Irlande du Nord
| ||
 Forti Corse, qui deviendra plus tard Forti, est une ancienne écurie de sport automobile italienne qui s'est notamment engagée en Formule 1 lors du championnat du monde 1995 puis du championnat du monde 1996, qu'elle ne termine pas. Créée en 1978, l'écurie a participé à différentes formules de compétition pendant près de deux décennies. Forti Corse a décroché quatre titres de champion des pilotes de Formule 3 italienne obtenus pendant la seconde moitié des années 1980 et quelques victoires en championnats de Formule 3000 auxquels elle a participé entre 1987 et 1994. À partir de 1992, Guido Forti, le cofondateur de Forti, entre en relation avec l'homme d'affaires brésilien Abílio dos Santos Diniz, pour que son fils, Pedro Diniz, ait un baquet permanent dans l'équipe et pour obtenir des moyens financiers pour entrer en Formule 1. Forti s'engage en Formule 1 en tant que constructeur en 1995 mais sa première monoplace, la Forti FG01-95, n'est pas compétitive et ne décroche aucun point. Malgré cet échec, Forti signe un contrat de trois ans avec Diniz, contrat brisé lorsque le pilote brésilien part chez Ligier pour la saison 1996 en emportant avec lui les commanditaires de l'écurie italienne. Néanmoins Forti continue son aventure en Formule 1 et conçoit une nouvelle monoplace, la Forti FG03-96, avant de faire faillite à la mi-saison à la suite des problèmes financiers rencontrés après le rachat par Shannon Racing, une écurie irlandaise de Formule 3000. Forti s'est qualifiée à vingt-trois reprises en Grand Prix, son meilleur résultat en course étant une septième place par Diniz en Australie en 1995 et sa meilleure qualification est une dix-neuvième place par Badoer au Brésil en 1996. Forti est une des dernières écuries privées engagée en Formule 1 à une période où les grands constructeurs automobiles augmentent leur participation en course automobile. |
 Star Wars Episode I : Le Nouveau Monde Gungan (en anglais Star Wars Episode I: The Gungan Frontier) est un jeu de simulation et de stratégie se déroulant dans l'univers Star Wars développé par Lucas Learning, édité par LucasArts et distribué par Ubisoft, sorti le sur Macintosh et Windows. Il s'agit du deuxième jeu développé par ce studio après Star Wars: Droid Works, sorti l'année précédente. L'histoire se déroule peu de temps après les événements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Le peuple Gungan, habitant la planète Naboo, cherche à se développer au-delà des marais de leur planète natale et colonise la lune proche d'Ohma-D'un. La mission du joueur est d'aider la colonisation Gungan en aménageant un écosystème viable sur la lune, préparant l'arrivée des colons Gungans. Le jeu a une vocation éducative, en cherchant à enseigner des principes de base de biologie et d'écologie à un public jeune, à l'instar de Star Wars: Droid Works, qui se concentre pour sa part sur les notions d'énergie, de force et de mouvement, de mécanique simple, de lumière et de magnétisme. Les critiques sont majoritairement positives, certains magazines félicitant l'aspect éducatif du jeu, d'autres regrettant le manque de diversité dans le gameplay. Il obtient de nombreux prix spécialisés dans les jeux éducatifs. Si Le Nouveau Monde Gungan est un jeu relativement mineur dans la saga Star Wars, il marque la première apparition de plusieurs vaisseaux ou membres du bestiaire de Star Wars, réutilisés par la suite dans les autres produits dérivés. | ||
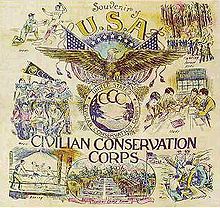 Le New Deal (« Nouvelle donne » en français) est le nom donné par le président américain Franklin Delano Roosevelt à sa politique interventionniste mise en place pour lutter contre les effets de la Grande Dépression aux États-Unis. Ce programme s'est déroulé entre 1933 et 1938, avec pour objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population, de réformer les marchés financiers et de redynamiser une économie américaine meurtrie depuis le krach de 1929 par le chômage et les faillites en chaîne. On distingue communément deux New Deals : le premier, marqué notamment par les « Cent Jours de Roosevelt » en 1933 visait à une amélioration de la situation à court terme. On y retrouve donc des lois de réforme des banques, des programmes d'assistance sociale d'urgence, des programmes d'aide par le travail, ou encore des programmes agricoles. Le gouvernement réalisa ainsi d'importants investissements et permit l'accès à des ressources financières au travers des diverses agences gouvernementales. Les résultats économiques furent mitigés, mais la situation s'améliora. Le « Second New Deal » s'étala entre 1935 et 1938, mettant en avant une redistribution des ressources et du pouvoir à une échelle plus large, avec les lois de protection syndicales, le Social Security Act, ainsi que des programmes d'aide pour les farmers et les travailleurs itinérants. Cependant, la Cour Suprême jugea de nombreuses réformes anticonstitutionnelles, mais, certaines parties des programmes furent rapidement remplacées, à l'exception de la National Recovery Administration. Le second New Deal fut bien plus coûteux que le premier, et creusa le déficit public. Par ailleurs, malgré des programmes comme la Public Works Administration, le chômage touchait encore 11 millions d'Américains en 1938. De nombreux programmes du New Deal restent toujours actifs, dont certains qui ont gardé leur nom originel : on peut ainsi citer la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Federal Housing Administration (FHA), la Tennessee Valley Authority (TVA), mais aussi le Social Security System, première expérience d'État-providence aux États-Unis ainsi que la Securities and Exchange Commission dans le domaine de la régulation financière. |
 La Bèze est une rivière française située dans le département de la Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un affluent de la Saône en rive droite et donc un sous-affluent du Rhône. Provenant d'une exsurgence localisée dans la grotte de la Crétanne, dans le village de Bèze, la rivière traverse plusieurs communes, sur un parcours d'environ 31 km, avant de se jeter dans la Saône, à Vonges. Sa source est l'exutoire d'un vaste réseau souterrain alimenté par les pertes de la Tille et de la Venelle. Sa résurgence, autour de laquelle a été aménagée une promenade, est un haut lieu touristique de la région. La Bèze est au cœur d'un bassin versant qui, avec son affluent principal, l'Albane, irrigue le Pays Saône Vingeanne, sur une superficie totale de 250 km2. Le long de son cours, le paysage alterne entre massifs forestiers et espaces de grandes cultures, prairies d'élevage et étangs. Le bassin abrite quatre Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. L'occupation humaine le long de la rivière a été précoce et commence dès le Paléolithique. À l'époque gallo-romaine, le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze, situé sur un axe de communication important, est un haut lieu de la région. Le site est ensuite occupé par la VIIIe Légion Augusta qui y bâtit un camp militaire imposant. La rivière permet ensuite l'implantation, au Moyen Âge, de l'abbaye Saint-Pierre de Bèze, lieu de convergence du pèlerinage de saint Prudent. La période moderne est marquée par la fondation de la Poudrerie nationale de Vonges qui, pour ses besoins industriels, aménage l'embouchure de la Bèze. Il demeure un important patrimoine bâti à l'eau. La faune et la flore y sont similaires à celles attachées à l'écosystème de la Saône, avec une prédominance de la truite. De nombreux ouvrages hydrauliques touchent toutefois fortement les espèces de rivière. Bien que non polluée, l'eau de la Bèze et de ses affluents est jugée médiocre en raison d'une concentration en nitrate, due aux activités agricoles et d'élevage qui en suivent les cours. La Bèze et son bassin versant ne présentent pas de risques naturels majeurs. | ||
|
...l'Oiseau Canari
|
Le parc national de Padjelanta (en suédois Padjelanta nationalpark, en same de Lule Bádjelándda) est un parc national du Nord de la Suède, à la frontière norvégienne, dans la commune de Jokkmokk du comté de Norrbotten en Laponie. Il couvre 1 984 km2, ce qui en fait le plus vaste parc national du pays, et il est bordé par les parcs nationaux de Sarek, de Stora Sjöfallet et le parc norvégien de Rago. Le toponyme Padjelanta signifie Haute Terre en same, ce qui traduit assez bien la géographie du site. En effet, le parc est avant tout une haute plaine des Alpes scandinaves, d'une altitude d'environ 700 m, avec quelques douces montagnes. Ce paysage contraste fortement avec les zones bordant le parc, au caractère alpin plus marqué, quoiqu'au sud la limite soit moins nette, avec certains hauts sommets dans le parc même. Ceci est dû aux roches du parc, schistes et calcaires, peu résistantes à l'érosion. Le réseau hydrographique est très riche, le parc étant situé à la source du fleuve Luleälven et de plusieurs de ses affluents majeurs. Mais une des principales caractéristiques de Padjelanta est la présence de grands lacs, dont en particulier le Virihaure et le Vastenjaure. Padjelanta, ainsi que le reste de la Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de « plus grande zone encore vierge » d'Europe. En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7 000 ans par les Samis, peuple nomade du Nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier au renne, mais peu à peu ils ont développé une culture fondée sur l'élevage de cet animal associé à des déplacements de transhumance. Padjelanta devint alors l'un des principaux sites d'estive des montagnes, et un grand nombre de camps Samis sont présents dans le parc, souvent à proximité des grands lacs. Pour les Suédois, la zone fut tout d'abord utilisée au XVIIe siècle pour la mine de Kevdekare, de laquelle ils extrayaient de l'argent. Après la fermeture de la mine, c'est surtout l'exploration botanique du parc qui motiva les visites dans la région. En effet Padjelanta possède une flore particulièrement riche, avec un certain nombre d'espèces rares, bien qu'il soit situé quasi-intégralement au-dessus de la limite des arbres. À partir du XXe siècle, le tourisme se développa aussi. C'est l'alliance des associations touristiques et celles de protection de la nature, menée par le botaniste Sten Selander, qui permit la création du parc national en 1962, protégeant ainsi la zone des menaces liées au développement de l'énergie hydroélectrique. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour leur nature préservée et pour leur culture Sami toujours présente. De nos jours, le parc est toujours une zone importante pour l'élevage des rennes par les Samis. C'est aussi une destination touristique, traversée par plusieurs grands sentiers de randonnée, tels que le Padjelantaleden et le Nordkalottleden. Parmi les attractions du sites, les grands lacs sont réputés pour leur beauté. Autres articles sélectionnés au sein du portail Laponie
| ||
 L’e caduc (ou muet, instable voire, dans des ouvrages anciens, féminin ou encore sombre) français est une voyelle virtuelle en ce sens qu'elle peut ou non se manifester dans un mot, selon son environnement (cas de sandhi), selon l'« accent » du locuteur, le registre de langue adopté, entre autres. |
Un logiciel libre est un logiciel que chaque utilisateur a le droit d'utiliser, d'étudier et de modifier sans restriction. Chacun peut aussi le redistribuer sans restriction, si ce n'est l'éventuel devoir de préserver son caractère libre. La notion de logiciel libre est popularisée depuis la première moitié des années 1980 par Richard Stallman, d'abord avec le projet GNU, puis par la Free Software Foundation (FSF) et enfin par des dizaines de milliers de projets indépendants, dont le plus connu est Linux. À la fin des années 1990, le succès des logiciels libres suscite un vif intérêt dans les médias et l'industrie informatique[1]. Les logiciels libres sont souvent présentés comme la principale alternative aux « logiciels propriétaires », notamment ceux de Microsoft. Il ne faut pas confondre les logiciels libres avec des logiciels simplement gratuits (freewares), ni avec les sharewares, ni avec des logiciels tombés dans le domaine public. La notion de logiciel Open source établie par l'Open Source Initiative est en revanche très proche de celle de logiciel libre.
RéférencesAutres articles sélectionnés au sein du portail Linux
| ||
 Sire Gauvain et le Chevalier vert (en anglais Sir Gawain and the Green Knight) est un roman de chevalerie en vers allitératifs datant de la fin du XIVe siècle. Il esquisse une aventure de Gauvain, l’un des chevaliers de la Table Ronde du roi Arthur. Il ne subsiste qu’un seul manuscrit du poème, le Cotton Nero A.x., conservé à la British Library ; il inclut également trois autres poèmes, dont le célèbre Pearl. Ces quatre poèmes narratifs, écrits dans un dialecte du moyen anglais du nord des Midlands de l’Ouest, sont probablement l’œuvre d’un unique auteur, resté anonyme, et appelé dans les études le « Pearl Poet ». Dans ce récit, Gauvain accepte un défi lancé par un mystérieux guerrier entièrement vert. Ce « Chevalier vert » permet à tous de le frapper avec sa hache, mais en échange, celui qui l’aura frappé doit accepter de subir le même coup un an et un jour plus tard. Gauvain accepte et le décapite d’un seul coup, mais le Chevalier se relève, prend sa tête et rappelle à Gauvain sa promesse. Les aventures que vit Gauvain sur le chemin menant à ce rendez-vous permettent de classer cette œuvre dans les légendes arthuriennes impliquant chevalerie et loyauté… |
| ||
 Peder Claussøn Friis, né le à Egersund (Rogaland) et mort le à Valle (commune de Lindesnes, Agder), est un pasteur, historien, traducteur et topographe norvégien. Il est décrit comme un homme au très fort caractère, proche de ses ouailles, bien qu'il ait eu régulièrement fort à faire pour récupérer la dîme auprès des paysans ou pour défendre ces derniers face aux notables. Auteur prolifique, il a traduit la Heimskringla (Saga des rois de Norvège). Il a ainsi fait redécouvrir Snorri Sturluson. Cette traduction, en dehors de ses qualités littéraires, a permis grâce à une édition au XVIIIe siècle qui touchera toutes les couches de la société, de rappeler le passé indépendant de la Norvège mais aussi de réveiller un sentiment d'identité nationale et une volonté des Norvégiens de s'émanciper du Danemark et de sa monarchie absolue. Lecteur de manuscrits anciens comme d'ouvrages de son temps, il écrit lui-même plusieurs ouvrages de topographie où il décrit la Norvège et les îles environnantes dans un style vivant qui deviendra un modèle. De la même manière il écrit toute une série de petits ouvrages sur la faune et la flore. Pasteur passionné, refusant les restes du catholicisme, homme de la campagne toujours prêt à défendre les paysans contre les édiles — hommes de loi et fonctionnaires — lorsqu'il le croit juste, Peder Claussøn Friis est un savant qui a su être en avance sur son temps, que ce soit dans la manière d'aborder son travail, dans le regard critique qu'il peut poser sur les ouvrages scientifiques, ou encore dans le regard qu'il pose sur la Norvège et ses contemporains. Comme l'explique Éric Eydoux : « c'est peut-être hors des deux villes [Oslo et Bergen] qu'il faut chercher l'écrivain le plus marquant de cette époque. » Autres articles sélectionnés au sein du portail Littérature norroise |
 Le Luxembourg participe aux Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres au Royaume-Uni du 27 juillet au 12 août 2012. Il s'agit de sa 23e participation à des Jeux olympiques d'été. La délégation olympique luxembourgeoise, menée par son chef de mission Heinz Thews, compte neuf athlètes, cinq hommes et quatre femmes, répartis dans sept sports différents. Le Luxembourg fait partie des pays n'obtenant pas de médaille à l'issue de ces Jeux olympiques. Parmi les sportifs engagés, le meilleur résultat est obtenu par Marie Muller, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, avec une cinquième place en judo dans la catégorie des moins de 52 kg. Les nageurs Raphaël Stacchiotti et Laurent Carnol sont également cités comme étant des sportifs ayant réussi leurs Jeux olympiques. Carnol, premier Luxembourgeois à atteindre une demi-finale olympique dans son sport, est récompensé en étant nommé porte-drapeau du Luxembourg lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux. | ||
|
L'article qui doit apparaître ici n'a pas encore été sélectionné. |
 Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie, attribué selon la légende au mathématicien et philosophe grec Thalès de Milet ; en réalité Thalès s'est davantage intéressé aux angles opposés dans des droites sécantes, aux triangles isocèles et aux cercles circonscrits. Cette propriété de proportionnalité était connue des Babyloniens. Mais la première démonstration de ce théorème est attribuée à Euclide qui la présente dans ses Éléments (proposition 2 du livre VI) : il le démontre par proportionnalité d'aires de triangles de hauteur égale. Selon la légende, une application a été de calculer la hauteur des pyramides d'Égypte en mesurant la longueur de l'ombre au sol de chaque pyramide, et la longueur de l'ombre d'un bâton de hauteur donnée. | ||
 Une congère, ou un banc de neige au Canada, est un amas de neige résultant de l'action du vent. Lorsqu'il souffle fort, particulièrement en violentes rafales, de grandes quantités de neige peuvent être déplacées et s'accumuler dans les endroits où son effet est le plus faible. À terme, elles peuvent entourer voire recouvrir certains obstacles et deviennent dangereuses en raison de leur poids ou des entraves qu'elles constituent pour la circulation et d'autres activités humaines. La population des pays nordiques a depuis longtemps trouvé différents moyens de contrôler la position des congères autour des habitations et des voies de communications, réduisant ainsi les aléas et les inconvénients. À partir des années 1990, des travaux de simulation ont été réalisés permettant de mieux adapter l'urbanisme et les systèmes de déflexion à ce phénomène. |
 Louis Pasteur, né à Dole (Jura) le et mort à Marnes-la-Coquette (Seine-et-Oise) le , est un scientifique français, chimiste et physicien de formation, pionnier de la microbiologie. Fin 1849, Pasteur est informé que l'alcool amylique produit lors de la fermentation de la fécule de pomme de terre dévie le plan de polarisation de la lumière et possède donc une propriété de dissymétrie moléculaire. Il conjecture que cette dissymétrie moléculaire est due à l'action du ferment. Dès sa nomination comme doyen de la faculté des sciences de Lille en 1854, Louis Pasteur recherche les causes de la fermentation et montre que c'est en tant qu'être vivant que la levure agit, et non en tant que matière organique en décomposition. C'est lors de la séance du 8 août 1857 de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille qu'il publie ses premières découvertes sur les fermentations lactiques. C'est l'acte de naissance de la bactériologie… Lire l’article | ||
|
Windows est une gamme de systèmes d'exploitation produite par Microsoft, principalement destinées aux machines compatibles PC. C'est le remplaçant de MS-DOS. La gamme Windows est composée de plusieurs branches. La première (de Windows 1 à 3.11) est née en 1985. La branche NT (Windows NT, puis 2000) est apparue en 1993. C'est une réécriture complète du système, destiné aux ordinateurs personnels comme aux serveurs. La troisième branche est apparue en 1995 avec Windows 95, puis Windows 98 et Windows ME. Cette version est plus orientée vers le grand public. Windows XP continue la branche NT en fusionnant avec la branche grand public: il couvre à la fois le grand public et les professionnels. Windows Vista, toujours sur la branche NT, a refait totalement son style graphique avec la mise en place d'Aero (Transparence, ombres...). Windows 7 est plus une mise à jour de Vista qui apporte plus de stabilité et de sécurité. Windows 8 est la nouvelle version de Windows aussi décliné en version RT avec Windows RT. Windows 8.1 La version est une mise à jour gratuite de Windows 8 qui est disponible depuis le 17 octobre 2013. Windows 11 est la dernière version de Windows. Sa sortie était le 28 juin 2021. |
 L'échelle de dureté de Mohs fut inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin de mesurer la dureté des minéraux. Elle est basée sur dix minéraux facilement disponibles. Comme c'est une échelle ordinale, on doit procéder par comparaison (capacité de l'un à rayer l'autre) avec deux autres minéraux dont on connaît déjà la dureté. Cette échelle n'est ni linéaire ni logarithmique. Les dix minéraux de l'échelle de Mohs sont 1 (talc), 2 (gypse), 3 (calcite), 4 (fluorine), 5 (apatite), 6 (orthose), 7 (quartz), 8 (topaze), 9 (corindon) et 10 (diamant). Il existe aussi une échelle comportant 15 classes, destinée à remédier au manque de régularité de l'échelle de Mohs. Il existe plusieurs échelles de dureté expérimentales dont les degrés sont déterminés expérimentalement par indentation (au moyen d'un poinçon de diamant de forme déterminée). On pourra citer par exemple l'échelle de Knoop, l'échelle de Brinell, l'échelle de Rockwell, etc. qui sont appliquées en fonction des matériaux étudiés. Il existe enfin des classifications absolues en fonction de paramètres physiques précis (module de compressibilité ou module de cisaillement). Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Minéraux et roches
| ||
 Philippes (en grec ancien : Φίλιπποι / Phílippoi) est une ville antique fondée par le roi de Macédoine Philippe II en 356 av. J.-C., abandonnée au XIVe siècle après la conquête ottomane, aujourd'hui un site archéologique faisant partie du nome de Kavala en Grèce. Modeste fondation macédonienne, Philippes occupe une place notable dans l'Histoire en raison de deux événements majeurs : la bataille de Philippes sous ses murs en octobre 42 av. J.-C., puis la prédication paulinienne en 49 ou 50. Les héritiers de Jules César la transforment en colonie romaine sur la via Egnatia, peuplée de vétérans italiens. Le passage de l'apôtre Paul — et son martyre à Philippes selon certains historiens grecs modernes — induisent durant l'Antiquité tardive l'édification de vastes basiliques, peut-être comme centre de pèlerinage. Durement touchée par un séisme au début du VIIe siècle, la cité se couvre de ruines et subit d'éphémères occupations bulgare, latine et serbe, alternant avec des retours de domination byzantine, jusqu'à la conquête ottomane au XIVe siècle et son abandon complet. Redécouverte par des érudits au XIXe siècle, Philippes est rattachée à la Grèce en 1913, et progressivement fouillée par les archéologues de l'École française d'Athènes, puis par leurs homologues grecs, qui mettent au jour le théâtre, le forum monumental du IIe siècle et une série d'églises paléobyzantines. L'Église de Grèce fait de Philippes un lieu de commémoration paulinienne, et le site archéologique devient en 2016 le 18e site grec inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autres articles sélectionnés au sein du portail Monde byzantin |
 Le New Forest est l'une des races reconnues de poneys dites mountains and moorlands, originaires des îles Britanniques. La race est indigène du sud-ouest du Hampshire, dans la région du New Forest dont elle tire son nom. Des chevaux y vivent depuis la dernière période glaciaire, des restes équins datés de 500 000 ans avant notre ère ayant été retrouvés à moins de 80 km du berceau originel des New Forest modernes. Les études ADN l'ont révélé très proche des poneys celtes du type Asturcón et Pottok. Signalé dès le XIe siècle, le New Forest fait l'objet de nombreux croisements au cours des siècles suivants, principalement avec des Welshs, des Highlands et des Pur-sangs. Désormais, seuls les poneys dont les deux parents sont enregistrés comme pure race peuvent faire partie de la race. Celle-ci est gérée par la New Forest Breeding and Cattle Society, qui tient le registre d'élevage (studbook) et cherche à en fixer les caractéristiques originelles. Tous les poneys qui vivent librement dans la région de la New Forest ont un propriétaire détenteur du droit de pâture sur ces terres forestières. Une cotisation annuelle est versée pour le marquage de chaque animal pâturant. La population de poneys fluctue en fonction des variations de la demande en jeunes chevaux. Leur nombre est tombé à moins de 600 en 1945 mais n'a depuis cessé d'augmenter, et des milliers de New Forest vivent désormais en liberté à l'état semi-sauvage. Les poneys sont recueillis chaque année durant un rassemblement de bêtes, afin de vérifier leur santé, de les vermifuger et de les marquer. Les étalons approuvés vivent dans la forêt avec les juments durant une courte période chaque année. Les poulains surnuméraires sont vendus plusieurs fois par an. Hors de ses terres originelles, le New Forest est désormais devenu un grand poney de sport solide et élégant. Très polyvalents et dotés d'un bon type pour la selle, tant chez les enfants que chez les adultes, ils sont réputés pour leur pied sûr et leur force. Ils s'illustrent dans des disciplines aussi variées que le saut d'obstacles, le dressage, le complet, l'attelage ou le polo. Autres articles sélectionnés au sein du portail Monde équestre
| ||
 Le Palais des papes, à Avignon, est la plus grande des constructions gothiques du Moyen Âge. À la fois forteresse et palais, la résidence pontificale fut pendant le XIVe siècle le siège de la chrétienté d'Occident. Six conclaves se sont tenus dans le palais d'Avignon qui aboutirent à l'élection de Benoît XII, en 1335 ; de Clément VI, en 1342 ; d'Innocent VI, en 1352 ; d'Urbain V, en 1362 ; de Grégoire XI, en 1370, et de Benoît XIII, en 1394. Le palais, qui est l'imbrication de deux bâtiments, le palais vieux de Benoît XII, véritable forteresse assise sur l'inexpugnable rocher des Doms, et le palais neuf de Clément VI, le plus fastueux des pontifes avignonnais, est non seulement le plus grand édifice gothique mais aussi celui où s'est exprimé dans toute sa plénitude le style du gothique international. Il est le fruit, pour sa construction et son ornementation, du travail conjoint des meilleurs architectes français, Pierre Peysson et Jean du Louvres, dit de Loubières, et des plus grands fresquistes de l'École de Sienne, Simone Martini et Matteo Giovanetti. De plus la bibliothèque pontificale d'Avignon, la plus grande d'Europe à l'époque avec 2 000 volumes, cristallisa autour d'elle un groupe de clercs passionnés de belles-lettres dont allait être issu Pétrarque, le fondateur de l'humanisme. Tandis que la chapelle clémentine, dite Grande Chapelle, attira à elle compositeurs, chantres et musiciens. Ce fut là que Clément VI apprécia la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machault, que Philippe de Vitry, à son invite, put donner la pleine mesure de son Ars Nova et que vint étudier Johannes Ciconia. Le palais fut aussi le lieu qui, par son ampleur, permit « une transformation générale du mode de vie et d'organisation de l'Église ». Il facilita la centralisation des services et l'adaptation de leur fonctionnement aux besoins pontificaux en permettant de créer une véritable administration. Les effectifs de la Curie, de 200, à la fin du XIIIe siècle, étaient passés à 300 au début du XIVe siècle, pour atteindre 500 personnes en 1316. À cela s'ajoutèrent plus d'un millier de fonctionnaires laïcs qui purent œuvrer à l'intérieur du palais... |
 Strawberry Fields Forever est une chanson du groupe britannique The Beatles, parue en 1967. Écrite par John Lennon, elle est cependant créditée Lennon/McCartney, comme tous les morceaux des Beatles composés par l’un ou l’autre. Fin , Strawberry Fields Forever est la première chanson que les Beatles enregistrent pour leur prochain album, qui ne porte pas encore de nom mais qui deviendra Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Toutefois, elle n’y figurera pas, ayant été précédemment publiée en 45 tours « double face A » avec Penny Lane de Paul McCartney. Leur manager Brian Epstein voulait en effet maintenir la popularité du groupe après une inhabituelle période de six mois sans publication inédite. Le single sort ainsi le aux États-Unis et le 17 février au Royaume-Uni. Au mois de , Strawberry Fields Forever est à nouveau publiée sur la version américaine de l’album Magical Mystery Tour. John Lennon se trouve en Andalousie, sur le tournage du film How I Won the War, lorsqu’il compose la chanson. Parti du thème de la nostalgie et de l’enfance — Strawberry Field était un orphelinat aux environs duquel il jouait étant enfant —, il en fait une chanson introspective et abstraite sur sa vision personnelle du monde qui l’entoure. L’ambiance surréaliste et onirique qui en résulte, augmentée du thème musical rappelant les effets du LSD, fait de Strawberry Fields Forever un des morceaux fondateurs du rock psychédélique. L’enregistrement de la chanson a lieu aux studios EMI de Londres et s’étale sur un mois entier.
| ||
|

|
| Le Festspielhaus
|
|---|
Le Festival de Bayreuth (Bayreuther Festspiele) est un festival d'opéra fondé en 1876 par Richard Wagner et consacré à l'exécution de ses dix principaux opéras. Il se tient chaque été au Palais des festivals de Bayreuth, un théâtre conçu par Wagner pour pouvoir réaliser sa conception particulière de l'ouvrage lyrique comme « œuvre d'art totale » (« Gesamtkunstwerk »).
Wagner cherchait également à assurer son indépendance financière et artistique. Une brouille avec son protecteur et mécène, le roi Louis II de Bavière, provoqua sa disgrâce et son départ de Munich, où il avait d'abord songé à installer son festival. Il envisagea de le fixer à Nuremberg, ville qu'il avait honorée dans son opéra Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg. Cependant, sur le conseil du chef d'orchestre Hans Richter, il s'intéressa à la ville de Bayreuth, en Franconie, qui réunissait trois grands avantages :
- Un théâtre réputé, l'Opéra des Margraves (Markgräfliches Opernhaus), construit entre 1745 et 1748, dont la taille et la bonne acoustique étaient supposées pouvoir convenir à ses projets.
- Une localisation hors des régions dans lesquels il avait cédé ses droits sur les représentations de ses œuvres en 1864 en raison de difficultés financières.
- L'absence de réelle vie culturelle susceptible de faire concurrence à la maîtrise artistique qu'il recherchait, ce qui l'assurait que son festival serait le principal événement culturel de la ville.
Il s'agit de l'un des festivals de musique classique les plus prestigieux du monde. Il attire chaque année sur la « Colline sacrée » des mélomanes dont certains ont dû attendre des années pour obtenir une place, la demande étant plus de huit fois supérieure à l'offre malgré un répertoire ne comprenant qu'une dizaine d'opéras.
Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Musique classique
 Portail:Musique classique (compositeurs)
Portail:Musique classique (compositeurs)
Antonio Lucio Vivaldi est un violoniste et compositeur italien né le à Venise et mort le à Vienne.
Vivaldi a été l’un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps (« incomparable virtuose du violon » selon un témoignage contemporain) ; il est également reconnu comme l’un des plus importants compositeurs de la période baroque, en tant qu'initiateur principal du concerto de soliste, genre dérivé du concerto grosso. Son influence, en Italie comme dans toute l’Europe, a été considérable, et peut se mesurer au fait que Bach a adapté et transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que de n'importe quel autre musicien. Son activité s’est exercée dans les domaines de la musique instrumentale, particulièrement au violon, et de celui de la musique lyrique, et elle a donné lieu à la création d’un nombre considérable de concertos, sonates, opéras, pièces religieuses : il se targuait de pouvoir composer un concerto plus vite que le copiste ne pouvait le transcrire.
Prêtre catholique, sa chevelure rousse le fit surnommer « il Prete rosso » (« Le Prêtre roux »), sobriquet peut-être plus connu à Venise, que son véritable nom ainsi que le rapporte Goldoni dans ses Mémoires. Comme ce fut le cas pour de nombreux compositeurs du XVIIIe siècle, sa musique, de même que son nom, fut vite oubliée après sa mort. Elle ne devait retrouver un certain intérêt auprès des érudits qu’au XIXe siècle, à la faveur de la redécouverte de Jean-Sébastien Bach ; cependant sa véritable reconnaissance a eu lieu pendant la première moitié du XXe siècle, grâce aux travaux d'érudits ou musicologues tels Arnold Schering ou Alberto Gentili, à l'implication de musiciens tels Marc Pincherle, Olga Rudge, Angelo Ephrikian ou Alfredo Casella, à l'enthousiasme d'amateurs éclairés comme Ezra Pound.
Aujourd’hui, certaines de ses œuvres instrumentales, et notamment les quatre concertos connus sous le titre « Les Quatre Saisons » comptent parmi les plus populaires du répertoire classique.
La musique iranienne est celle pratiquée en Iran ou en Perse. Elle s'est en outre propagée au sein de la musique afghane, tadjike et turque.
Plusieurs fois millénaire, la musique iranienne remonte au Néolithique ainsi que l'attestent les sites archéologiques de Suse ou Élam, au sud-ouest de l’Iran : on y jouait du luth et de la flûte sans qu'on en sache beaucoup plus.
Dans l’Empire achéménide, Hérodote reconnaît une place importante de la musique, particulièrement à la cour royale ; il note également son rôle très important dans les cérémonies religieuses d'adoration de Mithra.
Une distinction s'impose entre la science de la musique (musicologie, Elm-e Musiqi) qui, en tant que branche des mathématiques a toujours été très bien considérée en Iran, et la performance musicale (Tarab, Navakhteh, Tasneef, Taraneh ou plus récemment Muzik) qui a souvent eu une relation conflictuelle avec les autorités religieuses.
Lire l’article
Achille (en grec ancien Ἀχιλλεύς / Akhilleús) est un héros légendaire de la guerre de Troie, fils de Pélée, roi de Phthie en Thessalie, et de Thétis, une Néréide (nymphe marine). Il est fréquemment appelé « Péléide » ou « Éacide », épithètes qui rappellent son ascendance.
Sa mère le plonge dans le Styx, l'un des fleuves des Enfers, pour que son corps devienne invulnérable ; son talon, par lequel le tient Thétis, n'y est pas trempé et reste celui d'un mortel, ce qui le mènera plus tard à sa perte. Il est éduqué par le centaure Chiron qui lui apprend les arts de la guerre, la musique et la médecine. Alors qu'il est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, plutôt qu'une existence longue mais sans éclat. Caché par sa mère, qui veut l'empêcher de participer à la guerre de Troie, à la cour du roi Lycomède, le jeune homme est découvert par Ulysse et rejoint, avec son ami intime Patrocle, l'expédition grecque. Lors de la dixième année du conflit, une querelle avec Agamemnon le pousse à quitter le combat : c'est la « colère d'Achille » chantée par l’Iliade. Eschyle, dans sa pièce Les Myrmidons, décrit Achille et Patrocle comme amants ; plus tard, Xénophon, dans son dialogue philosophe Le Banquet, donne une version contraire où ils ne sont pas amants. La mort de Patrocle le pousse à reprendre les armes pour affronter Hector, le meilleur des Troyens. Achille trouve la mort peu après l'avoir tué, atteint au talon par une flèche de Pâris guidée par le dieu Apollon.
Achille est honoré comme un héros, voire comme un dieu par le monde grec. Beau, valeureux, champion d'une morale orgueilleuse de l'honneur, il incarne « l'idéal moral du parfait chevalier homérique ».
Autres articles sélectionnés au sein du portail Mythologie grecque

La lagune Buada, Buada Lagoon en anglais, est le plus grand et le seul véritable lac de l'île de Nauru, une petite République indépendante d'Océanie constituée d'une île très plate de 21,3 km2. Le lac est situé dans le district de Buada d'où il tire son nom. Ce plan d'eau est appelé « lagune » non pas parce qu'il est en communication avec la mer mais en raison de ses eaux légèrement saumâtres.
Le lac a traditionnellement servi de bassin de pisciculture de poisson-laits pour la consommation humaine durant des siècles et malgré son abandon dans les années 1960 et en dépit de la pollution de ses eaux, cette activité bénéficie d'efforts récents pour la relancer.
Le Chrysler Building est l’un des gratte-ciels les plus célèbres de New York, aux États-Unis. Il est situé à l’intersection de la Lexington Avenue et de la 42e rue, dans le quartier de Midtown, à Manhattan. Le Chrysler Building, qui mesure 319 mètres, et compte 77 étages, est l’un des symboles de la ville de New York, et il est en outre le « gratte-ciel préféré des New-Yorkais », devant son célèbre rival, l’Empire State Building. Il fut le plus haut bâtiment du monde entre 1930 et 1931, jusqu'à la construction de ce dernier, qui est redevenu le plus haut gratte-ciel de la ville depuis les attentats du World Trade Center.
La construction du Chrysler Building, dirigée par l'architecte américain William Van Alen, s’est étalée entre 1928 et 1930, et le bâtiment a été ouvert au public après une cérémonie le 27 mai 1930. Le bâtiment a été déclaré National Historic Landmark le 8 décembre 1976. Le Chrysler Building a été rénové en 1978, avec la construction d'un hall, composé essentiellement de marbre, d'acier et de granite, semblable à celui de l’Empire State Building. En outre, la flèche a été rénovée en 1995, car l’acier inoxydable avait perdu de son éclat avec le temps. Le bâtiment appartient aujourd’hui à Abu Dhabi Investment Council (75 %) et à Tishman Speyer Properties (25 %).

L’attaque du camp de Looking Glass est une attaque militaire menée le dans le cadre de la guerre des Nez-Percés par le capitaine Stephen G. Whipple de la United States Army sur le village du chef amérindien Looking Glass installé à proximité de la Clearwater, près de la ville actuelle de Kooskia. Alors que ce dernier a refusé de se joindre aux autres factions de Nez-Percés hostiles aux Américains, le général Oliver Otis Howard, se fiant à des rapports indiquant qu'il constituerait une menace, donne l'ordre de l'arrêter ainsi que son groupe.
À l'arrivée des Américains, Looking Glass leur fait savoir qu'ils vivent en paix et leur demande de partir mais le tir d'un des civils volontaires accompagnant les soldats précipite l'affrontement. Surpris par l'attaque, les Amérindiens fuient leur village et se réfugient dans les collines avoisinantes. Les soldats mettent ensuite à sac le campement et capturent près de 700 chevaux qu'ils ramènent à Mount Idaho.
Bien que le campement de Looking Glass ait été détruit, la mission est un échec pour les Américains puisque Whipple n'est pas parvenu à capturer le groupe d'Amérindiens. En outre, Looking Glass, furieux de la façon dont il a été traité par les Américains, choisit de se joindre aux autres groupes de Nez-Percés hostiles, compliquant la tâche de l'armée américaine.

Éric Sikora, né le à Courrières, dans le département du Pas-de-Calais, est un footballeur professionnel français ayant évolué au poste de latéral droit au Racing Club de Lens et devenu ensuite membre de l'encadrement technique de ce club, y occupant différents postes. Il est à partir de 2021 entraîneur de l'équipe masculine des moins de 19 ans.
Natif de la région lensoise, Éric Sikora intègre en 1980 le Racing Club de Lens via ses équipes de jeunes. Il en rejoint l'équipe professionnelle en 1985 et découvre à cette occasion la première division française. Après plus de dix ans au club et ayant connu avec lui aussi bien la Coupe UEFA que la deuxième division, Sikora remporte son premier titre en professionnel en 1998, le Championnat de France. Finaliste de la Coupe de France la même année, il gagne également la Coupe de la Ligue en 1999 et est demi-finaliste de la Coupe UEFA en 2000. Vice-champion de France en 2002, il arrête sa carrière de joueur en 2004 et entame une reconversion au sein du club artésien. Membre de l'encadrement technique, il est entraîneur de l'équipe première du à la fin de la saison lensoise 2012-2013. Il dirige ensuite l'équipe réserve du RC Lens.
Sikora, qui fait partie des footballeurs ayant effectué l'ensemble de leur carrière dans un seul et même club, est le joueur ayant disputé le plus de rencontres de première division avec le RC Lens. Il est considéré comme un acteur majeur de l'histoire de cette équipe.

L'ancien tramway de Rouen fut construit après la guerre de 1870-1871 et mis en service en 1877. À cette époque de croissance industrielle et démographique, les anciens modes hippomobiles de transport, fiacres et omnibus, mis en place depuis la fin du XVIIIe siècle et progressivement renforcés, ne suffisaient plus à assurer les dessertes urbaines.
Les édiles locaux décidèrent donc d’adopter ce nouveau moyen de communication, inventé aux États-Unis en 1832. D’abord à traction animale et à vapeur, le tramway fut électrifié en 1896. Son réseau s’étendit bientôt sur les différents quartiers du centre de la ville sur la rive droite de la Seine, atteignit les municipalités du plateau nord, les hauteurs de Bonsecours à l’est, irrigua la vallée textile du Cailly à l’ouest, franchit le fleuve et desservit, au sud, les faubourgs et banlieues industrielles de la rive gauche. Le tramway de Rouen couvrit alors l’agglomération de 70 kilomètres de lignes, le plus long réseau électrique de France à la Belle Époque, contribuant aux succès des événements marquant l’histoire de la ville : exposition coloniale de 1896, fêtes du millénaire normand de 1911.
Même si les années 1920 virent encore une légère croissance du trafic, le développement du réseau était terminé, la concurrence des nouveaux modes routiers de déplacement urbain mettait un terme à son monopole. La montée en puissance des autobus et trolleybus, la crise des années 1930, et surtout la Seconde Guerre mondiale qui ravagea la cité normande, condamnèrent le tramway à la disparition. Les dernières motrices cessèrent de circuler en 1953, après 76 ans de service. Depuis 1994, un nouveau tramway a été remis en exploitation dans la capitale normande.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungah..., simplement appelée Taumata ou Taumata Hill dans le langage courant, est une colline de Nouvelle-Zélande située sur l'île du Nord et culminant à 305 mètres d'altitude. Elle est connue pour son nom qui est l'un des plus longs du monde avec 85 lettres pour le toponyme enregistré par le livre Guinness des records. Son étymologie repose sur une légende maori mettant en scène Tamatea, un ancêtre maori. Le lieu est signalé par un panneau dont la longueur est démesurée, ce qui en fait une destination touristique.

Grasse, « capitale mondiale des parfums », est une commune française du département des Alpes-Maritimes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nommée Grassa ou Grasso en provençal.
Les premières traces de présence humaine dans le pays de Grasse datent du Néolithique mettant en évidence une population plus importante qu’ailleurs. Ligures, Grecs puis Romains s'y installent, chassés successivement par les Burgondes, les Ostrogoths, les Francs et les Lombards. Lors du rattachement de la Provence au Royaume de France Grasse refuse de faire allégeance et rejoint le Royaume de Lombardie, celui de Bourgogne puis celui d’Arles qui la délivre des Arabes. Les Grassois rejètent le régime féodal et abolissent le servage. Une aristocratie de consuls se forme et prend le pouvoir. En 1171 et 1179, Grasse signe les premiers traités politiques et commerciaux avec Gênes et Pise pour l'exportation et l'importation de toiles, cuirs, blé, peaux brutes, peaux tannées, vin et bétail. Cette importance grandissante attire l’attention du Comte de Provence qui prend la ville en 1220 et la rattache au comté en lui octroyant cependant de nombreux privilèges. L’artisanat de la tannerie est la principale activité économique et commerciale. En 1482, Louis XI annexe la Provence et Grasse devient française. Pendant la Renaissance, Charles Quint pille et incendie la ville. Grasse prend position en faveur d’Henri IV et de l'édit de Nantes dans les guerres de religion. Durant le XVIIe siècle, c’est l’apogée de l’industrie de la tannerie, mais aussi le début de celle du parfum et des « gants parfumés ». Des hôtels particuliers sont construits pour la noblesse provençale. Lors de la division de la France en 83 départements par l'assemblée Constituante, en janvier 1790, Grasse fait partie du département du Var dont elle sera la préfecture de 1793 à 1795. Grasse est alors une ville de tradition opportuniste et commerçante. Une guillotine est installée où sont exécutés trente « ennemis du peuple » et de nombreux Grassois sont emprisonnés pour avoir montré leur hostilité à la Révolution. Le XIXe siècle est un siècle de prospérité. Le parfum se développe et Grasse devient « capitale mondiale des parfums ». De grandes usines apparaissent, signe d’adhésion à la Révolution industrielle. La Princesse Pauline y séjourne en 1811, de riches étrangers construisent de magnifiques villas et la ville s’enrichit. En 1860 l'arrondissement de Grasse est rattaché au département des Alpes-Maritimes. Au XXe siècle, Grasse garde sa réputation touristique et l’industrie des parfums se transforme et se modernise.

L’Opéra Garnier ou Palais Garnier (48° 52′ 19″ N, 2° 19′ 55″ E), est un des éléments structurants du IXe arrondissement de Paris et du paysage de la capitale française. Situé à l'extrémité de l'avenue de l'Opéra, l'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique de la seconde moitié du XIXe siècle, et s'inscrit dans la continuité des transformations de Paris instaurées par Napoléon III et menées par le baron Haussmann.
Inaugurée le 5 janvier 1875 par le président de la République Mac-Mahon et destinée à accueillir l'Académie royale de musique, dont la salle de la rue Le Peletier avait été détruite en 1873 par un incendie, le bâtiment a longtemps été désigné sous le terme « Opéra de Paris ». Depuis l'ouverture de l'Opéra Bastille en 1989, on la désigne par le seul nom de son auteur : Charles Garnier. Les deux sites sont aujourd'hui regroupés au sein de l'établissement public, industriel et commercial « Opéra national de Paris ».
L'architecture et les décorations intérieures et extérieures ont fait l'objet d'un classement de la Commission supérieure des monuments historiques le 19 octobre 1923. Parmi les réalisations remarquables, on compte le grand vestibule, le grand escalier de marbre blanc à double révolution, le grand foyer et ses salons de la Lune et du Soleil, le foyer de la Danse, les rotondes des Abonnés et du Glacier et bien entendu la salle « à l'italienne » de 2000 places.
Le nouveau plafond commandé par André Malraux au peintre Marc Chagall en 1964 et objet d'une forte controverse à son inauguration, évoque en quatre parties aux vives couleurs les grands jalons et ouvrages représentatifs de l'histoire des arts de l'opéra et de la danse ainsi que quelques des compositeurs particulièrement marquants des arts lyriques et chorégraphiques du répertoire.
Autres articles sélectionnés par le portail Opéra


Ce photo-guide taxinomique du monde végétal permet, pour l'ensemble des groupes végétaux ainsi que pour les champignons, d'accéder directement aux images Wikimedia Commons. L'accès peut se faire soit de manière simplifiée vers les principaux grands groupes, soit de façon plus ciblée via un arbre phylogénétique...

Le siège d’Orléans est l'un des épisodes majeurs de la guerre de Cent Ans. Les Anglais désireux de s'emparer de la ville qui constitue alors un verrou sur la Loire protégeant le sud de la France, s'opposent aux troupes menées par Jeanne d'Arc.
Cette bataille se déroulant sur les années 1428 et 1429 constitue l'une des étapes de la campagne de la Loire menée par celle que l'on surnomme la Pucelle d'Orléans.
L'issu du combat est sanctionnée par une victoire française qui marquera le début de la marche sur Reims et aboutira au couronnement de Charles VII.
Ci-contre, Jeanne est représentée en armure devant Orléans sur un tableau de Jules Eugène Lenepveu datant de 1886-1890 et exposé au Panthéon de Paris.

La guerre israélo-arabe de 1948-1949 commence le 15 mai 1948 et se termine avec les différents cessez-le-feu israélo-arabes, conclus entre février et juillet 1949.
Depuis le 30 novembre 1947 et le vote du Plan de partage de la Palestine, les forces paramilitaires juives affrontent les irréguliers arabes palestiniens et les volontaires de l'Armée de libération arabe tandis que les Britanniques qui sont responsables de l'administration du pays l'évacuent. Les forces palestiniennes ont été défaites, plusieurs villes mixtes, à l'exception notable de Jérusalem, sont sous le contrôle des forces juives et de 350 à 400 000 Palestiniens ont déjà pris les routes de l'exode.
Le à minuit, le mandat britannique sur la Palestine s'achève officiellement. L'État d'Israël a été proclamé dans la journée sur une partie du territoire. Au vu de la situation, les États arabes voisins, qui contestent la création d'Israël, décident d'intervenir, et plusieurs armées arabes entrent dans l'ancienne Palestine mandataire. Les forces arabes palestiniennes sont quant à elles dissoutes ou intégrées dans les armées arabes. La « Première Guerre israélo-arabe », appelée également « Guerre d'indépendance d'Israël », débute officiellement...
Autres articles sélectionnés au sein du portail Palestine

Pétra (de πέτρα petra, « rocher » en grec ancien ; البتراء Al-Butrāʾ en arabe), de son nom sémitique Reqem ou Raqmu (« la Bariolée »), est une ancienne cité troglodytique située dans l'actuelle Jordanie, au cœur d'un bassin bordé par les montagnes qui forment le flanc oriental de l'Arabah (Wadi Araba), grande vallée prolongeant le grand rift vers le nord et qui s'étend de la mer Morte au golfe d'Aqaba.
Créée dans l'Antiquité vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C. par les Édomites, elle est ensuite occupée vers le VIe siècle av. J.-C. par les Nabatéens qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes transportant l'encens, les épices et d'autres produits de luxe entre l'Égypte, la Syrie, l'Arabie du Sud et la Méditerranée. Vers le VIIIe siècle, la modification des routes commerciales et les séismes entraînent l'abandon progressif de la ville par ses habitants. Pétra a abrité à son apogée jusqu'à vingt-cinq mille habitants. Tombé dans l'oubli à l'époque moderne, le site est redécouvert par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean Louis Burckhardt en 1812.
Les nombreux bâtiments, dont les façades monumentales sont directement taillées dans la roche, en font un ensemble architectural unique qui, depuis le , est inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. La zone autour du site est également, depuis 1993, un parc national archéologique.

Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō (東海道五十三次之内, Tōkaidō Gojūsan-tsugi no uchi), dans l'édition Hōeidō (1833-1834) présentée ici, sont une série d'estampes japonaises (ukiyo-e) créées par Hiroshige après son premier voyage empruntant la route du Tōkaidō en 1832. Cette route, reliant la capitale du shogun, Edo, à la capitale impériale, Kyoto, est l'axe principal du Japon de l'époque. C'est également la plus importante des « Cinq Routes », les cinq artères majeures du Japon (Gokaidō), créées ou développées pendant l'ère Edo pour améliorer le contrôle du pouvoir central sur l'ensemble du pays.
Même si c'est de loin l'édition Hōeidō qui a acquis la plus grande notoriété, Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō étaient un sujet si populaire qu'elles ont inspiré à Hiroshige une trentaine de séries d'estampes, très différentes les unes des autres par leurs dimensions (format ōban ou chuban), leur traitement ou encore leur nombre (certaines séries ne comptent que quelques estampes).
Le Tōkaidō de l'édition Hōeidō est l'œuvre la plus connue de Hiroshige et aussi la plus vendue dans l'histoire de l'ukiyo-e. Venant juste après la série des Trente-six Vues du mont Fuji d'Hokusai, elle consacre ce nouveau thème majeur de l’ukiyo-e qu'est désormais l'estampe de paysage (fūkei-ga), avec en particulier la représentation de lieux célèbres (meisho). Celles-ci exploitent pleinement les possibilités ouvertes après l'assimilation de la perspective occidentale par les artistes japonais et les estampes de Hiroshige seront fort appréciées, non seulement au Japon, mais plus tard en Occident.

Les Maccabées (makabim en hébreu) ont fondé la dynastie des Hasmonéens. Ils sont connu pour être la famille juive qui mena la résistance contre la politique d'hellénisation forcée pratiquée par les Séleucides au IIe siècle av. J.-C..
Le royaume indépendant de la Judée était tombé entre les mains des Babyloniens en -586 ou -587. La Judée était ensuite devenue une province perse après la conquête de l'empire babylonien par Cyrus le Grand, vers -540. La province devint ensuite une partie de l'empire d'Alexandre le Grand, après que celui-ci eut conquis la région sur l'empire perse, vers -332. Après le partage de l'empire d'Alexandre, la Judée devint une province du royaume hellénistique de Syrie, un royaume qui, bien que peuplé majoritairement de non-grecs, se considérait comme le défenseur de la culture grecque.
La révolte des Maccabées fut provoquée par la politique d'Antiochos IV de Syrie, maître de la Syrie-Palestine à la suite de la victoire de son père sur les Egyptiens en -198. Persuadé de la supériorité absolue de la civilisation Hellénistique, Antiochos IV voulait se servir de celle-ci pour réaliser l'unité de ses États face à la menace romaine. Antiochos IV voulait en particulier étendre la Religion grecque antique. La religion juive devenait donc un adversaire.
Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail du peuple juif dans l'Antiquité

Les timbres postaux de la République d'Irlande sont publiés par l'autorité postale de la République indépendante d'Irlande.
Le tout premier modèle, un timbre vert foncé d'une valeur de 2d (ancien pence), figurait une carte de l'île incluant l'Irlande du Nord, restée intégrée au Royaume-Uni. Depuis lors, au gré des besoins du pays et des changements de monnaie, de nouvelles images et de nouvelles valeurs ont façonné un total de neuf séries courantes, la dernière datant de 2004. Les timbres commémoratifs, apparus en 1929, sont émis de nos jours à raison de plusieurs séries annuelles. Ils éclairent divers aspects de la vie irlandaise (événements importants, dates anniversaires, coutumes, personnages irlandais illustres).
En plus de la présentation traditionnelle en feuille prédécoupée, les timbres courants aussi bien que les timbres commémoratifs sont publiés sous forme de carnets, de rouleaux et de blocs-feuillets. Les timbres-taxe, les timbres de poste aérienne et les entiers postaux complètent la production de timbres en Irlande.

Martin Heidegger, né le à Messkirch et mort le à Fribourg-en-Brisgau, est un philosophe allemand important.
D'abord étudiant auprès d'Edmund Husserl et immergé dans le projet phénoménologique de son maître, son intérêt se porte rapidement sur la question du « sens de l'être ». Elle le guidera ensuite tout au long de son chemin de pensée, et c'est en tentant de répondre à celle-ci de manière révolutionnaire, à l'occasion de la publication de son ouvrage Être et Temps (Sein und Zeit) en 1927, qu'il rencontre une immense notoriété internationale, qui débordera largement le monde de la philosophie.
Après ce qu'il appelle le « tournant » de sa pensée dans les années 1930, il s'intéresse aux questions de langage et à l'exégèse des textes historiques, ce qui l'amène à étudier ses prédécesseurs Kant et Nietzsche, mais aussi les présocratiques, la poésie de Hölderlin, le règne de la technique et bien d'autres sujets. Il cherche alors, en remontant aux sources de la civilisation européenne, à préparer un nouveau commencement de pensée qui, en critiquant Socrate, Platon et Aristote, éviterait l'enfermement dans la métaphysique, à qui il attribue l'état délétère de notre situation présente, caractérisée par le déchaînement de la volonté de puissance et le nihilisme universel.
Il est l’auteur prolifique de nombreuses conférences, de livres et de cours, et notamment de deux œuvres majeures : Être et Temps, et les Apports à la philosophie : De l'avenance (1935). Heidegger est considéré comme l'un des philosophes les plus marquants du XXe siècle : sa démarche a influencé la phénoménologie ultérieure, la philosophie existentialiste, la philosophie postmoderne, l'herméneutique allemande, ainsi que d'autres disciplines comme la théologie et la psychanalyse. C'est particulièrement en France, selon Dominique Janicaud, que son influence a été considérable, notamment par l'intermédiaire de Jean-Paul Sartre, de Jean Beaufret et d'Emmanuel Levinas.
Il est également l'un des philosophes les plus controversés, notamment à cause de son attitude durant la période 1933-1934 où il fut recteur de l'université de Fribourg et adhérent au Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), dont il se serait éloigné par la suite.

Andrea Rita Dworkin (Camden, – Washington, ) est une essayiste américaine, théoricienne du féminisme radical. Elle est surtout connue pour sa critique de la pornographie, qu'elle rapprochait du viol et autres formes de violence contre les femmes.
Activiste anti-guerre et proche de certains milieux anarchistes à la fin des années 1960, Dworkin a écrit plus d'une dizaine de livres sur la théorie et la pratique du féminisme radical. Pendant la fin des années 1970 et les années 1980, elle a gagné une renommée nationale comme porte-parole du mouvement féministe anti-pornographie, et pour ses écrits sur la pornographie et la sexualité, particulièrement Pornography: Men Possessing Women (1979) et Intercourse (1987) qui restent ses deux ouvrages les plus connus.
Sa personnalité et ses positions très tranchées, principalement sur la sexualité et la pornographie, ont été la cible de critiques, notamment de la part de féministes opposées à ses idées. Elle est aussi admirée et célébrée par de nombreuses autres féministes qui reconnaissent ses réalisations et son engagement aux côtés des femmes.
Autres articles sélectionnés au sein du portail Pornographie

Le centre d'extermination de Chełmno (en allemand Kulmhoff) est le premier camp d'extermination nazi destiné à l'assassinat de Juifs au moyen de gaz asphyxiants.
Situé dans le village polonais de Chełmno nad Nerem à 60 kilomètres au nord-ouest de Łódź dans le Warthegau, partie de la Pologne annexée au Reich, il est utilisé de à , puis en et , faisant plus de 150 000 victimes, essentiellement des Juifs originaires du Warthegau. Caractérisée par l'emploi de camions à gaz, sa première phase d'activité est dans la continuité des meurtres commis dans le cadre du programme Aktion T4 ou par les Einsatzgruppen et constitue une étape vers la mise en place des grands centres d'extermination, comme Sobibor, Treblinka, Maidanek, Belzec et Auschwitz. « Plus qu'un « laboratoire », Chełmno fut une « école » formant le personnel des autres centres de mise à mort ».
Outre le caractère précoce du début de ses activités, Chełmno se distingue des autres camps d'extermination par l'absence de chambre à gaz et par son indépendance à l'égard de l'Office central SS pour l'économie et l'administration et de l’Aktion Reinhard.

Napoléon Bonaparte (15 août 1769 – 5 mai 1821), général de la Révolution, dirigea la France à partir de la fin 1799 et fut Empereur des Français de 1804 à 1815 sous le nom de Napoléon Ier. En tant que général en chef et chef d'état, Napoléon tente de briser les coalitions montées et financées par le Royaume de Grande-Bretagne et qui rassemblent depuis 1792 les monarchies européennes contre la France et son régime né de la Révolution. Il conduit pour cela les armées françaises d'Italie au Nil et d'Autriche à la Prusse et à la Pologne : ses nombreuses et brillantes victoires (Arcole, Rivoli, Pyramides, Marengo, Austerlitz, Iéna, Friedland), dans des campagnes militaires rapides, disloquent les quatre premières coalitions. Les paix successives, qui mettent un terme à chacune de ces coalitions, renforcent la France et donnent à son chef, Napoléon, un degré de puissance jusqu'alors rarement égalé en Europe lors de la paix de Tilsit (1807).
Il conquit et gouverna la plus grande partie de l'Europe continentale hors Scandinavie et plaça des membres de sa nombreuse famille sur les trônes de plusieurs royaumes.
Autres articles sélectionnés au sein du portail Premier Empire

Le secourisme désigne, en France, le secours à personne pratiqué par des personnes ayant des connaissances nécessaires, des secouristes bénévoles, des sapeurs-pompiers ou des ambulanciers ; il peut s'agir de secours à personne avec ou sans matériel, en équipe organisée ou seul.
Le prompt secours est défini en France par l'arrêté suivant :
« le prompt secours se caractérise par une action de secouristes agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales ou à pratiquer sans délai des gestes secourisme. Il est assuré par des personnels formés et équipés. Son intérêt réside dans son caractère réflexe, il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant de la compétence des smur, des médecins généralistes, et/ ou des ambulanciers privés voire du simple conseil. » (circulaire n°151 [1] du 29 mars 2004 relative au rôle des samu, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente, ministère de la Santé et ministère de l'Intérieur français).
Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Premiers secours et secourisme

« Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. »
C'est par ces mots que commence le Manifeste du Parti communiste, un essai de Karl Marx et Friedrich Engels, membres de la "Ligue des communistes". Publié à Londres en février 1848, le "Manifeste" présente une vision originale de l'Histoire, structurée par une lutte des classes entre bourgeois et prolétaires. Prenant le parti des seconds, qu'ils exhortent à s'unir, Marx et Engels prévoient une révolution générale. Celle-ci n'a que peu de rapports avec le Printemps des peuples, dont la plupart des meneurs exigent des réformes libérales ou démocratiques sans remettre fondamentalement en cause le régime capitaliste. De fait, le "Manifeste" est peu lu dans les années 1848-50 (il faut par exemple attendre les années 1880 pour qu'il soit connu en France) et l'extrême-gauche européenne reste partagée entré démocratie sociale et socialisme utopique.
Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail du Printemps des peuples
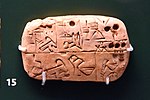
Les débuts de l'écriture en Mésopotamie se produisent entre et , et sont avant tout documentés par des tablettes d'argile provenant de sites du sud mésopotamien, en premier lieu Uruk, la principale agglomération de la période. Cette écriture archaïque, documentée par un corpus de plus de 5 000 textes, est couramment appelée « proto-cunéiforme », car elle est l'ancêtre de l'écriture cunéiforme qui se développe en Mésopotamie et dans le Proche-Orient ancien, mais s'en distingue par sa graphie plus linéaire et son absence ou quasi-absence de signes phonétiques. La connaissance de cette écriture archaïque a considérablement progressé à la fin du XXe siècle grâce aux travaux d'une équipe de l'université libre de Berlin en charge de l'édition des textes archaïques d'Uruk, même si ces avancées sont loin d'avoir dissipé toutes les zones d'ombre ou établi le sens de tous les signes archaïques.
Le proto-cunéiforme est un système d'écriture ou de proto-écriture reposant sur un ensemble de signes numériques, qui renvoient à des systèmes métrologiques divers, employés en fonction de ce qui était quantifié (objets discrets, surfaces, volumes, durée), et de signes logographiques (un signe = un mot) qui ont pour beaucoup une origine pictographique (des dessins de la chose qu'ils désignent). Les textes sont essentiellement de nature administrative ; ils enregistrent des mouvements de biens entrant ou sortant des magasins des institutions de l'époque, les quantifiant et indiquant les personnes et bureaux impliqués dans ces opérations. D'autres tablettes sont des inventaires de signes organisés de façon thématique, ancêtres des listes lexicales caractéristiques de la tradition littéraire mésopotamienne.
Il est généralement admis que l'écriture a une origine comptable. Elle serait créée en premier lieu pour les besoins de l'administration qui se développe considérablement dans les derniers siècles du IVe millénaire av. J.-C., durant la période d'Uruk récent, considérée comme le moment d'apparition de l’État et des villes (la « révolution urbaine »), et donc des institutions administratives et des instruments de gestion et de comptabilité. Sont identifiés plusieurs instruments de comptabilité et d'enregistrement de l'information qui semblent avoir servi de précurseurs à l'écriture : des jetons de comptabilité (ou calculi), des bulles-enveloppes d'argile les contenant, et des tablettes numériques sans pictogramme qui semblent être une évolution des précédentes. L'invention de l'écriture est généralement mise au crédit des Sumériens qui vivent dans les cités du Sud de la Mésopotamie dans les phases les plus antiques de l'histoire, mais il n'y a aucune certitude à ce sujet, étant donné que les plus anciens textes écrits n'ont pas pour vocation de transcrire une langue et ne contiennent quasiment pas d'indices sur la langue parlée par ceux qui les ont écrits.
L'apparition de l'écriture est un événement qui a eu un impact considérable sur les sociétés humaines, même si elle n'a pas forcément été perçue comme révolutionnaire au moment de son invention. Elle sert traditionnellement à marquer le basculement de la Préhistoire à l'Histoire, même s'il faut plutôt caractériser le changement qui se produit à cette période par l'ensemble des évolutions politiques, sociales et culturelles qui sont liées à la « révolution urbaine ». L'écriture s'étoffe progressivement au cours du IIIe millénaire av. J.-C., qui voit le développement de l'écriture cunéiforme à proprement parler, caractérisée par ses signes en forme de « coins » ou de « clous », et son association de signes logographiques et phonétiques, rapprochant l'écriture de la langue parlée, ce qui permet notamment son adaptation à différentes langues (sumérien, akkadien, élamite, éblaïte, etc.).
Autres articles sélectionnés au sein du portail Proche-Orient ancien

L'Olympique de Marseille, couramment abrégé en OM, est un club de football français fondé en 1899 par René Dufaure de Montmirail. Neuf titres de champion de France, dix Coupes de France, trois Coupes de la Ligue, deux Trophées des champions et une Ligue des champions de l'UEFA composent le palmarès du club provençal.
Le club joue au Stade de l'Huveaune de 1904 à 1937, date à laquelle est inauguré le Stade Vélodrome. Auparavant, le club marseillais remporte sa première Coupe de France en 1924 et devient le tout premier club provincial à s'adjuger ce titre. L'OM rremporte son premier championnat professionnel en 1937, avant de descendre pour la première fois en seconde division en 1959. Une série de montées et descentes s'effectue dans les années 1960 et la décennie suivante est marquée par le premier doublé Coupe-Championnat de l'histoire du club en 1972.

Le Royal 22e Régiment ou R22eR est l'un des trois grands régiments d'infanterie des Forces canadiennes. Les militaires du régiment sont surnommés les Vandoos à cause de la prononciation de « vingt-deux » avec un accent anglais et par extension le régiment est surnommé The Vandoos surtout par les anglophones. Chez les francophones, le régiment est souvent appelé tout simplement 22 ou 22e. C'est le seul régiment d'infanterie régulier entièrement francophone au Canada. Le régiment comprend cinq bataillons, dont deux de réserve. Dans la Force régulière, le R22eR a deux bataillons d'infanterie mécanisée et un bataillon d'infanterie légère comprenant une compagnie de parachutistes. Son quartier général se situe à la Citadelle de Québec, mais le gros de son effectif régulier est cantonné sur la base des Forces canadiennes (BFC) Valcartier près de la ville de Québec. Les bataillons de réserve sont situés à Laval et à Saint-Hyacinthe, respectivement le 4e et le 6e Bataillon. L'effectif du régiment comprend plus de 2 000 réguliers et 200 réservistes. Il s'agit de la plus importante unité militaire au Québec et de la plus grande unité francophone en Amérique...

La Scuderia Lancia était l'atelier de course de l’entreprise automobile Lancia e Cia, créé en 1952 par Gianni Lancia, fils du fondateur de la marque. La Scuderia Lancia débute officiellement en compétition en Sport où elle s'illustre notamment à la Carrera Panamericana, à la Targa Florio ou aux Mille Miglia. L'écurie est aussi engagée en Formule 1 en 1954-1955 mais ne brille que par l’entremise de Ferrari qui utilise ses monoplaces. Après la faillite de Lancia et son rachat par Fiat, Lancia abandonne la compétition en 1955.
À partir de 1966, l'atelier de course est rebaptisé Squadra Corse HF Lancia et Lancia fait son retour en compétition en rallye avec la Fulvia puis avec les Beta, Stratos, 037 et Delta. Lancia conquiert onze titres de champion du monde des constructeurs et quatre titres de champion du monde des pilotes entre 1974 et 1992 en rallyes. L'écurie a également pris part à plusieurs championnats du monde d'Endurance avec ses Beta Montecarlo, LC1 et LC2 et remporté les titres mondiaux en 1979, 1980 et 1981.
Le rapport de Lancia à la compétition a toujours été ambigu : si Vincenzo Lancia était pilote de course, il s'est toujours opposé à l'engagement officiel de ses voitures en compétition ; lorsque son fils a engagé officiellement la marque en course, il l'a conduite à la faillite ; quand Lancia a commencé à gagner officiellement, elle était déjà sous le contrôle de la Fiat… Depuis fin 1991, Lancia a cessé tout engagement officiel en compétition automobile.

Éric Rohmer, de son nom d'état-civil Maurice Henri Joseph Schérer, est un réalisateur français, né à Tulle en Corrèze le et mort le à Paris. Il a réalisé au total vingt-trois longs métrages qui constituent une œuvre atypique et personnelle organisée autour de trois cycles : les Contes moraux, les Comédies et proverbes et les Contes des quatre saisons. Considéré avec Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol et Jacques Rivette comme l'une des figures majeures de la Nouvelle Vague, il a obtenu en 2001 à la Mostra de Venise un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière.
Comme ses camarades de la Nouvelle Vague, Éric Rohmer a commencé sa carrière dans le cinéma comme critique. Après avoir rédigé ses premiers articles à la fin des années 1940, il rejoint les Cahiers du cinéma peu après leur création au début des années 1950. Il est rédacteur en chef de la revue de 1957 à 1963. Parallèlement à sa carrière de critique, il réalise tout au long des années 1950 des courts métrages et peut même réaliser en 1959, son premier long métrage (Le Signe du lion). À la différence de Claude Chabrol, François Truffaut et Jean-Luc Godard, ses premiers films ne rencontrent aucun succès.
Évincé des Cahiers du cinéma par Jacques Rivette en 1963, il travaille alors pour la télévision scolaire pour laquelle il réalise des films pédagogiques. En même temps, il entame la réalisation de ses Six contes moraux et s'assure une indépendance économique en créant avec Barbet Schroeder sa propre société de production Les Films du losange. Il rencontre un premier succès d'estime en 1967 avec La Collectionneuse puis accède à une notoriété internationale avec les trois films suivants Ma nuit chez Maud (1969), Le Genou de Claire (1970) et L'Amour l'après-midi (1972).
Après deux films d'époque adaptés d'œuvres littéraires (La Marquise d'O… et Perceval le Gallois), il réalise au cours des années 1980 les six films du cycle Comédies et proverbes puis au cours des années 1990 le cycle des Contes des quatre saisons. Dans les années 2000, il revient à la réalisation de films d'époque avec un film sur la Révolution française (L'Anglaise et le Duc, 2001), un film sur une histoire d'espionnage dans les années 1930 (Triple agent) et une adaptation de l'Astrée (Les Amours d'Astrée et de Céladon).
Son cinéma se caractérise à la fois par l'importance du thème des rencontres amoureuses et de la séduction, par l'écriture et l'importance de ses dialogues et par une grande économie de moyens. Malgré sa notoriété, Rohmer a en effet souvent tourné dans des conditions proches de l'amateurisme avec une équipe technique légère et une caméra 16 mm.

Le match de tennis Isner – Mahut, qui s'est joué dans le cadre du premier tour du simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2010, est devenu le plus long match de tennis professionnel, que ce soit en durée de jeu, en nombre de jeux (183) ou en nombre de points (980). Cette rencontre a battu de nombreux autres records, dont le plus grand nombre d'aces réalisés dans une partie (216).
Opposant le Français Nicolas Mahut à l'Américain John Isner sur le court no 18 du All-England Club, ce match a vu ce dernier s'imposer 6-4, 3-6, 67-7, 7-63, 70-68, au terme d'un match qui s'est déroulé sur trois jours, entre le 22 et le 24 juin, et qui a duré 11 h 5, dont 8 h 11 en deux jours pour le seul cinquième et ultime set.
Le Livre Guinness des records a homologué douze records pour ce match, au cours duquel seulement trois balles de break ont été converties malgré sa durée. La rencontre a suscité de nombreuses réactions et hommages à travers le monde et a connu une médiatisation inhabituelle pour un match de premier tour. Les joueurs, mais aussi l'arbitre de chaise, Mohamed Lahyani, ont notamment reçu des récompenses exceptionnelles de la part des organisateurs du tournoi, afin de marquer l'événement.
Autres articles sélectionnés au sein du portail NOM DU PORTAIL

Le Roazhon Park, anciennement stade de la route de Lorient, est un stade de football situé à Rennes, en France. Inauguré le , il est depuis cette date le terrain de jeu du Stade rennais football club. Propriété de la ville de Rennes, il est rénové à plusieurs reprises avant-guerre, dans les années 1950 et à la fin des années 1980. Entre 1999 et 2004, l'ensemble des tribunes du stade sont rénovées ou entièrement reconstruites, ce qui lui permet d'accroître sensiblement sa capacité d'accueil pour atteindre un peu moins de 30 000 places assises.
Quinzième stade français au nombre de places proposées, il accueille également ponctuellement quelques autres événements sportifs et culturels. Situé dans le quartier Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte, il est bordé par le paisible cours de la Vilaine, et se trouve au centre des installations du Stade rennais FC. À sa proximité immédiate se trouvent le centre de formation et le centre d'entraînement Henri-Guérin, alors que le stade abrite en son sein la boutique et le restaurant du club.

Ulrich Zwingli — on trouve aussi Huldreich Zwingli et Huldrych Zwingli, et même Zwingle ou Zvingle ou encore Zuingle Haudry, en francisant — (1484-1531) est un réformateur religieux suisse. En étudiant la Bible, indépendamment de Martin Luther, il arrive à des conclusions analogues.
Très présent dans la société, il est un des principaux artisans des différentes tentatives de convertir, y compris militairement, la Suisse à la Réforme. En 1523, il parvient à faire adopter la réforme au canton de Zürich, premier canton à le faire. Il est, depuis Zurich, à l'origine des Églises réformées de Suisse alémanique, tandis que Guillaume Farel et Jean Calvin sont les principaux réformateurs en Suisse romande. Il est aujourd'hui encore l'une des principales sources d'inspiration des Églises réformées, et notamment du protestantisme libéral.
Autres articles sélectionnés au sein du portail Religions et croyances

Armand-Charles Tuffin, marquis de La Rouërie, gentilhomme breton, né le à Fougères, mort le au château de la Guyomarais à Saint-Denoual, est un héros de la guerre d’indépendance américaine et l’organisateur de l'Association bretonne.
Parti en Amérique après une jeunesse orageuse, La Rouërie participa à la guerre d’indépendance américaine au sein de l'armée continentale. Connu sous le nom de Colonel Armand, il se distingua à la tête de la 1re légion de dragons et participa activement à la bataille de Yorktown. Admirateur de la Révolution américaine, ami de George Washington, La Rouërie revint en France avec le grade de brigadier-général, la croix de Saint-Louis et l'ordre de Cincinnatus.
De retour en Bretagne, La Rouërie défendit le parlement de Bretagne contre les édits de Versailles, ce qui lui valut d'être enfermé à la Bastille le .
Opposé à l'absolutisme, il vit d'abord avec joie les signes de la Révolution française mais le refus de la noblesse bretonne de députer à Versailles l'empêcha de jouer un rôle aux États généraux. Royaliste, libéral et franc-maçon, La Rouërie devint contre-révolutionnaire suite à la suppression des lois et coutumes particulières de la Bretagne. Il créa l'Association bretonne afin de lever une armée contre les révolutionnaires. Trahi, La Rouërie mourut avant de pouvoir terminer son entreprise mais le mouvement organisé par le marquis devait par la suite être précurseur de la Chouannerie.
Autres articles sélectionnés au sein du portail révolution américaine

Henri Grégoire, également appelé l’abbé Grégoire, né le 4 décembre 1750 et décédé le 20 mai 1831, est un prêtre français, l'un des chefs de la Révolution française, le premier à avoir aboli l'esclavage en France, et le fondateur du Conservatoire national des arts et métiers et du bureau des longitudes.
Fils d'artisan (son père est un modeste tailleur d'habits), il est né à Vého, près de Lunéville en 1750. Il étudie dans un collège jésuite à Nancy puis devient le curé d' Emberménil. Dans sa cure d'Emberménil, il s'attache à l'instruction de ses paroissiens, crée une bibliothèque accessible à tous et renfermant de nombreux ouvrages d'agronomie. Il aide les agriculteurs à rationaliser leur production et à l'augmenter. Il voyage également beaucoup et rencontre les membres d'autres religions. Il a, notamment, des contacts avec un pasteur protestant et, en 1787, prononce un discours de bienvenue lors de l'inauguration de la synagogue de Lunéville. Il participe à la vie intellectuelle de sa province et devient correspondant de plusieurs académies. En 1783, il est couronné par l'académie de Nancy pour son Éloge de la poésie, et en 1788, par celle de Metz pour son Essai sur la régénération physique et morale des Juifs, qui sera traduit en Angleterre dès l'année suivante. Dans cet ouvrage remarquable il défendait avec chaleur la cause de cette population si longtemps mise à l'écart et réclamait pour elle l'égalité civile.
Élu député en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux, Henri Grégoire se fit rapidement connaître en s'efforçant, dès les premières sessions de l’Assemblée, d’entraîner dans le camp des réformistes ses collègues ecclésiastiques et de les amener à s'unir avec le Tiers état.
Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail de la Révolution française

Scorpions est un groupe de hard rock, originaire de Hanovre (Allemagne). Leur premier album a vu le jour en 1972. Le groupe a connu un prestige planétaire — surtout à partir des années 1980 — en raison de titres hard rock tels que No One Like You en 1982 ou Rock You Like a Hurricane en 1984 et de ballades à l'instar de Still Loving You la même année ou Wind of Change et Send Me an Angel en 1990, toutes chansons au succès commercial presque systématique. Le déclin médiatique venu à partir des années 1990, les protagonistes se sont tournés vers de nouvelles expériences, avec notamment Moment of Glory (avec l'Orchestre philharmonique de Berlin) et Acoustica (album live acoustique) mais reviennent à leurs recettes traditionnelles en 2004 avec un Unbreakable salué par de nombreux fans et suivi en 2007 de l'album Humanity - Hour 1. À ce jour ils ont vendu plus de 75 millions d'albums à travers le monde.

L'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV en tournée en 1905-1906 – également connue sous le nom de The Originals – représentant la Nouvelle-Zélande, est la première équipe des All Blacks à se déplacer hors d'Australasie. Elle effectue une tournée en Grande-Bretagne en 1905, puis en France et enfin en Amérique du Nord en 1906.
La tournée est un succès pour les Originals. L'équipe de Dave Gallaher innove et impressionne les îles qui ont inventé ce jeu. Les visiteurs y gagnent un nom, les All Blacks et ils marquent l'histoire sportive de leur nation. Ils perdent contre le pays de Galles 3–0 après l'avoir emporté contre l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Le match disputé le contre l'équipe de France a une importance particulière car il s'agit du tout premier match officiel du XV de France. Au cours de cette tournée, les All Blacks remportent 34 des 35 matchs disputés avec une statistique très favorable au niveau des points, 976 inscrits pour 59 concédés. La réussite de cette tournée fait naître le ciment de l'identité nationale néo-zélandaise.
 Portail:Science-fiction (articles)
Portail:Science-fiction (articles)

Pierre Bordage, né le à La Réorthe, en Vendée, est un auteur de science-fiction français. C'est avec sa trilogie Les Guerriers du silence, publiée aux éditions de l'Atalante et vendue à 50 000 exemplaires, qu'il rencontre le succès. Ce space opera ainsi que le cycle de Wang sont salués par la critique littéraire comme des œuvres majeures du renouveau de la science-fiction française des années 1990, genre qui était alors dominé par les auteurs anglo-saxons.
Au fil de ses publications, Pierre Bordage acquiert la notoriété et une reconnaissance parmi les meilleurs romanciers populaires français. Auteur d'une quarantaine d'ouvrages ainsi que de nouvelles, publiés chez différents éditeurs (notamment Au Diable Vauvert) et de différents genres (fantasy historique avec L'Enjomineur, science fantasy avec Les Fables de l'Humpur, polar, etc.), il a aussi conçu des novélisations et a même réalisé quelques scénarios pour le cinéma, pour ensuite s'essayer à l'adaptation théatrale ainsi qu'à celle de sa propre œuvre en bande dessinée...
 Portail:Sciences (articles)
Portail:Sciences (articles)

L'équation de Schrödinger conçue par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1925, est une équation fondamentale en physique quantique. Elle décrit l'évolution dans le temps d'un système et remplit ainsi le même rôle que la relation fondamentale de la dynamique en mécanique classique. Cette équation est une généralisation des travaux de Louis de Broglie sur la dualité onde-corpuscule de la lumière, c'est-à-dire qu'elle peut se manifester, selon les circonstances, soit comme une particule, le photon, soit comme une onde électromagnétique.
Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Sciences
 Portail:Sciences (biographies)
Portail:Sciences (biographies)

|
Anna Maria Sibylla Merian (née le 2 avril 1647 à Francfort-sur-le-Main, décédée le 13 janvier 1717 à Amsterdam) était naturaliste et artiste. En raison de ses observations très détaillées sur la métamorphose des papillons et de sa documentation sur le sujet, elle est considérée comme une importante initiatrice de l’entomologie moderne bien que longtemps fort peu connue.
Lire l'articleAutres biographies sélectionnées au sein du portail Sciences
 Portail:Sciences (vulgarisation)
Portail:Sciences (vulgarisation)

Créé par Jean Perrin en 1937, le Palais de la découverte est un musée et centre culturel scientifique parisien. Il est situé dans le VIIIe arrondissement, avenue Franklin Delano Roosevelt.
En savoir plus ...Autres articles de vulgarisation scientifique sélectionnés au sein du portail Sciences

Sir Antonio Genesio Maria Panizzi, plus connu dans les pays anglo-saxons sous le nom d’Anthony Panizzi, est un bibliothécaire britannique d’origine italienne, né le et mort le .
Sa carrière de bibliothécaire, commencée en 1831, se déroule à la British Library, qu’il dirige de 1856 à 1866.
Il dirige la constitution du catalogue général en se fondant sur les Quatre-vingt-onze règles de catalogage (Ninety-One Cataloguing Rules) qu’il invente alors avec ses assistants.
Ces règles servent de base à toutes les normes de catalogage des XIXe et XXe siècles ; les idées émises sont encore prises en compte lors de la définition des normes actuelles telles que l’ISBD ou le schéma de métadonnées Dublin Core.
Lire l’article…Autres articles sélectionnés au sein du portail Sciences de l'information et des bibliothèques

La statue de la Liberté (Statue of Liberty) est l'un des monuments les plus célèbres de la ville de New York. Officiellement La Liberté éclairant le monde, elle est située sur Liberty Island au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis Island. Elle est offerte par les Français en 1886, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations. L'inauguration de la statue est célébrée le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland. L'idée vient d'Édouard Laboulaye, juriste et professeur au Collège de France, en 1865. Le projet est confié en 1871 au sculpteur français Auguste Bartholdi. Le choix des cuivres devant être employés à la construction est confié à l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui a l'idée d'employer la technique du repoussé. En 1879, à la mort d'Eugène Viollet-le-Duc, Bartholdi fait appel à l'ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la structure interne de la statue. Ce dernier imagine un pylône métallique qui supporte les plaques de cuivre martelées et fixées. La statue fait en outre partie des National Historic Landmarks depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du patrimoine mondial établie par l'UNESCO depuis 1984.
La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très important de la ville de New York, est devenue l'un des symboles des États-Unis, représentant de manière plus générale la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression. Au plan architectural, la statue rappelle le Colosse de Rhodes, l'une des Sept Merveilles du monde antique. Elle constitue enfin l'élément principal du monument national de la statue de la Liberté, géré par le National Park Service (NPS).
Une information classifiée est une information sensible dont l'accès est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes.
Une habilitation est requise pour posséder des documents classifiés ou accéder à des données classifiées. Il y a généralement plusieurs niveaux de sensibilité, classés par un système hiérarchique du secret utilisé potentiellement par l'ensemble des gouvernements. L'action d'assigner un niveau de sensibilité à une donnée est appelée classification des données.
Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail sur la sécurité de l'information

Un Captcha est une forme de test de Turing permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur. Parce que le test est réalisé par un ordinateur, en opposition avec les tests de Turing standard réalisés par des humains, un Captcha est souvent décrit comme un test de Turing inversé. Ce terme est néanmoins ambigu parce qu’il pourrait aussi signifier que les participants essayent aussi de prouver qu'ils sont des ordinateurs.
Ce test est utilisé sur Internet dans les formulaires pour se prémunir contre les soumissions automatisées et intensives réalisées par des robots malveillants (par exemple, pour spammer grâce à l'inscription à des webmails gratuits ou lors de la soumission de messages dans des forums de discussion et des blogs, ou encore pour participer à des sondages).
Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail sur la sécurité informatique

Le parc national du Triglav est le seul parc national de Slovénie. Il tire son nom de la plus haute montagne du pays. Le Triglav, situé au centre du parc, culmine à une altitude de 2 864 mètres. Le parc est localisé au nord-ouest du pays non loin des frontières autrichienne et italienne. Il couvre la partie orientale des Alpes juliennes. Le parc couvre 3 % du territoire de la Slovénie avec environ 840 km2. La création de la première zone protégée du parc remonte à 1924. Il permet non seulement de protéger la zone mais favorise la réalisation de nombreuses recherches scientifiques.

Bernd Rosemeyer, né le 14 octobre à Lingen (Empire allemand) et mort le sur l'autoroute Francfort-Darmstadt (Allemagne nazie), est un pilote automobile allemand. Il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de course d'avant-guerre. Pendant sa courte carrière, interrompue par un accident, il marqua le sport automobile et s'imposa comme un ténor de la discipline.
Bernd Rosemeyer remporte le championnat d'Europe des pilotes d'avant-guerre (l'équivalent du championnat du monde de Formule 1 créé en 1950) en 1936, à l'époque des Flèches d'Argent, et réalise plusieurs records de vitesse pour l'écurie Auto Union. Il est surnommé Nebelmeister en français : « maître du brouillard » après sa victoire à l'Eifelrennen 1936 par un fort brouillard.
Pilote motocycliste, Rosemeyer participe à une séance d'essais pour Auto Union grâce à son statut de pilote titulaire chez DKW. Réserviste, il fait ses débuts à l'Avusrennen 1935 mais son talent éclate lors de son deuxième Grand Prix et il devient, dès lors, pilote-titulaire pour la saison 1935. En fin d'année, il remporte sa première victoire en Tchécoslovaquie où il rencontre Elly Beinhorn. Il l'épouse l'année suivante, remporte sept victoires et devient champion d'Europe des pilotes. En 1937, il remporte quatre courses et, en fin d'année, réalise plusieurs records de vitesse. Le , il meurt à plus de 400 km/h en tentant de battre un nouveau record de vitesse.
Comme beaucoup de pilotes allemands en activité dans les années 1930, et s'il n'a jamais été membre du parti nazi, Bernd Rosemeyer est intégré au groupe paramilitaire nazi Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK). Bien qu'indépendant d'esprit vis-à-vis du régime, il fut l'objet de campagnes de propagande nazie.

Stefan Everts, né à Neeroeteren dans la province de Limbourg en Belgique le 25 novembre 1972, est un pilote belge de motocross.
Fils d'un ex-champion du monde de motocross, Harry Everts, quatre fois titré, il découvre très tôt le monde de la moto, enfourchant sa première moto a à peine 4 ans. Il fait ses débuts sur le monde des Grand Prix motos à 17 ans, concourant dans la catégorie 125 cm³. Deux ans plus tard, il remporte son premier titre. À l'époque, il devient le plus jeune pilote à obtenir un titre mondial.
Passé à la catégorie 250 cm³, il remporte trois titres consécutifs entre 1995 et 1997. Après un nouveau changement de catégorie, il obtient le titre en 500 cm³ devenant le deuxième pilote, après Eric Geboers, à remporter les titres dans les trois catégorie 125, 250 et 500. Avec ce titre 2001, il devient également le premier pilote à être titré avec les quatre constructeurs japonais, Suzuki, Kawasaki, Honda et enfin Yamaha.
Lire la suite
Le parc national de Stenshuvud (en suédois : Stenshuvuds nationalpark) est un parc national situé en Scanie, au sud de la Suède.
Le parc couvre 390 ha, situés autour de la colline éponyme, constituant l'extrémité est du horst de Linderödsåsen. Cette colline domine la mer Baltique d'une hauteur de 97 m, et a longtemps constitué un important point de repère pour les marins. Elle offre aussi un excellent point de vue, pouvant aller par temps clair jusqu'à l'île de Bornholm.
L'homme est présent dans la région depuis la préhistoire, mais c'est surtout au XIXe siècle que l'influence humaine fut la plus marquante, la quasi-totalité de la superficie du parc étant alors déboisée. Mais, depuis le début du XXe siècle, la protection de la zone a permis à la forêt de regagner du terrain, même si certaines prairies sont encore présentes et entretenues, même après la fondation du parc national, en 1986.
Le parc présente une importante diversité animale et végétale pour le pays et, en particulier, de nombreuses espèces considérées comme menacées en Suède y sont présentes. Le parc est aussi un site touristique important, avec 400 000 visiteurs par an.

L'alphabet morse, ou code morse, est un code permettant de transmettre un texte à l'aide de séries d'impulsions courtes et longues.
Inventé en 1835 pour la télégraphie, ce codage des caractères assigne à chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une combinaison unique de signaux intermittents. Considéré comme le précurseur des communications numériques, le code morse a depuis le été délaissé au profit d'un système satellitaire pour les communications maritimes.
Il est cependant encore utilisé à l'heure actuelle par les militaires comme moyen de secours pour la transmission, en aviation par des systèmes de balises, pour la signalisation maritime par certains transpondeurs radar et feux, dits «à lettre morse». Le morse est également pratiqué par des amateurs comme de nombreux scouts et radioamateurs.
Lire l’article
The Plays of William Shakespeare (Les Pièces de William Shakespeare), révisés et corrigés par Samuel Johnson et George Steevens, est une édition des tragédies de William Shakespeare parue au XVIIIe siècle. Johnson avait annoncé son intention de publier ces pièces de théâtre dans son Miscellaneous Observations on Macbeth (1745), et son Proposal final fut publié en 1756. La première version de l'ouvrage sortit finalement en 1765.
Dans sa Preface de cette édition, Johnson justifia son choix de rechercher le texte original des pièces de théâtre et ajouta plusieurs notes explicatives pour le bénéfice du lecteur. Des éditeurs ultérieurs ont suivi les traces de Johnson et ont tenté de retrouver les textes émanant de la main de Shakespeare.
Autres articles sélectionnés au sein du portail Théâtre
Rubber Soul est le sixième album des Beatles, paru le au Royaume-Uni, et trois jours plus tard aux États-Unis. Produit par George Martin sous le label Parlophone, l'album est publié moins de trois mois après la sortie de Help!. Enregistré en seulement quatre semaines entre le et le aux studios EMI de Londres, l'album est pourtant le fruit d'un important travail d'écriture et de composition du duo Lennon/McCartney. En effet, alors que la Beatlemania est en pleine expansion, le groupe planifie trois tournées américaines sur deux ans et fait des rencontres déterminantes au cours de celles-ci. Les Beatles font ainsi la connaissance de Bob Dylan durant l'été 1964, qui les initie à la consommation de cannabis, mais aussi d'Elvis Presley et du groupe The Byrds, qui influencent significativement leur travail. George Harrison montre également un intérêt grandissant pour la culture indienne et la musique de Ravi Shankar.
Rubber Soul se compose de quatorze chansons inédites dans sa version britannique. Il est ainsi le deuxième album des Beatles à ne comporter aucune reprise, après A Hard Day's Night. Deux chansons supplémentaires, We Can Work It Out et Day Tripper, sont éditées en single « double face A » le même jour que la sortie de l'album. Publié sur le marché américain par Capitol Records, Rubber Soul est réparti sur deux disques : l'un portant le même nom, mais avec douze chansons dont deux provenant de l'album Help!, et l'autre ayant pour titre Yesterday and Today, sorti six mois plus tard, comprenant le hit Yesterday, et plusieurs chansons de l'album suivant, Revolver.
Rubber Soul se caractérise par une évolution significative de la musique des Beatles, avec l'introduction de nouveaux instruments, comme le sitar ou l'harmonium. Les textes écrits par le groupe font par ailleurs l'objet d'importants progrès, puisque les trois auteurs John Lennon, Paul McCartney et George Harrison écrivent des chansons plus matures et personnelles par rapport aux disques précédents. Les Beatles abordent différents thèmes comme l'amour, l'amitié ou la mort, l'adultère ainsi que les psychotropes de manière détournée. Nowhere Man de Lennon, quatrième titre sur la face A du 33 tours original, est par ailleurs la première chanson du groupe à ne pas aborder le thème des filles et de l'amour.
À sa sortie, Rubber Soul est unanimement salué par la presse musicale. L'œuvre se hisse en première position des classements musicaux dans plusieurs pays, dont le UK Albums Chart au Royaume-Uni, le Billboard 200 aux États-Unis et remporte un succès immense auprès du public. L'album figure également dans de nombreux classements musicaux, et occupe notamment la cinquième place des 500 plus grands albums de tous les temps selon Rolling Stone. Plusieurs chansons se distinguent, comme la ballade Michelle, qui remporte un Grammy Awards, Girl, In My Life ou encore Norwegian Wood (This Bird Has Flown) et dans un genre plus rock, en ouverture de l'album, Drive My Car. Considéré comme l'album de transition de la carrière musicale des Beatles, Rubber Soul marque profondément l'histoire du rock, influence de nombreux artistes et préfigure l’avènement du mouvement hippie et du rock psychédélique.

Le métro de Toulouse est un réseau de métro automatique, desservant 37 stations situées sur Toulouse et son agglomération, exploité par la société Tisséo. Ouvert en 1993, il est composé des deux lignes A et B, dans des axes respectifs sud-ouest – nord-est et nord – sud. Les véhicules utilisés sont des véhicules automatiques légers VAL 206 et VAL 208.
La première ligne, ligne A, dessert 18 stations. Ouverte en 1993, elle a été prolongée de 3 stations en 2003, jusqu'à Balma, commune limitrophe de Toulouse.
La seconde ligne, intitulée ligne B, dessert quant à elle 20 stations, dont une en commun avec la ligne A : la station Jean Jaurès. Ouverte le , elle passe par plusieurs lieux stratégiques de Toulouse.
Une 3ème ligne, la ligne C, longue de 27 km et desservant 4 communes avec un total de 21 stations, est actuellement en construction. Son ouverture est prévue en 2028.
Lire l’article
Bombardier Inc. est une entreprise multinationale canadienne dont le siège social est situé à Montréal, Québec. Spécialisée dans la construction de matériels de transports, elle est présente dans la construction aéronautique (Bombardier Aéronautique) (avions régionaux, avions d'affaires, bombardiers d'eau (Canadair)...), dans la construction ferroviaire (Bombardier Transport, leader mondial) et, jusqu'à 2006, dans les services financiers (Bombardier Capital). La société a vendu fin 2003 son secteur récréatif (fabrication de divers véhicules de loisirs : motoneiges, chasse-neige, motomarines, hors-bord, etc.) à l'entreprise Bombardier Produits Récréatifs.
Lire l'article
L'Ironman est dans le langage commun du triathlon le nom donné à un des plus longs formats de la discipline. D'une distance totale de 226 kilomètres (140,6 miles), une compétition Ironman, « Homme de fer » en français, est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km). Cette appellation est associée au triathlon Ironman d'Hawaï originel crée en 1978 par John et Judy Collins, qui est depuis 1990 le championnat du monde d'Ironman (Ironman World Championships). Ironman et Triathlon Ironman sont des noms déposés, propriétés de la World Triathlon Corporation (WTC). Cette société privée organise et décerne, chaque année, le titre de « Champion du monde d'Ironman » à l'issue d'un circuit de courses qualificatives et d'une épreuve finale qui se déroule au mois d'octobre à Kailua-Kona, dans l'état d'Hawaï aux États-Unis. Sa devise, adoptée par tous les compétiteurs — les Ironmen —, est « Tout est possible » (Anything is possible). Au fil de son histoire, l'Ironman devient un nom dans le sport. Celui d'une compétition à la naissance du triathlon d'endurance très longue distance (XXL), d'une distance (226 km), d'un mythe (Ironman d'Hawaï), d'une marque (World Triathlon Corporation) pour devenir enfin, celui du championnat du monde de triathlon très longue distance le plus connu de la planète : l'Ironman World Championship.

Tozeur (arabe : توزر Écouter [tˤʊzɪr]) est une ville tunisienne aux confins de l'Atlas et du désert du Sahara, la plus grande des cinq oasis que compte le Jérid. Progressivement construite autour de sa palmeraie, elle est le chef-lieu du gouvernorat du même nom.
Située au nord-ouest du Chott el-Jérid, près de la frontière algérienne, Tozeur se trouve à 450 kilomètres au sud-ouest de Tunis. Ville au passé religieux important, elle accueille de nombreux lettrés. Ibn Chabbat lui lègue le système d'irrigation des palmeraies, et le poète Abou el Kacem Chebbi y compose son célèbre Ela Toghat Al Alaam, en plein protectorat français. La topographie contemporaine de Tozeur leur rend hommage, ainsi qu'aux marabouts. La ville de Tozeur connaît une importante croissance démographique, doublée d'une extension considérable, durant la seconde moitié du XXe siècle, avec la sédentarisation des Bédouins. Elle passe en quelques décennies d'une population d'environ 11 000 habitants à 37 365 habitants, selon le recensement de 2014.
L'architecture de son patrimoine bâti, en particulier celle de sa médina caractérisée par des motifs de briques en relief, est unique en Tunisie, avec celle de la ville voisine de Nefta. L'agriculture, et en particulier la monoculture des dattes de la variété deglet nour, constitue sa principale ressource, représentant le tiers de la production dattière tunisienne. Sa briqueterie est toujours en activité, pour répondre aux besoins de nombreux chantiers de construction. Depuis les années 1990, la municipalité de Tozeur développe le tourisme, sous l'impulsion du maire de l'époque, Abderrazak Cheraït. Ce développement s'appuie entre autres sur la présence d'un aéroport international et de nombreux hôtels, sur la valorisation du patrimoine et des lieux de tournage, et sur l'organisation du Festival international des oasis.
Tozeur a été choisie pour y implanter la première centrale solaire photovoltaïque de Tunisie, en 2019.

Stepan Andriïovytch Bandera (en ukrainien : Степа́н Андрі́йович Банде́ра), né le dans la province de Kalouch (Empire austro-hongrois, aujourd'hui Ukraine) et mort empoisonné le à Munich (Allemagne de l'Ouest), est un homme politique nationaliste ukrainien.
Il est l'un des dirigeants de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) et le chef de file de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN-B), à tendance fasciste. Dans sa lutte pour l'indépendance de l'Ukraine contre la Pologne et l'Union soviétique, il collabore avec l'Allemagne nazie en créant la Légion ukrainienne, sous commandement de la Wehrmacht.
Le , à Lviv, il proclame une déclaration d'indépendance de l'Ukraine avec Iaroslav Stetsko. Celle-ci étant rejetée par l'occupant allemand, il est arrêté le et envoyé l’année suivante au camp de Sachsenhausen. Libéré en , il se retourne contre l'Armée rouge et demande des armes à l'Allemagne nazie pour reconquérir l'indépendance de l'Ukraine.
Il fuit en Suisse avant la fin de la guerre pour réapparaître en Allemagne de l'Ouest, où il est assassiné par les services secrets soviétiques.

Le mont Ventoux est un sommet situé dans le département français de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Culminant à 1 910 mètres, il fait environ 25 kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-sud. Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. Il constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud-occitan.
Avant d'être parcourue par trois routes principales, qui ont permis le développement du tourisme vert et des sports de pleine nature aussi bien en été qu'en hiver notamment avec l'organisation de grandes courses cyclistes, de bolides motorisés ou autres événements, la montagne était sillonnée de drailles tracées par les bergers à la suite de l'essor de l'élevage ovin entre le XIVe et le milieu du XIXe siècle. Ces chemins ont désormais été transformés en sentiers de randonnée, à l'instar des GR 4 et GR 9.
Sa nature essentiellement calcaire et de nombreux pierriers dans la partie sommitale expliquent la remarquable blancheur du sommet. La montagne présente également une intense karstification due à l'érosion par l'eau. Les précipitations y sont particulièrement abondantes au printemps et à l'automne. L'eau de pluie s'infiltre dans des galeries et rejaillit au niveau de résurgences au débit variable telles la fontaine de Vaucluse ou la source du Groseau. Le mont Ventoux est soumis à un régime méditerranéen dominant, responsable parfois l'été de températures caniculaires, mais l'altitude induit aussi une grande variété de climats, de sommet au climat de type montagnard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. En outre, le vent peut être très violent et le mistral souffle pratiquement la moitié de l'année. Cette géomorphologie et ce climat particuliers en font un site environnemental riche et fragile, constitué de nombreux étages de végétation, comme en témoigne son classement en réserve de biosphère par l'UNESCO et en site Natura 2000.
Si des peuplements humains sont avérés au niveau des piémonts durant la Préhistoire, la première ascension documentée jusqu'au sommet serait l'œuvre, le , du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord. Il ouvre la voie, plus tard, à de nombreuses études à caractère scientifique. Par la suite, pendant près de six siècles, le mont Ventoux va être intensément déboisé, au profit des constructions navales à Toulon, des fabricants de charbon de bois et des éleveurs ovins. Durant la Seconde Guerre mondiale, la montagne abrite le maquis Ventoux. Depuis 1966, le sommet est coiffé d'une tour d'observation de plus de quarante mètres de haut surmontée d'une antenne TDF.
Alors que l'élevage ovin a presque disparu, l'apiculture, le maraîchage et la viticulture, la récolte des champignons parmi lesquels la truffe, ainsi que la culture de la lavande sont toujours pratiqués.
En raison de ces particularités, le mont Ventoux est une figure symbolique importante de la Provence ayant alimenté récits oraux ou littéraires, et maintes représentations graphiques artistiques ou scientifiques.

Madonna est le premier album de l'artiste américaine Madonna sorti le sous le label Sire Records. Il est ré-édité en 1985 sur le marché européen et renommé Madonna – The First Album. Tout commence en 1982, alors qu'elle commence à se lancer dans une carrière de chanteuse à New York, elle rencontre Seymour Stein, le président de Sire, qui lui fait signer un contrat après l'écoute de son single Everybody. Le succès de ce single encourage Sire à signer un contrat pour l'enregistrement d'un album. Pour la production, Madonna choisit de travailler avec Reggie Lucas, un producteur de Warner Records. Cependant, elle n'est pas satisfaite du résultat et est en désaccord avec les techniques de production de Lucas, elle décide donc de demander de l'aide supplémentaire pour la production.
Madonna demande donc à son petit ami de l'époque, John Benitez, de l'aider à finir l'album. Benitez remixe de nombreuses pistes et produit Holiday. L'ensemble de Madonna est dissonant et ressemble à une forme de disco synthétique rythmé, utilisant quelques-unes des nouvelles technologies de l'époque comme le LinnDrum, le Taurus ou le synthétiseur Oberheim OB-X. Madonna chante dans un timbre vocal de jeune fille joviale et parle de l'amour et des relations amoureuses...
Autres articles sélectionnés au sein du portail Warner Bros. Discovery

La Britannique Augusta Ada King, comtesse Lovelace ou simplement Ada Lovelace, née à Londres le 10 décembre 1815 et morte à Londres le 27 novembre 1852, est principalement connue pour avoir écrit une description de la machine analytique de Charles Babbage, un ancêtre mécanique de l'ordinateur. Lovelace est un personnage assez célèbre dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, notamment auprès des féministes, mais ne jouit pas d'une notoriété particulière en France.
Ada était la seule fille légitime du poète Lord Byron et de sa femme Annabella Milbanke, une mathématicienne, cousine de Caroline Lamb, dont la liaison avec Byron fut à l'origine d'un scandale. Son prénom Augusta viendrait d'Augusta Leigh, demi-sœur de Byron, avec qui ce dernier aurait eu un enfant. C'est Augusta qui encouragea Byron à se marier pour éviter un scandale, et il choisit Annabella à contrecœur. Annabella quitta Byron le 16 janvier 1816, et Ada resta avec Annabella. Le 21 avril, Byron signa l'acte de séparation, puis quitta le Royaume-Uni pour toujours. Il ne les revit jamais.
Autres articles sélectionnés au sein du portail du XIXe siècle























